Contact : info@jeanrenaudpierlot.be
Les portraits
Accueil
Les portraits <==== Vous êtes ici.
Le livre
Suggestions de littérature
Les suggestions de Chaines Youtube et Sites Internet
éco-citoyen
JR t'explique (Cours d'informatique)
Les suggestions cinématographiques
Parents: Mode d'emploi
Faits divers
Coaching
Coaching Scolaire
Abraham Lincoln 1809 - 1865
 Abraham Lincoln 1, né le 12 février 1809 dans le comté de Hardin (Kentucky) et mort assassiné le 15 avril 1865 à Washington, D.C., est un homme d'État américain. Il est le seizième président des États-Unis. Il est élu à deux reprises président des États-Unis, en novembre 1860 et en novembre 1864. Il est le premier président républicain de l’histoire du pays. Il a dirigé les États-Unis lors de la pire crise constitutionnelle, militaire et morale de leur histoire, la guerre de Sécession, et réussit à préserver l’Union. C’est au cours de celle-ci qu’il fait ratifier le XIIIe amendement de la Constitution des États-Unis, qui abolit l’esclavage. Il sort victorieux de la guerre. Assassiné cinq jours plus tard, à la suite d'un complot organisé par des confédérés, il ne termine pas son second mandat.
Abraham Lincoln 1, né le 12 février 1809 dans le comté de Hardin (Kentucky) et mort assassiné le 15 avril 1865 à Washington, D.C., est un homme d'État américain. Il est le seizième président des États-Unis. Il est élu à deux reprises président des États-Unis, en novembre 1860 et en novembre 1864. Il est le premier président républicain de l’histoire du pays. Il a dirigé les États-Unis lors de la pire crise constitutionnelle, militaire et morale de leur histoire, la guerre de Sécession, et réussit à préserver l’Union. C’est au cours de celle-ci qu’il fait ratifier le XIIIe amendement de la Constitution des États-Unis, qui abolit l’esclavage. Il sort victorieux de la guerre. Assassiné cinq jours plus tard, à la suite d'un complot organisé par des confédérés, il ne termine pas son second mandat.
Source Wikipédia: Abraham Lincoln
Ahmad Shah Massoud 1953 - 2001
.jpg) Ahmed Chah Massoud (2 septembre 1953 - 9 septembre 2001) (en persan : احمد شاه مسعود), fréquemment appelé le commandant Massoud, était le commandant du Front uni islamique et national pour le salut de l'Afghanistan, du Jamiat-e Islami et le chef de l'Armée islamique, une armée ayant combattu contre l'occupation soviétique puis le régime des talibans de 1996 à 2001.
Sa réputation de chef militaire, et notamment son surnom de « Lion du Pandjchir », vient du fait qu'il a réussi à repousser sept attaques d'envergure des troupes soviétiques contre la vallée du Pandjchir, au nord-est de Kaboul. Attribué à Al-Qaïda, son assassinat par attentat-suicide survient deux jours avant les évènements du 11 septembre 20011.
Ahmed Chah Massoud (2 septembre 1953 - 9 septembre 2001) (en persan : احمد شاه مسعود), fréquemment appelé le commandant Massoud, était le commandant du Front uni islamique et national pour le salut de l'Afghanistan, du Jamiat-e Islami et le chef de l'Armée islamique, une armée ayant combattu contre l'occupation soviétique puis le régime des talibans de 1996 à 2001.
Sa réputation de chef militaire, et notamment son surnom de « Lion du Pandjchir », vient du fait qu'il a réussi à repousser sept attaques d'envergure des troupes soviétiques contre la vallée du Pandjchir, au nord-est de Kaboul. Attribué à Al-Qaïda, son assassinat par attentat-suicide survient deux jours avant les évènements du 11 septembre 20011.
Source Wikipédia: Ahmed_Chah_Massoud
Alan Turing 1912 - 1954
Voir le trailer du film sur Alan Turing : Trailer Imitation game
L'homme trahi par le pays qu'il a sauvé pendant la guerre. L'homme trahi par le pays qu'il a sauvé pendant la guerre (Alan Turing) - HDG #26
.jpg) Alan Mathison Turing, né le 23 juin 1912 à Londres et mort le 7 juin 1954 à Wilmslow, est un mathématicien et cryptologue britannique, auteur de travaux qui fondent scientifiquement l'informatique.
Pour résoudre le problème fondamental de la décidabilité en arithmétique, il présente en 1936 une expérience de pensée que l'on nommera ensuite machine de Turing et des concepts de programme et de programmation, qui prendront tout leur sens avec la diffusion des ordinateurs, dans la seconde moitié du XXe siècle. Son modèle a contribué à établir la thèse de Church, qui définit le concept mathématique intuitif de fonction calculable.
Durant la Seconde Guerre mondiale, il joue un rôle majeur dans la cryptanalyse de la machine Enigma utilisée par les armées allemandes. Ce travail secret ne sera connu du public que dans les années 1970. Après la guerre, il travaille sur un des tout premiers ordinateurs, puis contribue au débat sur la possibilité de l'intelligence artificielle, en proposant le test de Turing. Vers la fin de sa vie, il s'intéresse à des modèles de morphogenèse du vivant conduisant aux « structures de Turing ».
Poursuivi en justice en 1952 pour homosexualité, il choisit, pour éviter la prison, la castration chimique par prise d'œstrogènes. Il est retrouvé mort par empoisonnement au cyanure le 8 juin 1954 dans la chambre de sa maison à Wilmslow. La reine Élisabeth II le reconnaît comme héros de guerre et le gracie à titre posthume en 2013.
Alan Mathison Turing, né le 23 juin 1912 à Londres et mort le 7 juin 1954 à Wilmslow, est un mathématicien et cryptologue britannique, auteur de travaux qui fondent scientifiquement l'informatique.
Pour résoudre le problème fondamental de la décidabilité en arithmétique, il présente en 1936 une expérience de pensée que l'on nommera ensuite machine de Turing et des concepts de programme et de programmation, qui prendront tout leur sens avec la diffusion des ordinateurs, dans la seconde moitié du XXe siècle. Son modèle a contribué à établir la thèse de Church, qui définit le concept mathématique intuitif de fonction calculable.
Durant la Seconde Guerre mondiale, il joue un rôle majeur dans la cryptanalyse de la machine Enigma utilisée par les armées allemandes. Ce travail secret ne sera connu du public que dans les années 1970. Après la guerre, il travaille sur un des tout premiers ordinateurs, puis contribue au débat sur la possibilité de l'intelligence artificielle, en proposant le test de Turing. Vers la fin de sa vie, il s'intéresse à des modèles de morphogenèse du vivant conduisant aux « structures de Turing ».
Poursuivi en justice en 1952 pour homosexualité, il choisit, pour éviter la prison, la castration chimique par prise d'œstrogènes. Il est retrouvé mort par empoisonnement au cyanure le 8 juin 1954 dans la chambre de sa maison à Wilmslow. La reine Élisabeth II le reconnaît comme héros de guerre et le gracie à titre posthume en 2013.
Source Wikipédia: Alan Turing
Denis Mukwege
Voir : Prix Nobel de la paix 2018 : Denis Mukwege accuse
Voir : Le discours du Dr. Denis Mukwege, prix nobel de la paix
Voir : Une vie : Denis Mukwege
Voir : Film Biopic sur le Docteur Denis_Mukwegege : Muganga
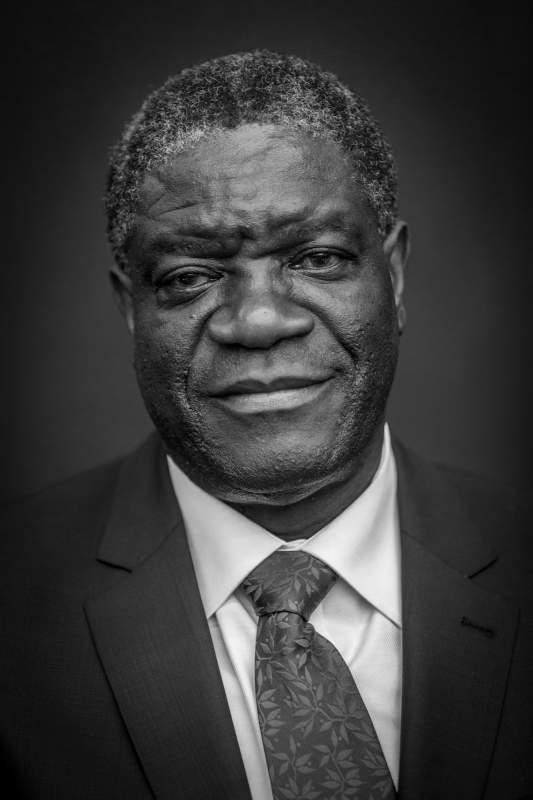 Denis Mukwege, né le 1er mars 1955 à Bukavu (alors au Congo belge), est un gynécologue et militant des droits de l'homme kino-congolais, ainsi qu'un pasteur chrétien évangélique pentecôtiste.
Denis Mukwege, né le 1er mars 1955 à Bukavu (alors au Congo belge), est un gynécologue et militant des droits de l'homme kino-congolais, ainsi qu'un pasteur chrétien évangélique pentecôtiste.
Surnommé « l'homme qui répare les femmes », il a reçu de nombreuses distinctions pour son engagement contre les mutilations génitales pratiquées sur les femmes en République démocratique du Congo, dont le prix Sakharov en 2014 et le prix Nobel de la paix en 2018.
Fils d'un pasteur pentecôtiste, Denis Mukwege effectue ses études primaires à l'athénée royal de Bukavu, puis poursuit ses études secondaires à l'institut Bwindi de Bukavu, où il obtient un diplôme en biochimie en 1974.
Après deux années passées à la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa (UNIKIN), il trouve sa voie en s'inscrivant, en 1976, à la faculté de médecine du Burundi.
Son diplôme de médecin obtenu en 1983, il fait ses premiers pas professionnels à l'hôpital de Lemera, situé au sud de Bukavu.
En 1984, il obtient une bourse de la Swedish Pentecostal Mission pour suivre une spécialisation en gynécologie à l'université d'Angers, en France.
Il fonde avec un Angevin l'association France-Kivu pour aider sa région d'origine.
Le 24 septembre 2015, il devient docteur en sciences médicales à l'université libre de Bruxelles après avoir soutenu une thèse intitulée Étiologie, classification et traitement des fistules traumatiques uro-génitales et génito-digestives basses dans l’Est de la RDC.
En 1989, il choisit de retourner au Congo pour s'occuper de l'hôpital de Lemera, dont il devint médecin directeur.
En 1996, lors de la première guerre du Congo, son hôpital est brutalement détruit lors de l'attaque de Lemera.
Mukwege échappe à la mort alors que plusieurs malades et infirmiers sont assassinés.
Il se réfugie à Nairobi, puis décide de retourner au Congo.
Avec l'aide du PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete, association caritative suédoise), il y fonde l'hôpital de Panzi à Bukavu. Il se voit alors confronté aux mutilations génitales pratiquées sur les femmes.
Profondément marqué par ces violences, il décide de faire connaître au monde la barbarie dont sont victimes les femmes à l'est de la république démocratique du Congo, et d'agir pour leur venir en aide.
Dans une région où le viol collectif est utilisé comme arme de guerre, il se spécialise dans la prise en charge des femmes victimes de ces agressions sexuelles, leur apportant une aide médicale mais aussi psychique, économique et juridique.
Il est reconnu comme l'un des spécialistes mondiaux du traitement des fistules ; il reçoit à ce titre, entre autres, deux distinctions universitaires en 2010 (voir Distinctions).
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Denis Mukwege
Gerhard Richter
Voir: le film sur Gerhard Richter (L'oeuvre sans auteur)
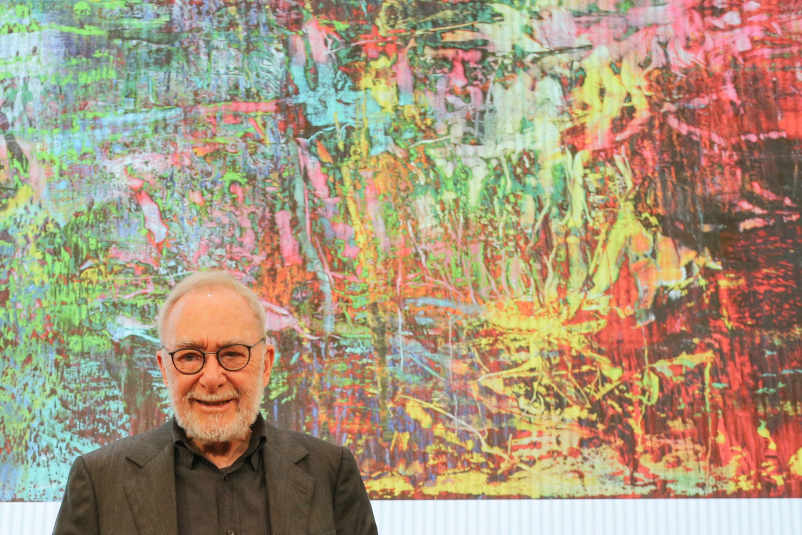 Gerhard Richter, né à Dresde le 9 février 1932, est un artiste peintre allemand dont l'œuvre est reconnue, depuis les années 1980, « comme une expérience artistique inédite et remarquable ».
Gerhard Richter, né à Dresde le 9 février 1932, est un artiste peintre allemand dont l'œuvre est reconnue, depuis les années 1980, « comme une expérience artistique inédite et remarquable ».
Peintre polymorphe, il aborde tantôt des sujets figuratifs, tantôt produit des œuvres abstraites.
Après une formation initiale de peintre, il est admis à l’Académie des Beaux-arts de Dresde à sa seconde candidature où il obtient une maîtrise, diplôme qui lui permet de bénéficier d’un atelier pour trois ans.
Son intérêt pour la peinture abstraite, Jackson Pollock et Lucio Fontana en particulier, motive son passage à l’Ouest en 1961.
Finalement établi à Düsseldorf, il est l’élève de Karl-Otto Götz et rencontre Sigmar Polke, Blinky Palermo et le futur galeriste Konrad Fischer-Lueg.
Il peint la première œuvre de son catalogue en 1962 : Tisch (« Table »), une huile peinte d’après une photographie de presse.
À la fois photographe du quotidien et peintre, il reproduit sur la toile les sujets de ses photos.
Paysages, natures mortes et scènes intimes parsèment ainsi une œuvre par ailleurs essentiellement constituée d’œuvres abstraites qu’il nomme, invariablement, Abstraktes Bild (« Toile abstraite »).
Les sources documentaires du travail de Gerhard Richter : les photos de presse, ses propres photos, les clichés d'amateur qu'il collectionne, ont été réunis pour former un atlas exposé pour la première fois en 1972.
Parallèlement à ses expositions personnelles, il exerce une activité de professeur dans plusieurs écoles d’Art, notamment à Hambourg, Düsseldorf ou Halifax (Nouvelle-Écosse, Canada), il est notamment le professeur de l'artiste Pia Fries.
Il reçoit de nombreuses récompenses dont le Junger Western Art à Recklinghausen en 1967, le prix Arnold Bode à la Documenta de Cassel en 1981, le prix Oskar Kokoschka à Vienne en 1985, le Prix Wolf des Arts en Israël en 1994/95 et le Praemium Imperiale au Japon en 1997.
En 1957, son premier mariage l’unit à Marianne Eufinger, la future Ema de son Akt auf einer Treppe (Nu dans l'escalier, Cologne, musée Ludwig), référence au célèbre Nu descendant un escalier de Marcel Duchamp et manifeste de sa technique du flou dans la figuration initiée en 1963 (Hirsch).
Sa fille Betty, née en 1966, aura trois toiles à son prénom : deux peintes en 1977 (deux gros plans de visage) et une en 1988 (la tête tournée).
Deuxième mariage en 1982 avec la sculptrice Isa Genzken, sujet de deux portraits en 1990 (Isa).
Il se marie enfin en 1995 avec Sabine Moritz qui donnera naissance à leur fils Théo la même année ; tous deux seront les modèles de la série S. mit Kind (S. avec enfant).
Enfin, il peindra son seul autoportrait connu en 1996, Selbstportrait.
Il vit et travaille désormais à Cologne.
En novembre 2006, Ema (nude descendinga staircase) (1992), a été vendu pour 320 000 $ chez Phillips à New York.
Il est désormais l'artiste vivant le plus cher du monde (octobre 2012) puisque l'une de ses œuvres abstraites de 1994 a été vendue 34,2 millions de dollars.
Nouveau record le 14 mai 2013 mais cette fois avec une œuvre figurative : 'Domplatz, Mailand' 1968 vendue 37,1 M$ par Sotheby's.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Gerhard Richter
Charles de Habsbourg, dit Charles Quint 1500 - 1558
 Charles de Habsbourg, dit Charles Quint ou Charles V, né le 24 février 1500 à Gand en Flandre (Pays-Bas) et mort le 21 septembre 1558 au monastère de Yuste (Espagne), est un prince de la maison de Habsbourg, fils de Philippe le Beau et de Jeanne la Folle.
Charles de Habsbourg, dit Charles Quint ou Charles V, né le 24 février 1500 à Gand en Flandre (Pays-Bas) et mort le 21 septembre 1558 au monastère de Yuste (Espagne), est un prince de la maison de Habsbourg, fils de Philippe le Beau et de Jeanne la Folle.
Il hérite notamment de l'Espagne et de son empire colonial, des dix-sept provinces des Pays-Bas, du royaume de Naples et des possessions autrichiennes ; élu empereur des Romains en 1519, il est le monarque le plus puissant de la première moitié du XVIe siècle.
Cette accumulation de principautés et royaumes est à la fois le fruit du hasard (la mort de sa tante, Isabelle d'Aragon, princesse des Asturies, en 1498,
puis du fils de cette dernière, l'infant Miguel de la Paz, en juillet 1500, font de sa mère l'héritière des couronnes espagnoles)
mais également le résultat d'une politique systématique d'alliances matrimoniales faisant de lui l'héritier de quatre dynasties :
arrière-petit-fils de Charles le Téméraire,
petit-fils de Maximilien d'Autriche, d'Isabelle la Catholique, reine de Castille,
et de Ferdinand, roi d'Aragon et de Naples, il est duc de Bourgogne sous le nom de Charles II, roi d'Espagne sous le nom de Charles Ier (en espagnol Carlos I),
mais passe surtout à la postérité comme l'empereur romain germanique Charles V (en allemand Karl V.), que l'on énonce alors « Charles Quint », « quint » signifiant « cinquième ».
Il apparaît comme le dernier empereur germanique à souhaiter réaliser le rêve carolingien d'un empire prenant la tête de la chrétienté.
Cette volonté d'unité chrétienne face à la progression de l'Empire ottoman dans les Balkans et en Méditerranée se voit cependant systématiquement combattue par l'opposition des rois de France François Ier et Henri II,
et remise en cause par la Réforme protestante, initiée par Martin Luther à partir de 1517.
Aux problèmes extérieurs qui se posent pendant tout son règne, s'ajoutent des révoltes en Castille, dans le Saint-Empire, en Flandre et en Brabant, qui affaiblissent par moments les bases de son pouvoir.
Au terme d'une vie de combats, miné et désabusé par ses échecs face à la France, aux luthériens et à sa propre famille, il se dépouille progressivement de ses pouvoirs.
Par une série de conventions avec son frère Ferdinand, il lui cède les États autrichiens et la dignité impériale.
Le 25 octobre 1555, à Bruxelles, il abdique ses droits sur les États bourguignons, désormais unis et autonomes, en faveur de son fils Philippe, déjà duc de Milan et roi de Naples, avant de lui céder également ses droits sur l'Espagne en 1556.
Charles, légataire universel de plusieurs dynasties européennes, concentre dans ses mains l'héritage de quatre dynasties représentées chacune par l'un de ses quatre grands-parents :
il est à la fois un héritier de l'État des ducs Valois de Bourgogne, un Habsbourg, un Aragonais et un Castillan.
Né et élevé à la cour de Bourgogne, dans une culture burgondo-flamande, ses incessants voyages à travers les possessions éparpillées dans l'ensemble du continent européen ont néanmoins contribué à faire de lui un personnage européen par-delà les appartenances nationales.
Sa devise, Plus Oultre (« encore plus loin »), créée par un médecin italien pour illustrer la tradition chevaleresque bourguignonne, est devenue sous sa forme latine la devise nationale de l'Espagne.
Quand il naît en 1500, rien ne le destine à devenir le prince le plus puissant du XVIe siècle.
Son père, Philippe le Beau, encore jeune, doit hériter des biens de son propre père, le roi des Romains Maximilien Ier.
Sa mère, Jeanne la Folle, n'est à cette date qu'une simple infante espagnole ; elle a un neveu, don Miguel de la Paz, héritier présomptif des couronnes de Castille, d'Aragon et du Portugal, dont la mort, six mois après la naissance de Charles, fait de ce dernier un prince héritier des royaumes aragonais et castillans, fils aîné et héritier de l'époux de l'héritière présomptive des Rois catholiques d'Espagne.
En quelques années, tout s'accélère.
Isabelle la Catholique meurt en 1504, faisant de Jeanne la reine de Castille.
Deux ans plus tard, Philippe le Beau, parti recueillir en Espagne l'héritage de sa femme, décède à son tour.
Charles devient alors duc de Bourgogne, c'est-à-dire souverain de l'État bourguignon, alors principalement constitué des anciens Pays-Bas et du comté de Bourgogne.
En 1515, il est émancipé et commence à négocier la succession de son grand-père Ferdinand II d'Aragon qui a, au seuil de la mort, déshérité sa fille Jeanne, incapable de régner, au profit du jeune duc de Bourgogne.
Charles devient ainsi, l'année suivante, roi d'Aragon, de Naples et de Sicile, en même temps qu'il s'autoproclame roi de Castille au détriment de sa mère.
Parti se faire reconnaître comme roi des royaumes espagnols, il apprend la mort de son autre grand-père, l'empereur Maximilien, qui lui lègue les duchés autrichiens et la prétention impériale.
Le 28 juin 1519, élu Roi des Romains, il se rend à Aix-la-Chapelle afin d'être couronné empereur élu du Saint-Empire, au détriment notamment du roi de France François Ier.
Son couronnement à Bologne, le 24 février 1530, le fait empereur des Romains, couronné selon la tradition carolingienne par le pape.
En effet, le pape Clément VII officie, marquant ainsi la concorde retrouvée entre les pouvoirs temporel et spirituel, tandis que la sainte onction est donnée par le cardinal Alexandre Farnèse.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Charles Quint
Thomas Alva Edison 1847 - 1931
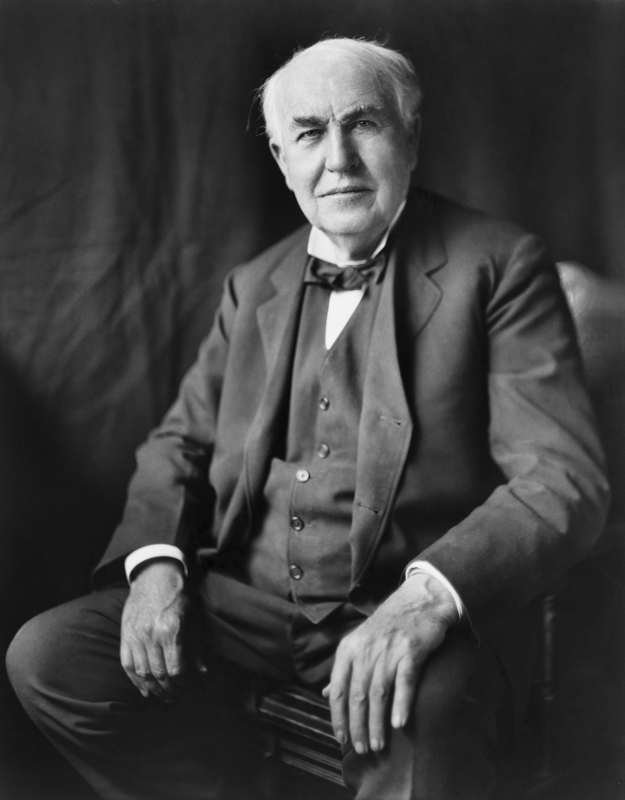 Thomas Alva Edison, né le 11 février 1847 à Milan dans l'Ohio et mort le 18 octobre 1931 à West Orange dans le New Jersey, est un inventeur, un scientifique et un industriel américain.
Thomas Alva Edison, né le 11 février 1847 à Milan dans l'Ohio et mort le 18 octobre 1931 à West Orange dans le New Jersey, est un inventeur, un scientifique et un industriel américain.
Fondateur de la General Electric, l'une des premières puissances industrielles mondiales, il fut un inventeur prolifique (plus de 1 000 brevets).
Pionnier de l'électricité, diffuseur, vulgarisateur, il fut également l'un des principaux inventeurs du cinéma (aux côtés, entre autres, de William Kennedy Laurie Dickson, Émile Reynaud, Louis Lumière, Jules Carpentier) et de l'enregistrement du son.
Il est parfois surnommé « le sorcier de Menlo Park », ville du New Jersey rebaptisée « Edison » en son honneur en 1954.
Thomas Alva Edison est le septième et dernier enfant de Samuel Edison (1804-1896), Canadien d'origine néerlandaise, qui dut fuir le Canada pour avoir participé aux rébellions de 1837-1838 et qui fut tour à tour brocanteur, épicier, agent immobilier, charpentier.
Sa mère, Nancy Elliot (1810-1871), ancienne institutrice, était également Canadienne mais d'origine écossaise.
Le père de Nancy était un héros de la guerre d'indépendance des États-Unis.
Thomas Alva Edison est le cadet d'une famille modeste qui le stimule intellectuellement et politiquement.
En 1854, alors qu'il est âgé de 7 ans, sa famille s'installe à Port Huron dans le Michigan où son père obtient un emploi de charpentier.
Son professeur, le révérend Engle, le considère comme un hyperactif stupide car il se montre trop curieux, pose trop de questions et n'apprend pas assez rapidement.
Après trois mois de cours, il est renvoyé de son établissement scolaire.
Aidé par sa mère qui lui donne des cours à la maison, il complète alors sa formation de base en parfait autodidacte, lisant des grands auteurs comme Charles Dickens ou Shakespeare, et dévorant tous les livres de science que sa mère lui apporte, notamment l'ouvrage de physique expérimentale School of Natural Philosophy de Richard Green Parker.
Il fréquente assidûment la bibliothèque de Détroit : « Si mes souvenirs sont exacts, je commençai par le premier livre du rayon du bas pour dévorer ensuite tout le reste, l'un après l'autre.
Je n'ai pas lu quelques livres ; j'ai lu la bibliothèque entière ».
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Thomas Edison
John von Neumann 1903 - 1957
 John von Neumann (János Lajos Neumann, né le 28 décembre 1903 à Budapest et mort le 8 février 1957 à Washington, est un mathématicien et physicien américano-hongrois.
John von Neumann (János Lajos Neumann, né le 28 décembre 1903 à Budapest et mort le 8 février 1957 à Washington, est un mathématicien et physicien américano-hongrois.
Il a apporté d'importantes contributions en mécanique quantique, en analyse fonctionnelle, en théorie des ensembles, en informatique, en sciences économiques et dans beaucoup d'autres domaines des mathématiques et de la physique.
Il a de plus participé aux programmes militaires américains.
Aîné d'une fratrie de trois, János Neumann naît à Budapest dans une famille d'origine juive, de Margit Kann et de Miksa Neumann, un avocat originaire de Pest qui deviendra le conseiller juridique principal puis le directeur de la Banque de crédit et d'hypothèque hongroise.
Miksa Neumann est anobli le 1er juillet 1913 et intégré à la noblesse hongroise avec le prédicat de Marghita (marghitai Neumann en hongrois ; Neumann von Marghita en allemand).
Les enfants Neumann grandissent dans une famille qui côtoie et reçoit chez elle l'élite intellectuelle hongroise et où l'on discute autant sciences, musique et théâtre que littérature.
János et ses deux jeunes frères, Mihály (1907°) et Miklós (1911°), apprennent ainsi, en plus du hongrois, l'allemand et le français dès leur plus jeune âge.
Intellectuels liés au mouvement des Lumières juif (la Haskala), le jeune Neumann ne prête guère attention à ses origines juives, sinon pour son répertoire de blagues.
János est un enfant prodige : à deux ans, il sait lire ; à six ans, il converse avec son père en grec ancien et peut mentalement faire la division d'un nombre à huit chiffres.
Une anecdote rapporte qu'à huit ans, il a déjà lu les quarante-quatre volumes de l'histoire universelle de la bibliothèque familiale et qu'il les a entièrement mémorisés :
Il aurait été capable de citer de mémoire des pages entières de livres lus des années auparavant.
Il entre au lycée luthérien de Budapest (Budapesti Evangélikus Gimnázium) qui était germanophone en 1911.
En 1913, son père achète un titre nobiliaire austro-hongrois et le jeune Neumann János devient margittai Neumann János, puis prend le nom Johann von Neumann qui sera anglicisé, dans les années 1930, en John von Neumann au moment de l'émigration aux États-Unis (alors que ses frères choisiront pour patronymes Newman et Vonneumann).
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: John von Neumann
Jules Verne 1828 - 1905
Un de mes auteurs préférés.
 Jules Verne, né le 8 février 1828 à Nantes et mort le 24 mars 1905 à Amiens, est un écrivain français dont l'œuvre est, pour la plus grande partie, constituée de romans d'aventures évoquant les progrès scientifiques du XIXe siècle.
Jules Verne, né le 8 février 1828 à Nantes et mort le 24 mars 1905 à Amiens, est un écrivain français dont l'œuvre est, pour la plus grande partie, constituée de romans d'aventures évoquant les progrès scientifiques du XIXe siècle.
Bien qu'il ait d'abord écrit des pièces de théâtre, Verne ne rencontre le succès qu'en 1863 lorsque paraît, chez l'éditeur Pierre-Jules Hetzel (1814-1886), son premier roman, Cinq Semaines en ballon.
Celui-ci connaît un très grand succès, y compris à l'étranger. À partir des Aventures du capitaine Hatteras, ses romans entreront dans le cadre des Voyages extraordinaires, qui comptent 62 romans et 18 nouvelles, parfois publiés en feuilleton dans le Magasin d'éducation et de récréation, revue destinée à la jeunesse, ou dans des périodiques destinés aux adultes comme Le Temps ou le Journal des débats.
Les romans de Jules Verne, toujours très documentés, se déroulent généralement au cours de la seconde moitié du XIXe siècle.
Ils prennent en compte les technologies de l'époque —
Les Enfants du capitaine Grant (1868),
Le Tour du monde en quatre-vingts jours (1873),
Michel Strogoff (1876),
L'Étoile du sud (1884), etc. — mais aussi d'autres non encore maîtrisées ou plus fantaisistes —
De la Terre à la Lune (1865),
Vingt Mille Lieues sous les mers (1870),
Robur le Conquérant (1886), etc.
Outre ses romans, on lui doit de nombreuses pièces de théâtre, des nouvelles, des récits autobiographiques, des poésies, des chansons et des études scientifiques, artistiques et littéraires.
Son œuvre a connu de multiples adaptations cinématographiques et télévisuelles depuis l'origine du cinéma ainsi qu'en bande dessinée, au théâtre, à l'opéra, en musique ou en jeu vidéo.
L'œuvre de Jules Verne est universelle ; selon l’Index Translationum, avec un total de 4 751 traductions, il vient au deuxième rang des auteurs les plus traduits en langue étrangère après Agatha Christie et devant Shakespeare.
Il est ainsi, en 2011, l'auteur de langue française le plus traduit dans le monde. L'année 2005 en France a été déclarée « année Jules Verne », à l'occasion du centenaire de la mort de l'écrivain.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Jules Verne
Bill Gates 1955 -
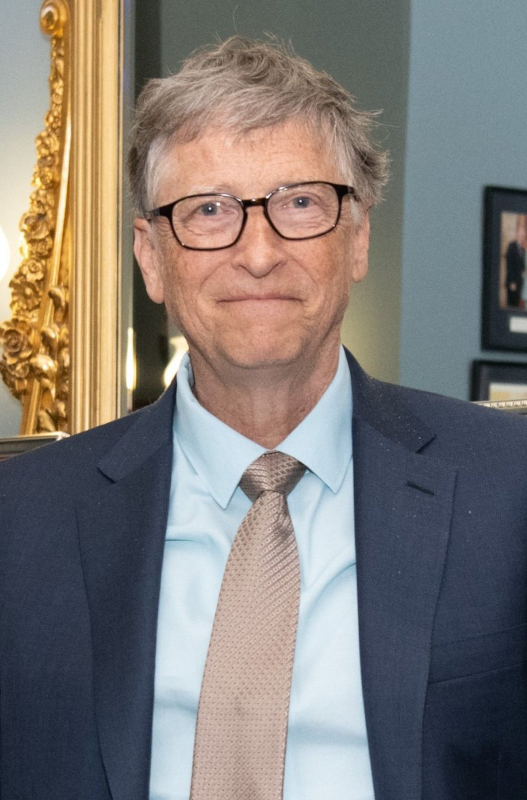 William Henry Gates III, dit Bill Gates, né le 28 octobre 1955 à Seattle (État de Washington), est un informaticien et entrepreneur américain, pionnier dans le domaine de la micro-informatique.
William Henry Gates III, dit Bill Gates, né le 28 octobre 1955 à Seattle (État de Washington), est un informaticien et entrepreneur américain, pionnier dans le domaine de la micro-informatique.
En 1975, à l'âge de 20 ans, il fonde la société de logiciels de micro-informatique Micro-Soft (rebaptisée depuis lors Microsoft) avec son ami Paul Allen.
Son entreprise achète le système d'exploitation QDOS pour en faire le MS-DOS, puis conçoit le système d'exploitation Windows, tous deux en situation de quasi-monopole mondial.
Grâce au succès commercial de Microsoft il devient l'homme le plus riche du monde de 1996 à 2007, ainsi qu'en 2009, et de 2014 à 2016.
Lorsqu'il regagne cette position (selon le classement Bloomberg) en janvier 2014, sa fortune s'élève à 78,5 milliards de dollars américains.
En 2019, le magazine Forbes classe Bill Gates comme le deuxième homme le plus riche du monde avec une fortune de 105 milliards de dollars américains, détrôné par le fondateur du site Amazon Jeff Bezos, qui, lui, dispose d'une fortune estimée à 112 milliards de dollars américains.
Depuis octobre 2007, Bill Gates se consacre à sa fondation Bill-et-Melinda-Gates.
Bill Gates naît le 28 octobre 1955 à Seattle (État de Washington) aux États-Unis, dans une famille aisée.
Son père, William Henry Gates II (1925-2020), est avocat d'affaires. Sa mère, Mary Maxwell Gates, est professeur et présidente de la direction de quelques entreprises et banques de la United Way of America et le First Interstate Bank.
Bill Gates découvre l'informatique à la très sélective Lakeside School de Seattle, qui dispose alors d'un PDP-10 loué.
Il y réalise avec son ami d'enfance Paul Allen son premier programme informatique : un jeu de tic-tac-toe (morpion).
En 1968, âgé de 13 ans, il fonde avec Allen et quelques autres amis le Lakeside Programmers Group.
Quelques sociétés recourront à leurs talents, essentiellement pour améliorer des systèmes et des applications existantes écrites en langage assembleur.
En 1973, Gates entre à l'université Harvard, à l'âge de 18 ans. Il y rencontre Steve Ballmer, futur CEO de Microsoft.
Il abandonne rapidement ses études pour se consacrer uniquement à la programmation informatique.
Le 13 décembre 1977, il est arrêté par la police à Albuquerque au Nouveau Mexique pour une conduite sans permis.
De cette arrestation subsistera une célèbre photographie d'identité judiciaire où l'on voit le patron de Microsoft sourire sur les clichés, malgré les circonstances.
Bill Gates co-réalise avec Allen un interpréteur BASIC pour l'Altair 8800. Cette réalisation est à la fois un tour de force et un coup de chance : le développement se fait entièrement sur PDP-10 et l'Altair BASIC n'est essayé sur un véritable Altair 8800 que le jour de la démonstration, laquelle réussit parfaitement.
L'Altair BASIC marque une étape dans l'histoire de la micro-informatique : ce sera le premier langage de programmation à avoir fonctionné sur un micro-ordinateur commercial.
Ce sera également le premier logiciel édité par la société Microcomputer Software, fondée pour l'occasion, en 1975, alors que Bill Gates est âgé de 20 ans, et dont la contraction Micro-Soft puis Microsoft est aujourd'hui plus familière.
Le 31 janvier 1976, Bill Gates écrit une lettre intitulée « An Open Letter to Hobbyists » (« Lettre ouverte aux bricoleurs »), dans laquelle il condamne pour la première fois le partage illégal de l'un de ses logiciels, le BASIC d'Altair :
« We have written 6800 BASIC, and are writing 8080 APL and 6800 APL, but there is very little incentive to make this software available to hobbyists. Most directly, the thing you do is theft. »
(« nous avons écrit le 6800 BASIC et nous écrivons les 8080 et 6800 APL, mais nous n'avons pas envie de fournir ce logiciel aux amateurs. Pour être clair, ce que vous faites, c'est du vol »).
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Bill Gates
Bobby Fischer 1943 - 2008
 Robert James Fischer, dit Bobby Fischer, né le 9 mars 1943 à Chicago aux États-Unis et mort le 17 janvier 2008 à Reykjavik en Islande, est un joueur d'échecs américain, naturalisé islandais en 2005.
Robert James Fischer, dit Bobby Fischer, né le 9 mars 1943 à Chicago aux États-Unis et mort le 17 janvier 2008 à Reykjavik en Islande, est un joueur d'échecs américain, naturalisé islandais en 2005.
Champion des États-Unis à quatorze ans en janvier 1958, Fischer devint, en 1972, champion du monde en remportant, sur fond de guerre froide, le « match du siècle » à Reykjavik face au joueur soviétique Boris Spassky.
Fischer contribua de façon décisive, par ses revendications (parfois excessives) lors des tournois, à l'amélioration de la condition de joueur d'échecs professionnel, tant du point de vue financier que de l'organisation matérielle des tournois.
Sa victoire sensationnelle en finale du championnat du monde d'échecs 1972, mettant un coup d'arrêt à la domination russe dans le championnat du monde des échecs depuis 1948, en fit une icône dans son pays, lui apportant la reconnaissance du public américain et la médiatisation à travers le monde, bien qu'après 1990, il fît des déclarations antisémites et antichrétiennes qui ternirent sa réputation.
Après s'être retiré de toutes les compétitions en 1972, Fischer disputa en 1992, à Sveti Stefan et à Belgrade, pendant les guerres de Yougoslavie, un match revanche contre son adversaire de 1972, Boris Spassky, en violation de l'embargo proclamé par le département d'État américain.
Menacé de poursuites par son pays, il termina sa vie en exil et multiplia les déclarations antisémites, antichrétiennes et anti-américaines.
Il vécut d'abord en Hongrie (de 1993 à 1999), puis au Japon, de janvier 2000 à mars 2005 et enfin en Islande, de 2005 à 2008.
La mère de Bobby Fischer, Regina Wender (1913-1997), est une Américaine d'ascendance juive allemande.
Née en Suisse, elle fut éduquée à Saint-Louis (Missouri). En 1932, à 19 ans, diplômée du college, elle partit à Berlin pour retrouver son frère qui y était stationné en tant que marin de l’US Navy et elle fut recrutée comme secrétaire par le généticien américain Hermann Joseph Muller.
En 1933, elle fit la connaissance de Hans Gerhardt Leibschner qui avait changé son nom en Fischer pour avoir un nom à consonance moins juive. Gerhardt Fischer, né à Berlin en 1909, était un biophysicien allemand et un assistant du professeur Muller.
Le professeur encouragea Regina à poursuivre ses études et à le suivre à Léningrad où il avait un poste et à Moscou.
En 1933, Regina et Gerhardt quittèrent l'Allemagne nazie et partirent à Moscou où ils se marièrent en octobre de cette année (ou en 1938).
Regina Fischer devint étudiante de l'Institut de médecine de Moscou de 1933 à 1938.
En 1939, pour fuir l'antisémitisme qui se développait en URSS, Regina partit en France avec leur fille Joan née en 1938 puis elle alla aux États-Unis, mais sans son mari qui partit au Chili, son entrée sur le territoire des États-Unis lui étant refusée du fait de sa nationalité allemande.
Lorsque Bobby Fischer naquit à Chicago en mars 1943, Gerhardt et Regina Fischer étaient séparés depuis 1939.
Regina Fischer demanda le divorce en 1945, deux ans après la naissance de son fils, alors qu'elle habitait Moscow dans l'Idaho.
Elle avait inscrit Gerhardt Fischer comme père de Robert James en dépit du fait qu'il n'avait jamais mis les pieds aux États-Unis.
En 2002, une enquête menée par deux journalistes du Philadelphia Inquirer a montré que le père biologique de Fischer serait plutôt le physicien juif hongrois Paul Nemenyi (en) qui avait émigré aux États-Unis la même année que Regina Fischer en 1939.
Quand le physicien participait au projet Manhattan en tant qu'ingénieur à Washington, le FBI soupçonna Nemenyi d'être communiste et Regina d'être une espionne russe.
En effet, Regina avait étudié à l'Institut de médecine de Moscou, où elle avait passé cinq ans avant d'émigrer aux États-Unis après son mariage.
Le FBI tint un dossier sur Regina. Elle avait fait la connaissance de Nemenyi au Colorado, en 1942, et, après la naissance de Bobby en mars 1943, le physicien lui envoya chaque mois une somme d'argent.
Les versements continuèrent jusqu'à la mort de Nemenyi, en 1952.
Bobby ne vit jamais Gerhardt Fischer puisque ses parents étaient séparés à sa naissance selon le dossier que tenait le FBI.
Gerhardt ne pouvait venir aux États-Unis du fait de sa nationalité allemande.
Il s'installa au Chili où il se fit appeler Gerardo Fischer. Il n'envoya aucune pension pour aider sa femme et sa fille.
En juillet 1958, inquiet pour son fils et sa fille qui étaient à Moscou tandis que la situation internationale était tendue, il écrivit à son ancienne femme lui demandant ce qu'elle comptait faire tandis qu'il n'avait pas de nouvelles.
En 1974, Gerardo, sa nouvelle femme et ses enfants furent brièvement emprisonnés en Amérique du Sud, du fait de leurs engagements politiques.
Libérés, ils partirent en France et Gerhardt demanda l'aide financière de son ancienne femme.
Contacté, Bobby Fischer refusa alors d'aborder le sujet de son père.
En 1990, le champion américain vint en Europe et vécut plusieurs mois en Allemagne.
Son père résidait à cette époque à Berlin mais Bobby Fischer ne le rencontra pas.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Bobby Fischer
Ambiorix
 Ambiorix est un chef des Éburons du Ier siècle av. J.-C., peuple belge du nord de la Gaule (Gaule belgique dans la terminologie antique).
Ambiorix est un chef des Éburons du Ier siècle av. J.-C., peuple belge du nord de la Gaule (Gaule belgique dans la terminologie antique).
Selon Jules César, il partage ce commandement avec Catuvolcos « roi de la moitié des Éburons ».
Les Éburons sont établis « entre la Meuse et le Rhin » selon César, dans la région de Tongres — à l'époque Atuatuca Tungrorum, située « au centre du territoire » — ainsi qu'à Liège, dans l'Ardenne et en Campine.
Ambiorix inflige une cinglante défaite aux légions romaines en 54 av. J.-C., peut-être dans la vallée du Geer.
Il passe pour un chef rusé, qui réussit à échapper à César.
Ambiorix est devenu un des héros nationaux de la Belgique dans la deuxième moitié du XIXe siècle, porté par le même mouvement nationaliste et romantico-historique que celui qui toucha Vercingétorix pour les Français.
Le poète et académicien Johannes Nolet de Brauwere van Steeland en fit en 1841 cinq chants qui connurent un grand succès et furent traduits cinq ans plus tard en vers français par le Dr Pierre Lebrocquy (Gand 1797 - Nivelles 1864).
Le nom Ambiorix est d'origine celtique, avec un sens toujours discuté. Comme les Éburons avaient deux rois, le principal portant le titre de « double roi », Ambiorix n'est peut-être que ce titre : si rix est le mot gaulois bien connu pour « roi », l'élément amb(i) (qui se retrouve dans ambactos « serviteur ») peut signifier « autour, alentour, contour » ou bien « double, des deux côtés, de part et d'autre », comme dans la forme grecque Ἀμφικτύον / Amphictyon : « voisin, habitant autour » ; quant à ambio-, forme thématisée, elle peut se comprendre comme « enclos ».
Cette double-royauté est peut-être dûe à la réunion de deux tribus sur le territoire des Éburons.
Les Éburons étaient principalement de langue celtique comme l'indiquent les noms des différents personnages connus (Ambiorix, Catuvolcos et d'autres) et le substrat toponymique des régions qu'ils ont habitées (leur capitale Atuatuca Tungrorum / Aduatuca).
Aucun indice onomastique antique ne montre qu'une langue germanique ait pu être parlée dans la région avant le Bas Empire.
Depuis 57 av. J.-C., la région semble pacifiée par les troupes romaines, mais en -54, l'assassinat, commandité par Jules César du chef gaulois Dumnorix, et les difficultés liées à une récolte de blé désastreuse conduisent à un mécontentement qui se retourne contre l'occupant alors en quartiers d'hiver.
C'est le point de départ d'un soulèvement des Éburons, commandés par Ambiorix, ainsi que de plusieurs autres tribus belges (Atuatuques, Nerviens...), à l'instigation du chef trévire Indutiomaros.
Grâce à un stratagème, Ambiorix entraîne la XIVe légion romaine de Cotta et Sabinus dans un guet-apens et l'anéantit à la bataille d'Aduatuca, entre Glons et Boirs, dans une profonde vallée.
Cette défaite est le plus important revers subi par les Romains à l'occasion de la guerre des Gaules.
Puis Ambiorix et ses hommes marchent sur le camp de Quintus Cicéron, frère du célèbre homme d'État du même nom.
Les troupes romaines, assiégées, tiennent bon. César intervient juste à temps pour les délivrer.
Ambiorix parvient à s'enfuir et se réfugie chez les Germains, mais les légions de César se livrent à des représailles si importantes (les habitants sont déportés, vendus comme butin de guerre) que le peuple des Éburons - pourtant encore attesté par Strabon- finit par disparaitre en tant que tel des sources, intégré dans la civitas des Tongres.
En 53 av. J.-C., César écrit qu'Ambiorix vit à proximité de la forêt d’Ardenne, dans une maison construite au milieu des bois, ce qui lui a permis d'échapper à une attaque-surprise tendue par Basilus, sur ordre de Jules César :
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Ambiorix
Giulia Tofana 1620 - 1659
 Giulia Tofana, également orthographié Toffana ou Tophana (Palerme), morte exécutée à Rome en juillet 1659, est une empoisonneuse italienne célèbre pour avoir fourni du poison aux femmes qui voulaient se débarrasser de leurs maris encombrants ou mariées de force.
Giulia Tofana, également orthographié Toffana ou Tophana (Palerme), morte exécutée à Rome en juillet 1659, est une empoisonneuse italienne célèbre pour avoir fourni du poison aux femmes qui voulaient se débarrasser de leurs maris encombrants ou mariées de force.
Le poison Aqua Tofana lui est attribué.
Elle est la fille de Thofania d'Adamo, qui a été exécutée à Palerme le 12 juillet 1633, accusée d'avoir assassiné son mari François.
Giulia Tofana est décrite comme une belle femme qui, ayant passé beaucoup de temps avec les apothicaires, a pu mettre au point son propre poison, l'« Aqua Tofana ».
Cependant, il est également possible que ce soit sa mère, Thofania d'Adamo, qui ait élaboré le poison et ait transmis la recette à sa fille. Giulia Tofana a commencé à fournir ce poison aux femmes qui souhaitent devenir des veuves.
Sa fille, Girolama Spera, a également été active dans ce domaine.
Giulia Tofana est estimée pour son attachement au statut de la femme.
Elle fournit son poison aux femmes prises au piège de mariages forcés.
L'activité de Giulia Tofana est révélée aux autorités papales par un mari ayant survécu à l'empoisonnement.
Cependant Giulia Tofana, est si populaire qu'elle est protégée et trouve refuge dans une église, mais lorsqu'une rumeur circulant à Rome affirme qu'elle a empoisonné l'eau, la police fait irruption dans l'église et l'arrête.
Giulia Tofana justifie ses actions en déclarant que sa concoction aide les veuves déprimées et opprimées.
Torturée, elle avoue le meurtre par poison entre 1633 et 1651, de 600 hommes dans la seule ville de Rome.
Néanmoins cela ne peut être confirmé avec certitude en raison d'aveux obtenus sous la torture et de la généralisation de la diffusion du poison par d'autres sources.
Giulia Tofana est finalement exécutée à Rome en juillet 1659 au Campo de' Fiori avec sa fille Girolama Spera, connue comme l'« Astrologa della Lungara », ainsi que trois apprenties.
Après sa mort, son corps est jeté par-dessus le mur de son église refuge.
Certains utilisateurs et fournisseurs sont également arrêtés et exécutés, tandis que d'autres complices sont enfermés dans les cachots du palais Pucci.
Les références concernant une prétendue exécution à Naples en 1719 sont incorrectes.
La légende que Wolfgang Amadeus Mozart aurait été empoisonné à l'aide de l'Aqua Tofana est infondée.
Giulia Tofana est dans de nombreuses sources confondue avec Hieronyma Spara, La Spara, une femme exerçant à la même époque, la même activité en Italie et à qui l'on donnait également le nom d'« Astrologa della Lungara ».
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Giulia Tofana
Godefroy de Bouillon 1058 - 1100
 Godefroy de Bouillon, né vers 1058 et mort le 18 juillet 1100 à Jérusalem, est un chevalier franc, duc de Basse-Lotharingie.
Godefroy de Bouillon, né vers 1058 et mort le 18 juillet 1100 à Jérusalem, est un chevalier franc, duc de Basse-Lotharingie.
Premier souverain du royaume de Jérusalem au terme de la première croisade, il refuse le titre de roi pour celui, plus humble, d'avoué du Saint-Sépulcre.
Fils de sainte Ide de Boulogne, héritier des ducs de Basse-Lotharingie, et d'Eustache II, comte de Boulogne, du royaume de France, Godefroy de Bouillon est un descendant de Charlemagne et, comme son illustre ancêtre, un personnage de légende.
Il appartient à un clan de ducs, comtes et évêques, à un groupe aristocratique qui gouverne la Lotharingie depuis 950 au moins.
Il est dit membre de la maison de Boulogne, or, son premier ancêtre ayant porté le titre de comte de Boulogne est Adalolphe de Boulogne, fils de Baudouin II de Flandre, lui-même fils de Baudouin Ier de Flandre.
Il n'y a pas de changement dynastique, et fait donc partie de la Maison de Flandre.
On ne connaît pas avec certitude le lieu de naissance de Godefroy de Bouillon ; les thèses hésitent entre Boulogne-sur-Mer en France et Baisy-Thy en Belgique.
Son éducation de chevalier est assurée par son oncle Godefroy III le Bossu à Bouillon (Belgique).
À la mort de ce dernier, il hérite de ses titres.
Toutefois, si l'empereur d'Allemagne lui concède le marquisat d’Anvers (1076), il lui interdit, en tant que roi de Germanie, le titre de duc de Basse-Lotharingie comme le souhaitait son oncle dans son testament.
Godefroy se range néanmoins fidèlement au côté d'Henri IV dans la lutte d'Investiture qui oppose l'empereur germanique et le pape Grégoire VII, et entre dans Rome les armes à la main.
Pour le récompenser de ses fidèles et loyaux services, l'empereur germanique le reconnaît finalement duc de Basse-Lotharingie vraisemblablement en 1087.
Il règne donc désormais sur un duché s'étendant sur ce qui deviendra le duché de Brabant, le comté de Hainaut, le duché de Limbourg, le comté de Namur, le duché de Luxembourg et une partie du comté de Flandre.
Mais étant tombé gravement malade peu après cette expédition à Rome, il fait vœu, pour réparer ses torts, d'aller défendre les chrétiens en Orient.
En 1095, le nouveau pape Urbain II appelle à la croisade pour libérer Jérusalem et venir à l'aide de l'Empire byzantin qui est l'objet d'attaques musulmanes.
Godefroy de Bouillon est l'un des premiers à répondre à cet appel, convaincu par le prédicateur itinérant Pierre l'Ermite.
Vassal de l'empereur Henri IV (constamment en conflit avec le pape) et grand féodal à l'autorité bien assise, on ignore tout des raisons profondes qui l'ont poussé à tenter cette aventure vers l'inconnu alors que ses terres reçues en héritage sont convoitées : ferveur religieuse, Godefroy étant marqué par le renouveau monastique et la réforme clunisienne qui a pénétré en Basse-Lotharingie ?
Dispute avec Henri IV qui doute désormais de sa loyauté ?
Toujours est-il qu'il devient l'un des principaux chefs de la première croisade.
Pour financer son départ, il hypothèque le château de Bouillon à Otbert, prince-évêque de Liège, et celui de Stenay au prince-évêque de Verdun.
Le départ a lieu le 15 août 1096, accompagné d'une suite nombreuse.
Godefroy est rejoint par ses frères Eustache et Baudouin.
Ceux-ci ne sont pas les seuls nobles à s'engager.
Raymond IV de Toulouse, également connu sous le nom de Raymond de Saint-Gilles, a créé la plus grande armée.
À l'âge de 55 ans, Raymond est aussi le plus ancien et peut-être le plus connu des seigneurs croisés.
En raison de son âge et de sa renommée, Raymond est le chef de la croisade.
Adhémar de Monteil, évêque du Puy et légat du pape, voyage avec lui.
Il y a aussi l'ardent Bohémond de Tarente, un chevalier normand qui a formé un petit royaume dans le Sud de l'Italie, et un quatrième groupe conduit par Robert II de Flandre.
Chacune de ces armées voyage séparément, certains vont au sud-est, à travers l'Europe et la Hongrie et d'autres traversent la mer Adriatique de l'Italie méridionale.
Godefroy, et ses frères, seraient partis le 15 août 1096.
L'armée passe par Ratisbonne, Vienne, Belgrade et Sofia, le long de la route Charlemagne, comme Urbain II semble l'avoir appelée (selon le chroniqueur Robert le Moine).
Après quelques difficultés en Hongrie, ils arrivent à Constantinople, capitale de l'Empire byzantin, en novembre.
Le pape a, en fait, appelé à la croisade afin d'aider l'empereur byzantin Alexis Ier Comnène à combattre les Turcs musulmans qui ont envahi ses terres d'Asie mineure et de Perse.
L'armée de Godefroy arrive la deuxième, après celle d'Hugues Ier de Vermandois.
Les autres armées croisées arrivent les mois suivants.
Si bien que l'empereur byzantin se retrouve avec une armée d'environ 4 000 à 8 000 chevaliers et 25 000 à 55 000 fantassins qui campent devant sa porte.
L'empereur byzantin voudrait que les croisés l'aident à reconquérir les terres dont se sont emparés les Turcs seldjoukides.
Les croisés ont pour objectif principal de libérer la Terre sainte des musulmans et d'y établir une domination chrétienne.
Pour eux, le problème d'Alexis Ier n'est qu'un contretemps.
Au fur et à mesure de leur arrivée, l'empereur byzantin demande aux croisés de lui prêter serment de loyauté, Godefroy et ses chevaliers conviennent d'une version allégée de ce serment, et promettent seulement de l'aider à retrouver ses territoires perdus.
Au printemps 1097 les croisés sont prêts à engager la bataille, après avoir longuement négocié avec l'empereur la traversée du Bosphore.
Ils pénètrent en Asie, pour reconquérir Nicée occupée par les Turcs depuis 1085.
Pour parvenir jusque-là, Godefroy de Bouillon fait élargir la route reliant Nicomédie à Nicée et l’empereur Alexis Ier Comnène s’engage à assurer un ravitaillement régulier.
Après une étape à Nicomédie du 1er au 3 mai 1097, le 4 mai les croisés s'avancent vers Nicée. La ville est atteinte le 6 mai.
Godefroy s'installe au nord, Bohémond de Tarente à l'est, et Raymond de Saint-Gilles, arrivé le 16 mai, au sud. Le siège de Nicée peut commencer.
Cependant, lorsque la ville est sur le point d'être prise, les Turcs font le choix de se rendre aux Byzantins et les croisés sont surpris, sinon déçus, de découvrir le 26 juin le drapeau byzantin flottant sur la ville qu'ils s'apprêtaient à attaquer.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Godefroy de Bouillon
Abd al-Rahman al-Soufi 903 - 986
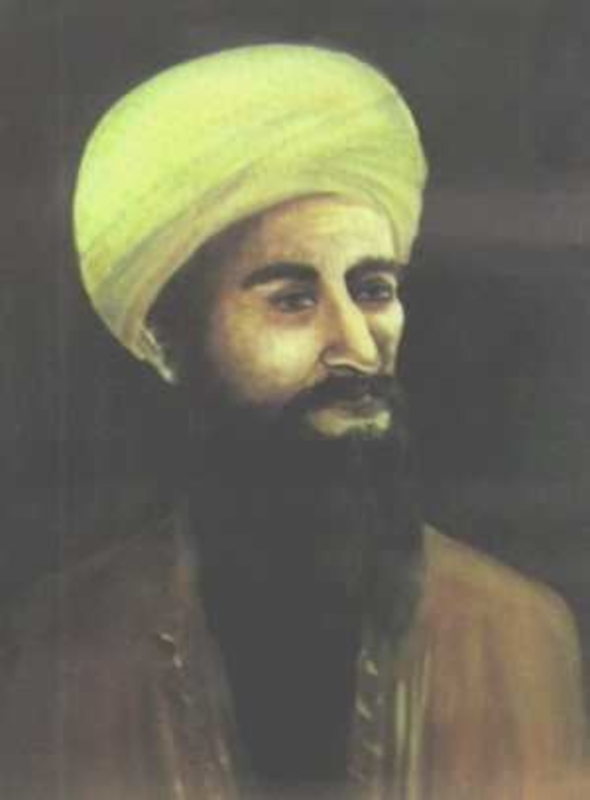 Abd al-Rahman al-Soufi, également connu sous les noms d'Abd ar-Rahman as-Soufi, Abd al-Rahman Abu al-Husein, et Azophi en Occident, né le 7 décembre 903 à Ray (Téhéran) et mort le 25 mai 986 à Chiraz, est un astronome et horloger persan.
Abd al-Rahman al-Soufi, également connu sous les noms d'Abd ar-Rahman as-Soufi, Abd al-Rahman Abu al-Husein, et Azophi en Occident, né le 7 décembre 903 à Ray (Téhéran) et mort le 25 mai 986 à Chiraz, est un astronome et horloger persan.
Il vécut à la cour de l'émir Adud ad-Daula à Ispahan en Perse.
Il traduisit et développa des ouvrages en grec traitant d'astronomie, tout particulièrement l'Almageste de Ptolémée.
Il est à l'origine de plusieurs améliorations du catalogue stellaire de Ptolémée et ses estimations des brillances et des magnitudes apparentes des étoiles diffèrent fréquemment de celles de Ptolémée.
Il découvrit le Grand Nuage de Magellan, visible au Yémen mais pas à Ispahan : le premier Européen à pouvoir le contempler fut Magellan au cours de son voyage au XVIe siècle.
Il semble être le premier à avoir rapporté l'observation de la Galaxie d'Andromède M31.
Il fut un grand traducteur arabe de l'astronomie grecque antique dont le centre fut Alexandrie, le premier à tenter de faire correspondre les noms grecs et arabes traditionnels des étoiles et des constellations qui ne se superposaient pas.
Il remarqua que le plan de l'écliptique était incliné par rapport à l'équateur céleste et il calcula plus précisément la durée de l'année tropique.
Il observa et décrivit les étoiles, leur position, leur magnitude apparente, leur couleur, parcourant le ciel constellation par constellation.
Pour chacune d'entre elles, il dessina deux croquis : la constellation vue de l'extérieur du globe céleste, puis la même vue de l'intérieur du globe céleste, comme elle peut être observée de la surface de la Terre. Al Sufi trouva de nombreuses utilisations innovantes de l'astrolabe.
Al Sufi publia son fameux Livre des étoiles fixes en 964, qui reprend la plupart de son œuvre sous forme de textes illustrés.
Le cratère Azophi sur la Lune porte son nom.
Le 24 septembre 1960, Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld et Tom Gehrels ont découvert l'astéroïde (12621) Alsufi, qu'ils ont nommé d'après al-Soufi.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Abd al-Rahman al-Soufi
Al-Biruni 973 - 1050
 Al-Biruni, Afzal Muḥammad ibn Aḥmad Abu al-Rehan (né le 4 ou le 15 septembre 973 à Kath, Khwarezm, Grand Iran — ville de l'actuel Ouzbékistan, mort le 13 décembre 1048 ou vers 1052 à Ghazni) est un érudit persan.
Al-Biruni, Afzal Muḥammad ibn Aḥmad Abu al-Rehan (né le 4 ou le 15 septembre 973 à Kath, Khwarezm, Grand Iran — ville de l'actuel Ouzbékistan, mort le 13 décembre 1048 ou vers 1052 à Ghazni) est un érudit persan.
Mathématicien, astronome, physicien, encyclopédiste, philosophe, astrologue, voyageur, historien, pharmacologue et précepteur, il contribua grandement aux domaines des mathématiques, philosophie, médecine et des sciences.
Il est connu pour avoir étudié la thèse de la rotation de la Terre autour de son axe et sa révolution autour du Soleil.
Il est né dans un faubourg de Kath, au Khwarezm, actuellement en Ouzbékistan, près de l'actuelle Ourguentch.
Son nom vient du persan birun : extérieur, faubourg (de Kath). Son village a été renommé Beruni d'après lui. Il étudia les mathématiques et l'astronomie sous Abu Nasr Mansur.
Il fut un collègue du philosophe et médecin Avicenne et de l'historien, philosophe et éthicien Miskawayh, dans une université et un établissement de science établi par le prince Abu Abbas Ma'mun Khawarazmshah.
Il fit partie de la suite de Mahmûd de Ghaznî lors de ses campagnes en Inde.
Il apprit le sanskrit, l'hindi et plusieurs dialectes, puis s'initia à l'histoire, la religion et la philosophie et les coutumes de ce sous-continent.
Il en tira la matière d'une Histoire de l'Inde (Kitab fi Tahqiq ma li'l-Hind), très estimée.
Il connaissait aussi le grec, et probablement le syriaque. Il écrivait en persan et en arabe.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Al-Biruni
Alexandre Dumas (père) 1802 - 1870
 Alexandre Dumas (dit aussi Alexandre Dumas père) est un écrivain français né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts (Aisne) et mort le 5 décembre 1870 au hameau de Puys, ancienne commune de Neuville-lès-Dieppe, aujourd'hui intégrée à Dieppe (Seine-Maritime).
Alexandre Dumas (dit aussi Alexandre Dumas père) est un écrivain français né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts (Aisne) et mort le 5 décembre 1870 au hameau de Puys, ancienne commune de Neuville-lès-Dieppe, aujourd'hui intégrée à Dieppe (Seine-Maritime).
Il est le fils de Marie-Louise Labouret (1769-1838) et Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie (1762-1806) (né à Saint-Domingue, actuelle Haïti) dit le général Dumas, et le père des écrivains Henry Bauër et Alexandre Dumas (1824-1895) dit « Dumas fils », auteur de La Dame aux camélias.
Proche des romantiques et tourné vers le théâtre, Alexandre Dumas écrit d'abord un vaudeville à succès et des drames historiques comme Henri III et sa cour (1829), La Tour de Nesle (1832), Kean (1836).
Auteur prolifique, il s'oriente ensuite vers le roman historique tel que la trilogie Les Trois Mousquetaires (1844), Vingt Ans après (1845) et Le Vicomte de Bragelonne (1847), ou encore Le Comte de Monte-Cristo (1844-1846), La Reine Margot (1845) et La Dame de Monsoreau (1846).
La paternité de certaines de ses œuvres lui est contestée. Dumas fut ainsi soupçonné par plusieurs critiques de son époque d'avoir eu recours à des prête-plume, notamment Auguste Maquet.
Toutefois les recherches contemporaines ont montré que Dumas avait mis en place une coopération avec ce dernier : Dumas s'occupait de choisir le thème général et modifiait les ébauches de Maquet pour les rendre plus dynamiques.
On ne peut donc lui nier la paternité de son œuvre, même s'il n'aurait peut-être pas pu réaliser tous ses chefs-d'œuvre des années 1844-1850 sans la présence à ses côtés d'un collaborateur à tout faire efficace et discret.
L'œuvre d'Alexandre Dumas est universelle ; selon l’Index Translationum, avec un total de 2 540 traductions, il vient au treizième rang des auteurs les plus traduits en langue étrangère.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Alexandre Dumas
Lucy (australopitheque)Moins 3,18 millions d'années
Moins 3virgule18 millions d'annees.jpg) Lucy, parfois écrit Dinknesh, est le surnom donné au fossile de l'espèce éteinte Australopithecus afarensis découvert en 1974 sur le site de Hadar, en Éthiopie, par une équipe de recherche internationale.
Lucy, parfois écrit Dinknesh, est le surnom donné au fossile de l'espèce éteinte Australopithecus afarensis découvert en 1974 sur le site de Hadar, en Éthiopie, par une équipe de recherche internationale.
Ce fossile est daté de 3,18 millions d'années.
Lucy constitue le premier fossile relativement complet (conservé à 40 %, avec 52 fragments osseux) qui ait été découvert pour une période aussi ancienne,
et a révolutionné notre perception des origines humaines, en démontrant que l’acquisition de la bipédie datait d'au moins 3,2 millions d’années,
et avait largement précédé le processus d'accroissement du volume endocrânien.
Lucy a été découverte le 24 novembre 1974 à Hadar, sur les bords de la rivière Awash, dans le cadre de l'International Afar Research Expedition fondée par Maurice Taieb,
un projet regroupant une trentaine de chercheurs éthiopiens, américains et français, codirigé par Donald Johanson (paléoanthropologue), Maurice Taieb (géologue) et Yves Coppens (paléontologue).
Le premier fragment du fossile a été repéré par Donald Johanson et Tom Gray, l'un de ses étudiants, sur le versant d'un ravin.
Un monument commémoratif a été construit en ce lieu (11° 08′ 10″ N, 40° 36′ 00″ E), en forme de table d'orientation portant un texte en trois langues, amharique, afar et anglais.
Lucy a été décrite une première fois en 1976 mais son rattachement à l'espèce Australopithecus afarensis n'a été proposé qu'en 1978 quand Donald Johanson a récupéré la mandibule d'un fossile découvert à Laetoli, en Tanzanie, à 1500 kilomètres du fossile de Lucy mais jugé assez comparable pour lui être rattachée.
En 1992, la reconstitution du visage de Lucy est confirmée par découverte d'un crâne de mâle adulte.
En 2000, c'est le squelette d'un enfant de 3 ans,
surnommé bientôt bébé de Lucy quoiqu'il soit cent mille ans plus vieux, qui confirme la coexistence des caractères simiens et humains.
Répertorié sous le nom de code AL 288-1, ce fossile a été surnommé Lucy parce que les chercheurs écoutaient la chanson des Beatles Lucy in the Sky with Diamonds le soir sous la tente, en répertoriant les ossements qu'ils avaient découverts.
Il est appelé Dinqnesh en amharique (Éthiopie), ce qui signifie « tu es merveilleuse ».
Source Wikipédia: Lucy
Andrew Wiles 1953 -
 Andrew John Wiles (né le 11 avril 1953 à Cambridge, Angleterre) est un mathématicien britannique, professeur à l'université d'Oxford, en Angleterre.
Andrew John Wiles (né le 11 avril 1953 à Cambridge, Angleterre) est un mathématicien britannique, professeur à l'université d'Oxford, en Angleterre.
Il est célèbre pour avoir démontré le grand théorème de Fermat (1994).
Il est lauréat du prix Abel 2016.
Après avoir obtenu son diplôme de bachelor au Merton College de l'université d'Oxford, il entre au Clare College en 1974 pour y préparer un Ph.D. en mathématiques sur les lois de réciprocité et la conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer, qu'il obtient en 1979.
Il devient professeur à Princeton en 1981, poste qu'il conserva jusqu'en 2011.
Il enseigne, entre-temps, à l'École normale supérieure entre 1985 et 1986 et à Oxford de 1988 et 1990. Il retourne finalement à Oxford en 2011.
En ce qui concerne la démonstration par Wiles du dernier théorème de Fermat (en), l'odyssée commence en 1985, quand Kenneth Ribet, partant d'une idée de Gerhard Frey, démontre que ce théorème résulterait de la conjecture de Shimura-Taniyama-Weil qui affirme que toute courbe elliptique est paramétrable par une forme modulaire.
Bien que moins familière que le théorème de Fermat, cette conjecture est plus significative, car elle touche au cœur de la théorie des nombres.
Cependant, personne n'a la moindre piste de travail pour la démontrer. Travaillant dans le plus grand secret pendant huit ans, et faisant part de ses idées et progrès à Nicholas Katz, un collègue de Princeton, Wiles démontre la conjecture de Shimura-Taniyama-Weil et, par conséquent, le théorème de Fermat.
Comme toute démonstration de cette ampleur, elle est un tour de force riche en nouvelles idées.
Pour expliquer (par Wiles) et vérifier (par Katz), pas à pas, cette démonstration sans éveiller les soupçons, Wiles et Katz ont l'idée d'organiser un cours de doctorat intitulé Calculs sur des courbes elliptiques, ouvert aux étudiants et professeurs.
Peter Sarnak avait lui aussi été mis dans le secret.
Wiles annonce donc trois conférences (les 21, 22 et 23 juin 1993) sans en donner l'objet, ce qu'il ne fait que lors de la dernière en précisant que le grand théorème de Fermat est un corollaire de ses principaux résultats.
Dans les mois qui suivent, le manuscrit de sa démonstration circule auprès d'un petit nombre de mathématiciens.
Plusieurs critiques sont émises contre la démonstration que Wiles a présentée en 1993, presque toutes de l'ordre du détail et résolues rapidement, sauf une, qui met en évidence une lacune.
Avec l'aide de Richard Taylor, Wiles réussit à contourner le problème soulevé, en octobre 1994. Son travail met ainsi fin à une recherche qui a duré plus de 300 ans.
Il est aussi l'auteur d'autres travaux importants en théorie des nombres. Avec John Coates (qui fut son directeur de thèse), il a obtenu plusieurs résultats sur la conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer et a collaboré avec Barry Mazur sur les extensions cyclotomiques.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Andrew Wiles
Daniel Tammet
 Daniel Tammet (né Daniel Paul Corney, le 31 janvier 1979 à Barking) est un écrivain, poète et hyperpolyglotte anglais, chez qui on a diagnostiqué une épilepsie dans l'enfance, puis le syndrome d'Asperger à l'âge adulte.
Daniel Tammet (né Daniel Paul Corney, le 31 janvier 1979 à Barking) est un écrivain, poète et hyperpolyglotte anglais, chez qui on a diagnostiqué une épilepsie dans l'enfance, puis le syndrome d'Asperger à l'âge adulte.
Il s'est fait connaître par sa synesthésie, à l'origine de ses capacités de mémoire. Le 14 mars 2004, il récite les 22 514 premières décimales de Pi en 5 heures, 9 minutes et 24 secondes, établissant un nouveau record européen.
Daniel Tammet est l'aîné d'une fratrie de neuf enfants, et vit une enfance très modeste dans le Sud de l'Angleterre.
Il souffre de crises d'épilepsie à l'âge de 3 ans (crises aujourd'hui définitivement guéries) qui sont sans doute à l'origine de sa synesthésie.
Il est diagnostiqué autiste Asperger à l'âge de 25 ans, au centre de Recherche sur l'Autisme de l'université de Cambridge, par Simon Baron-Cohen.
Il a la particularité d'avoir à la fois développé des capacités de communication proches de la norme, ainsi que des aptitudes singulières dans les domaines des nombres et des langues.
Les nombres vont l'aider d'abord à surmonter les épreuves qu'il rencontre à cause de sa différence — rejet des autres, incompréhension du monde qui l'entoure et des règles sociales, hypersensibilité au bruit.
Il s'exprime ainsi au sujet des nombres : « ils me calment et me rassurent. Enfant, mon esprit se promenait en paix dans ce paysage numérique où il n'y avait ni tristesse, ni douleur. »
Jeune garçon, il est fasciné par la magie des nombres premiers, puis à l'adolescence il s'adonne au calcul calendaire, qui permet de trouver en un instant le jour de la semaine correspondant à n'importe quelle date de naissance.
Il développe également une passion et des facultés extraordinaires pour les langues étrangères, qu'il assimile plus rapidement grâce à sa synesthésie; il en connaît une dizaine : l'anglais, le français, l'islandais, l'allemand, l'espagnol, l'espéranto, le finnois, le gallois, le lituanien et le roumain.
Daniel Tammet s'invente une langue personnelle appelée mänti.
Il devient professeur d'anglais à l'âge de dix-neuf ans en Lituanie, puis crée en 2002 son propre site Internet d'apprentissage des langues (français et espagnol) appelé Optimnem qui connaît un beau succès.
Le 14 mars 2004, au musée de l'histoire des sciences d'Oxford, il récite en 5 heures, 9 minutes et 24 secondes 22 514 décimales de Pi, apprises au cours des trois mois précédant l'événement.
C'est un record européen qui le propulse sur la scène médiatique : il fait l'objet d'un documentaire qui lui est entièrement consacré : L'homme ordinateur, version française du documentaire britannique, dans lequel il relève un nouveau défi, linguistique cette fois : apprendre l'islandais en une semaine et répondre à un entretien en direct à la TV dans cette langue.
Le défi est relevé haut la main.
On y voit aussi sa rencontre avec un autre autiste, Kim Peek, doté d'une mémoire eidétique.
La chanteuse Kate Bush a été inspirée par cet événement et en a tiré une chanson de son album Aerial : π.
En 2009, il s'installe à Avignon avec son compagnon Jérôme Tabet, puis à Paris, où il est écrivain à plein temps. Le 16 mars 2010, Daniel Tammet est invité par L'Express à poser pour une photographie réunissant les auteurs les plus lus de 2009.
Depuis, il a été l'invité à deux reprises de l'émission La Grande Librairie sur France 5, d'abord en 2017 pour Chaque mot est un oiseau à qui l'on apprend à chanter, puis en 2020 pour Fragments de paradis.
François Busnel dit de lui : « Ce que j'admire chez vous, c'est votre attirance aussi bien pour la poésie que pour les neurosciences ou la sociolinguistique. »
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Daniel Tammet
Dr. Robert H. Goddard 1882 - 1945
 Robert Hutchings Goddard (5 octobre 1882 – 10 août 1945) est un ingénieur et physicien américain.
Robert Hutchings Goddard (5 octobre 1882 – 10 août 1945) est un ingénieur et physicien américain.
Précurseur en astronautique, il a mis au point, dans la première moitié du XXe siècle, un des premiers prototypes de fusées à ergols liquides.
Il invente également en 1926 le premier Moteur-fusée à ergols liquides.
Goddard naît le 5 octobre 1882 à Worcester dans l'État du Massachusetts, de Nahum Danford Goddard (1859-1928) et Fannie Louise Hoyt (1864-1920). Robert est leur seul fils.
Au temps ou l'électricité faisait ses débuts dans les villes des États-Unis, le jeune Goddard s'intéresse aux sciences.
Son père lui montre comment produire de l'électricité statique sur la carpette du salon, cette expérience stimule l'imagination du garçon de cinq ans.
Goddard s'intéresse au vol, d'abord les cerfs-volants, puis les ballons.
Il s'applique déjà à très bien documenter son travail et ses expériences, une qualité qui lui sera très utile tout au long de sa carrière.
Ces différents intérêts convergent vers 1898, lorsque Goddard construit, chez lui, un ballon avec une membrane d'aluminium.
Cinq semaines plus tard, après un travail méthodique et bien documenté il abandonne le projet.
Cet échec n'affecte toutefois aucunement la détermination et la confiance que Goddard possède déjà vis-à-vis ses travaux.
À cette même époque, il s'intéresse de plus en plus à l'espace, après la lecture du fameux roman de science fiction La Guerre des mondes de H.G. Wells.
Il raconte lui-même que cette idée se fixa en lui le 19 octobre, alors qu'il travaillait à l'émondage d'un cerisier.
Une pensée lui traverse alors l'esprit :
« Ne serait-il pas merveilleux, de pouvoir fabriquer un appareil pouvant se rendre sur Mars, je l'imagine ici dans cette vallée à une petite échelle ».
Jusqu'à la fin de sa vie, il commémorera cette date, anniversaire de sa plus grande inspiration.
Goddard avait une santé fragile ; des problèmes de santé liés à son estomac ont fait en sorte qu'il prend deux ans de retard sur ses camarades de classe.
Il devient un lecteur vorace, et visite fréquemment les bibliothèques publiques pour y emprunter plusieurs livres sur les sciences physiques.
Plus tard, il continue ses études et à l'âge de 18 ans, il fait sa dixième année scolaire à l'école secondaire de Worcester. Ses pairs l'ont alors élu deux fois président de sa classe.
En 1904 à sa graduation scolaire il donne le discours de fin de classe, ce privilège étant accordé à celui ayant obtenu les meilleurs notes.
C'est à l'occasion de ce discours qu'il prononce la phrase qui deviendra sa ligne de conduite pour le reste de sa vie : « Il a été souvent prouvé que les rêves d'hier, sont l'espoir d'aujourd'hui et la réalité de demain ».
Goddard est engagé en 1904, à l'Institut Polytechnique de Worcester. A. Wilmer Duff, le directeur du département de physique le remarque immédiatement pour son appétit de connaissance.
Le professeur Duff, le prend sous sa tutelle, Goddard devient son assistant de laboratoire.
Il continue ses activités sociales à Worcester.
Il joint la fraternité Sigma Alpha Epsilon, et commence une longue fréquentation avec Miriam Olsmstead, une étudiante de son école secondaire.
Cette fréquentation s'est toutefois terminée vers 1909.
Avant son doctorat, il écrit un article sur une méthode d'équilibre des aéroplanes publiée par la revue Scientific American en 1907.
Goddard écrira plus tard dans son journal personnel, qu'il croyait que cet article était la première proposition sur les façons d'équilibrer un avion en vol.
Cette proposition, arrive au même moment que certaines percées scientifiques sur le développement des fonctionnalités du gyroscope.
Goddard obtient son doctorat en physique de l'Institut de Polytechnique de Worcester en 1908. À l'automne de la même année il est engagé à l'Université Clark.
Ses premiers écrits sur la propulsion liquide des fusées arrivent en février 1909.
Goddard, à ce moment avait étudié les possibilités d'augmenter l'efficacité énergétique des fusées, en utilisant une méthode alternative à la méthode conventionnelle de l'époque, c'est-à-dire, les fusées utilisant la poudre.
Goddard reçoit une maîtrise des arts de l'Université Clark en 1910, puis il y complète un doctorat en Physique en 1911.
Il reçoit une bourse en 1912 et travaille pendant encore un an à l'université avant de passer à l'université de Princeton pour y travailler grâce à une autre bourse d'étude.
La radio au début des années 1900 était une technique émergente, un champ d'activité fertile à l'exploration et l'innovation.
En 1911, pendant qu'il fréquente l'Université Clark, Goddard étudie les effets des ondes radio sur les isolants.
Afin de produire une puissance capable de produire une onde radio, il invente un tube à vide qui agit comme un tube cathodique : c'est la première utilisation d'un tel tube afin d'amplifier un signal, devançant celle de Lee De Forest.
Ce fait signale le début de l'ère électronique.
Au début 1913, Goddard, atteint de tuberculose, abandonne son travail à Princeton.
Il retourne à Worcester, où il commence une longue convalescence.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Robert Goddard
Richard Phillips
Voir : Le trailer du film sur la prise d'otages du Maersk Alabama en 2009 (Capitaine Phillips) (2013)
 Richard Phillips (born May 16, 1955) is an American merchant mariner and author who served as captain of the MV Maersk Alabama during its hijacking by Somali pirates in April 2009.
Richard Phillips (born May 16, 1955) is an American merchant mariner and author who served as captain of the MV Maersk Alabama during its hijacking by Somali pirates in April 2009.
Early life and education
Of Irish descent, Phillips was born in Massachusetts, and graduated from Winchester High School in 1973.
Phillips enrolled at the University of Massachusetts Amherst and planned to study international law but transferred to the Massachusetts Maritime Academy, from which he graduated in 1979.
During his schooling, Phillips worked as a taxi driver in Boston.
Career
Maersk Alabama hijacking
On April 7, 2009, the U.S. Maritime Administration, following NATO advisories, released a Somalia Gulf of Aden "advisory to mariners" recommending ships to stay at least 600 nautical miles (1,100 km; 690 mi) off Somalia's coast of east Africa.
With these advisories in effect, on April 8, 2009, four Somali pirates boarded the Maersk Alabama when it was located around 300 nmi (560 km) southeast of the Somalian port city of Eyl.
With a crew of 20, the ship departed from Salalah, Oman en route to Mombasa, Kenya. The ship was carrying 17,000 metric tons of cargo, of which 5,000 metric tons were relief supplies bound for Kenya, Somalia, and Uganda.
"In that area of the world, any blip on your radar is of concern," said Phillips, "I always told my crew it was a matter of when, not if."
According to Chief Engineer Mike Perry, the crew sank the pirate speedboat shortly after the boarding by continuously swinging the rudder of the Maersk Alabama, thus swamping the smaller boat.
As the pirates were boarding the ship, the crew members locked themselves in the engine room.
The crew later overpowered one of the pirates. The crew attempted to exchange the captured pirate, whom they had kept tied up for twelve hours, for Phillips.
According to a crew member, Phillips and the pirates got into the ship's rescue boat, but it would not start, so the crew dropped a lifeboat and met the pirates to switch prisoners and boats.
The captured pirate was released, but the pirates left with Phillips in the lifeboat before the crew could take action.
The lifeboat was carrying ten days of food rations, water, and basic survival supplies.
On April 8, the destroyer USS Bainbridge and the frigate USS Halyburton were dispatched to the Gulf of Aden in response to the hostage situation, and reached Maersk Alabama early on April 9.
Maersk Alabama then departed from the area with an armed escort, towards its original destination of the port of Mombasa.
On Saturday, April 11, Maersk Alabama arrived in Mombasa, still under U.S. military escort. Captain Larry Aasheim then assumed command.
Aasheim had previously been captain of the Maersk Alabama until Richard Phillips relieved him eight days prior to the pirate attack.
An 18-man marine security team was on board. The U.S. Federal Bureau of Investigation secured the ship as a crime scene.
On April 9, a standoff began between the Bainbridge and the pirates in the Maersk Alabamas lifeboat, where they continued to hold Phillips hostage.
Three days later, on Sunday, April 12, U.S. Navy marksmen from DEVGRU (formerly known as SEAL Team Six) opened fire and killed the three pirates on the lifeboat, and Phillips was rescued.
The Bainbridge captain Commander Frank Castellano ordered the action after determining that Phillips' life was in immediate danger, based on reports that a pirate was pointing an AK-47 automatic rifle at his back Navy SEAL snipers on Bainbridge's fantail opened fire, killing the three pirates with bullets to the head;
one of the pirates was named Ali Aden Elmi, another's last name was Hamac, and the third remains unidentified. A fourth pirate, Abduwali Muse, aboard the Bainbridge and speaking with military negotiators while being treated for an injury sustained in the takeover of Maersk Alabama, surrendered and was taken into custody. He later pleaded guilty to hijacking, kidnapping and hostage-taking charges and was sentenced to over 33 years in prison.
Aftermath
Following the hijacking, Phillips published A Captain's Duty: Somali Pirates, Navy SEALS, and Dangerous Days at Sea. Columbia Pictures optioned the book and acquired the film rights in spring 2010.
In March 2011, it was announced that Tom Hanks would star as Phillips, Barkhad Abdi as Abduwali Muse and Faysal Ahmed as Najee in a Sony Pictures film based on the hijacking and Phillips' book, scripted by Billy Ray, and produced by the team behind The Social Network.
The film, titled Captain Phillips, was released on October 11, 2013 and had its premiere showing at the 2013 New York Film Festival.
NDLR : La suite sur Wikipédia. (ENG)
Source Wikipédia: (ENG) Richard Phillips (merchant mariner)
Source FR: Prise d'otages du Maersk Alabama
Source FR: Somalie le calvaire du captain phillips toujours une realite pour les marins otages oublies
Source FR: Rencontre avec le vrai capitaine Phillips
Benito Mussolini 1883 - 1945
 Benito Mussolini, né le 29 juillet 1883 à Predappio et mort le 28 avril 1945 à Giulino di Mezzegra, est un journaliste, idéologue et homme d'État italien.
Benito Mussolini, né le 29 juillet 1883 à Predappio et mort le 28 avril 1945 à Giulino di Mezzegra, est un journaliste, idéologue et homme d'État italien.
Fondateur du fascisme, il est président du Conseil du royaume d'Italie, du 31 octobre 1922 au 25 juillet 1943, premier maréchal d'Empire du 30 mars 1938 au 25 juillet 1943, et chef de l'État de la République sociale italienne (RSI) de septembre 1943 à avril 1945.
Il est couramment désigné par le terme « Duce », mot italien dérivé du latin Dux et signifiant « Chef » ou « Guide ».
Il est d'abord membre du Parti socialiste italien (PSI) et directeur du quotidien socialiste Avanti! à partir de 1912.
Anti-interventionniste convaincu avant la Première Guerre mondiale, il change d'opinion en 1914, se déclarant favorable à l'entrée en guerre de l'Italie.
Expulsé du PSI en novembre 1914, il crée son propre journal, Il Popolo d'Italia (Le peuple d'Italie) qui prend des positions nationalistes proches de celles de la petite bourgeoisie.
Dans l'immédiate après-guerre, profitant du mécontentement de la « victoire mutilée », il crée le Parti national fasciste (PNF) en 1921 et se présente au pays avec un programme politique nationaliste, autoritaire, antisocialiste et antisyndical, ce qui lui vaut l'appui de la petite bourgeoisie et d'une partie des classes moyennes industrielles et agraires.
Dans le contexte de forte instabilité politique et sociale qui suit la Grande Guerre, il vise la prise du pouvoir en forçant la main aux institutions avec l'aide des paramilitaires squadristi et l'intimidation qui culminent le 28 octobre 1922 avec la marche sur Rome.
Mussolini obtient la charge de constituer le gouvernement le 30 octobre 1922.
En 1924, après la victoire contestée des élections et l'assassinat du député socialiste Giacomo Matteotti, Mussolini assume l'entière responsabilité de la situation.
La série de lois fascistissimes lui attribue, à partir de 1925, des pouvoirs dictatoriaux et fait de l'Italie un régime fasciste à parti unique.
Après 1935, il se rapproche du régime nazi d'Adolf Hitler avec qui il établit le Pacte d'acier (1939).
Convaincu d'un conflit à l'issue rapide, il entre dans la Seconde Guerre mondiale au côté de l'Allemagne nazie.
Les défaites militaires de l'Italie et le débarquement des Alliés sur le sol italien entraînent sa mise en minorité par le Grand Conseil du fascisme le 24 juillet 1943 : il est alors destitué et arrêté par ordre du roi.
Libéré par les Allemands, il instaure en Italie septentrionale la République sociale italienne.
Le 25 avril 1945, alors qu'il tente de fuir pour la Valteline déguisé en soldat allemand, il est capturé par un groupe de partisans.
Il est ensuite fusillé avec sa maîtresse Clara Petacci ; leurs corps sont livrés à une foule en colère et pendus par les pieds au carrefour de Piazzale Loreto, à Milan.
Fils du forgeron Alessandro Mussolini et de l'institutrice Rosa Maltoni, Benito naît le 29 juillet 1883 à Varani dei Costa, un hameau de la commune de Dovia di Predappio (aujourd'hui Predappio) dans la province de Forlì-Césène en Émilie-Romagne.
Les prénoms Benito Amilcare Andrea lui sont donnés par son père, socialiste à la limite de l'anarchisme, désireux de rendre hommage à Benito Juárez, héros libéral et républicain face à l'intervention française et ex-président du Mexique, à Amilcare Cipriani, patriote italien et socialiste, et à Andrea Costa, premier député socialiste élu au parlement italien.
Il a un frère, prénommé Arnaldo en hommage au moine révolutionnaire romagnol de Brescia et une sœur prénommée Edvige.
Alessandro Mussolini cherche à influencer son fils aîné par ses conversations avec lui, par les livres qu’il lui fait lire de bonne heure et par les textes que lui-même rédige pour les journaux socialistes locaux. Benito Mussolini dit à Yvon de Begnac :
« Mon socialisme est né bakouniste, à l’école du socialisme de mon père, à l’école du socialisme libertaire de Blanqui. »
Alessandro Mussolini avait l’habitude de lire à ses enfants des passages du Capital de Karl Marx.
Les enfants d'Alessandro Mussolini sont fiers de l’hospitalité que leur père offre depuis toujours aux militants socialistes recherchés par la police.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Benito Mussolini
Charlemagne (Carolus Magnus) 742 - 814
 Charlemagne, du latin Carolus Magnus, ou Charles Ier dit « le Grand », né à une date inconnue (vraisemblablement durant l'année 742, voire 747 ou 748, peut-être le 2 avril), mort le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle, est un roi des Francs et empereur.
Charlemagne, du latin Carolus Magnus, ou Charles Ier dit « le Grand », né à une date inconnue (vraisemblablement durant l'année 742, voire 747 ou 748, peut-être le 2 avril), mort le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle, est un roi des Francs et empereur.
Il appartient à la dynastie des Carolingiens. Fils de Pépin le Bref, il est roi des Francs à partir de 768, devient par conquête roi des Lombards en 774 et est couronné empereur à Rome par le pape Léon III le 24 ou 25 décembre 800, relevant une dignité disparue en Occident depuis la déposition, trois siècles auparavant, de Romulus Augustule en 476.
Roi guerrier, il agrandit notablement son royaume par une série de campagnes militaires, en particulier contre les Saxons païens dont la soumission fut difficile et violente (772-804), mais aussi contre les Lombards en Italie et les musulmans d'al-Andalus.
Souverain réformateur, soucieux d’orthodoxie religieuse et de culture, il protège les arts et lettres et est à l’origine de la « renaissance carolingienne ».
Son œuvre politique immédiate, l’Empire, ne lui survit cependant pas longtemps.
Se conformant à la coutume successorale germanique, Charlemagne prévoit dès 806 le partage de l’Empire entre ses trois fils.
Après de nombreuses péripéties, l’Empire ne sera finalement partagé qu’en 843 entre trois de ses petits-fils, lors du traité de Verdun.
Le morcellement féodal des siècles suivants, puis la formation en Europe des États-nations rivaux condamnent à l’impuissance ceux qui tentent explicitement de restaurer l’Empire d’Occident, en particulier les souverains du Saint-Empire romain germanique, d’Otton Ier en 962 à Charles Quint au XVIe siècle, voire Napoléon Ier, hanté par l’exemple du plus éminent des Carolingiens.
La figure de Charlemagne a été l’objet d’enjeux politiques en Europe, notamment entre le XIIe et le XIXe siècle entre la nation germanique qui considère son « Saint-Empire romain » comme le successeur légitime de l’empereur carolingien, et la nation française qui en fait un élément central de la continuité dynastique des Capétiens.
Charlemagne est parfois considéré comme le « Père de l’Europe » pour avoir assuré le regroupement d’une partie notable de l’Europe occidentale, et posé des principes de gouvernement dont ont hérité les grands États européens.
Les deux principaux textes du IXe siècle qui dépeignent le Charlemagne réel, la Vita Caroli d’Éginhard et la Gesta Karoli Magni attribuée à Notker le Bègue, moine de Saint-Gall, l’auréolent également de légendes et de mythes repris au cours des siècles suivants :
« Il y a le Charlemagne de la société vassalique et féodale, le Charlemagne de la Croisade et de la Reconquête, le Charlemagne inventeur de la Couronne de France ou de la Couronne impériale, le Charlemagne mal canonisé mais tenu pour vrai saint de l'Église, le Charlemagne des bons écoliers ».
Charlemagne est, par tolérance du pape Benoît XIV, un bienheureux catholique fêté localement le 28 janvier.
En effet, en 1165, l'empereur Frédéric Ier Barberousse obtient la canonisation de Charlemagne par l'antipape Pascal III.
De nombreux diocèses du nord de la France inscrivent alors Charlemagne à leur calendrier et, en 1661, l’université de Paris le choisit pour saint patron.
Aujourd’hui encore, la cathédrale d'Aix-la-Chapelle fait vénérer ses reliques.
Pourtant, l’Église catholique a retiré de son calendrier « l’empereur qui convertit les Saxons par l’épée plutôt que par la prédication pacifique de l’Évangile ».
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Charlemagne
Karl Marx 1818 - 1883
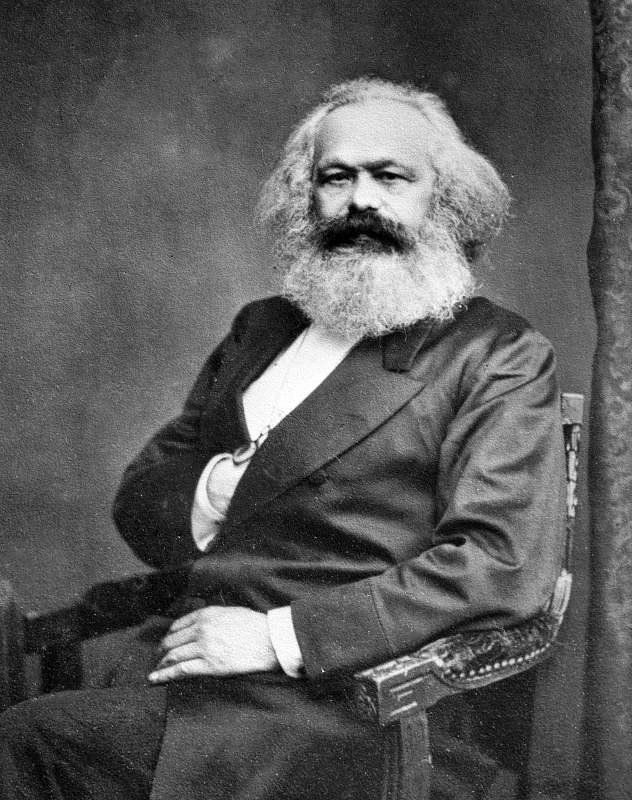 Karl Marx, né le 5 mai 1818 à Trèves dans le grand-duché du Bas-Rhin et mort le 14 mars 1883 à Londres, est un philosophe, historien, sociologue, économiste, journaliste, théoricien de la révolution, socialiste et communiste allemand.
Karl Marx, né le 5 mai 1818 à Trèves dans le grand-duché du Bas-Rhin et mort le 14 mars 1883 à Londres, est un philosophe, historien, sociologue, économiste, journaliste, théoricien de la révolution, socialiste et communiste allemand.
Il est connu pour sa conception matérialiste de l'histoire, son analyse des rouages du capitalisme et de la lutte des classes, et pour son activité révolutionnaire au sein du mouvement ouvrier.
Il a notamment été un des membres dirigeants de l'Association internationale des travailleurs (Première Internationale).
Des courants de pensée se revendiquant principalement des travaux de Marx sont désignés sous le nom de marxisme. Marx a eu une grande influence sur le développement ultérieur des sciences humaines et sociales.
Ses travaux ont marqué de façon considérable le XXe siècle, au cours duquel de nombreux mouvements révolutionnaires et intellectuels se sont réclamés de sa pensée.
Karl Heinrich Marx est né en 1818 à Trèves, dans le grand-duché du Bas-Rhin, au sein du royaume de Prusse (aujourd'hui dans le land de Rhénanie-Palatinat). Il est le deuxième d'une famille de huit enfants.
Son père, Heinrich Marx (1777-1838), né Herschel Marx Levi Mordechai, était un avocat issu d'une famille de rabbins juifs ashkénazes — le grand-père d'Heinrich, Meier Halevi Marx, était devenu rabbin à Trèves en 1723 et ses fils et petit-fils furent les premiers à recevoir une éducation séculière — et de marchands propriétaires de vignobles dans la vallée de la Moselle.
Pour exercer sa profession d'avocat, il se convertit au protestantisme en 1816 ou 1817, et changea son prénom de Herschel en Heinrich. Sa mère, Henriette Pressburg (20 juillet 1788-30 novembre 1863), est issue d'une famille juive hollandaise.
Restée attachée à la religion juive, elle ne se convertira au luthéranisme qu'en 1825, après la mort de son père, qui était rabbin. Elle est la grand-tante des frères Gerard Philips et Anton Philips (en), fondateurs de la société néerlandaise Philips.
Karl Marx est baptisé dans le luthéranisme en 1824 et confirmé à l'église de la Trinité de Trèves en 1834.
Bien que son père respecte la tradition juive en donnant à son fils le prénom de son grand-père, Karl Heinrich Mordechai, il n'est pas élevé de façon religieuse et il n'y a aucune preuve que la famille Marx ait pratiqué la religion luthérienne ou juive.
Il entre au Gymnasium Friedrich-Wilhelm de Trèves en 1830.
Après avoir obtenu son Abitur, il entre à l'université, d'abord à Bonn en octobre 1835 pour étudier le droit et reçoit un certificat de fin d'année avec mention de « l'excellence de son assiduité et de son attention », puis à Berlin à l'université Friedrich-Wilhelm à partir de mars 1836 où il se consacre davantage à l'histoire et à la philosophie.
Il finit ses études en 1841 par la présentation d'une thèse de doctorat : Différence de la philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure (Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie).
Marx est reçu in absentia docteur de la faculté de philosophie de l'université d'Iéna le 15 avril 1841.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Karl Marx
Louis Cailletet 1832 - 1913
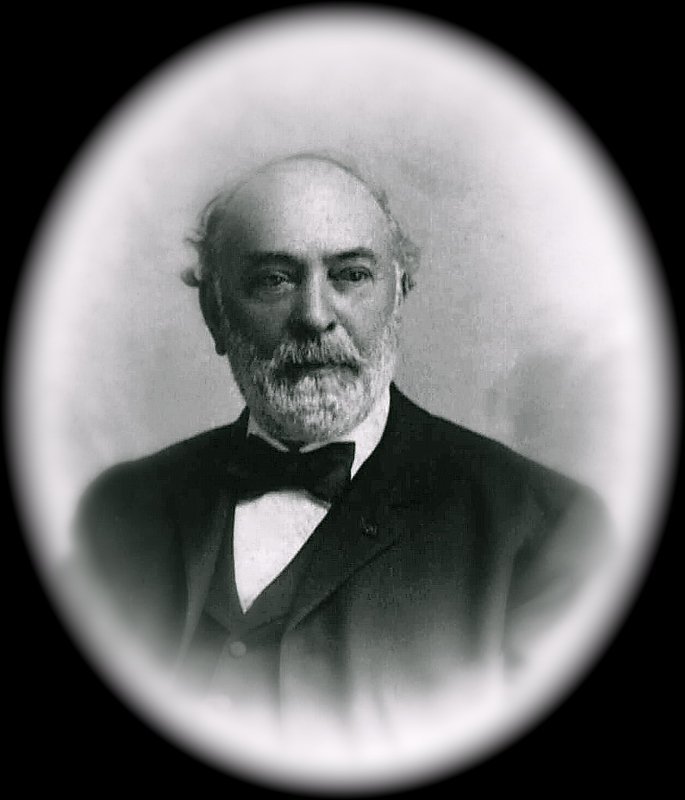 Louis Cailletet (né à Châtillon-sur-Seine le 21 septembre 1832, mort à Paris le 5 janvier 1913) est un chimiste et physicien français. Il a été le premier à liquéfier le dioxygène le 2 décembre 1877.
Louis Cailletet (né à Châtillon-sur-Seine le 21 septembre 1832, mort à Paris le 5 janvier 1913) est un chimiste et physicien français. Il a été le premier à liquéfier le dioxygène le 2 décembre 1877.
Officier de la Légion d'honneur (1889).
Après des études à Châtillon-sur-Seine et au lycée Henri IV à Paris, il entre comme auditeur libre, pour l'année 1852-1853, avec son frère Camille, à l'École des mines.
Dans les grands laboratoires de physique et de chimie de Paris, Louis Cailletet devient pendant ses études l'ami de nombreux savants, parmi les plus illustres de cette époque :
- au laboratoire de Chimie de la faculté des Sciences et de Pharmacie : Marcelin Berthelot du Collège de France,
- Henri Sainte Claire Deville chimiste à l’École normale,
- Jean Baptiste Dumas secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences,
- Jules-Célestin Jamin, professeur de physique à l’école Polytechnique.
Ces relations, dans le monde scientifique parisien, lui serviront par la suite.
À leurs sorties de l'école des Mines, Louis et Camille feront chacun des voyages d'études en Angleterre, en Allemagne et en Autriche pour visiter de nombreux hauts fourneaux et laminoirs, en 1854 et en 1855.
Louis malheureusement ne peut continuer, à son grand regret, les grandes études dont il rêve, son père Jean-Baptiste et son grand-père Claude-Phal Lapérouse vieillissent ; ils ont un besoin urgent de sa présence pour l'usine de Chenecières et le haut-fourneau de Villotte-sur-Ource.
La modernisation des installations et la surveillance des employés seront son premier travail comme ingénieur.
Tout en poursuivant ses recherches et ses contacts avec les plus grands chimistes parisiens (Berthelot, Sainte Claire Deville), il travaille aux côtés de son père Jean-Baptiste, maître de forges.
Louis commence par étudier la combustion des végétaux dans les fours ; il continue ses recherches en étudiant les propriétés physiques et chimiques du fer dans ses laboratoires de Villotte et Chenecières.
Sur l'emplacement d'un ancien haut fourneau, les Cailletet puis les Suquet installèrent des laminoirs entre 1855 et 1920.
Ce site industriel fut transformé par la famille Seytre en fabrique de chaînes pour l'agriculture et la marine à partir de 1930.
Il remarque alors sur les tôles des imperfections. Ce sont des cloques qu'on appelle « bouillies ».
Louis tente d'en recueillir les gaz occlus. Il constate qu'il s'agit, surtout, d'oxyde de carbone.
Poursuivant sa recherche, il se dit que cet oxyde de carbone doit provenir de la réduction, dans les fours, d'acide carbonique ; il doit pénétrer dans le métal par suite de la perméabilité de celui-ci à la température du rouge, « fait alors ignoré ».
Pour vérifier la présence d'oxyde de carbone dans les fours, il soutire du gaz de ce four par tube refroidi et constate que l'oxyde de carbone s'y trouve en abondance.
Pour montrer la perméabilité du métal à cet oxyde de carbone, il insère dans le four un canon de fusil fermé à une extrémité et dont l'autre extrémité sort du four et est fortement refroidie par un courant d'air.
Il constate que par cette dernière extrémité, il sort spontanément du gaz, qui, recueilli dans des éprouvettes et analysé, est bien de l'oxyde de carbone.
Une autre expérience ingénieuse a été de mettre dans le four un canon de fusil aplati au laminoir et bouché à ses deux extrémités.
Une fois porté au rouge, ce canon de fusil a repris sa forme circulaire sous la pression de l'oxyde de carbone qui pénétrait à travers ses parois.
La preuve était faite de la perméabilité du fer et de l'acier par l'oxyde de carbone à la température du rouge.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Louis Paul Cailletet
Martin Luther 1483 - 1546
 Martin Luther, né le 10 novembre 1483 à Eisleben, en Saxe-Anhalt et mort le 18 février 1546 dans la même ville, est un frère augustin théologien, professeur d'université, initiateur du protestantisme et réformateur de l'Église dont les idées exercèrent une grande influence sur la Réforme protestante, qui changea le cours de la civilisation occidentale.
Martin Luther, né le 10 novembre 1483 à Eisleben, en Saxe-Anhalt et mort le 18 février 1546 dans la même ville, est un frère augustin théologien, professeur d'université, initiateur du protestantisme et réformateur de l'Église dont les idées exercèrent une grande influence sur la Réforme protestante, qui changea le cours de la civilisation occidentale.
Préoccupé par les questions de la mort et du salut qui caractérisent le christianisme du Moyen Âge tardif, il puise des réponses dans la Bible, particulièrement dans l'épître de Paul aux Romains.
Selon Luther, le salut de l'âme est un libre don de Dieu, reçu par la repentance sincère et la foi authentique en Jésus-Christ comme le Messie, sans intercession possible de l'Église.
Il défie l'autorité papale en tenant la Bible pour seule source légitime d'autorité chrétienne.
Scandalisé par le commerce des indulgences instauré par les papes Jules II et Léon X pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome, il publie le 31 octobre 1517 les 95 thèses.
Sommé le 15 juin 1520 par le pape Léon X de se rétracter, il est excommunié, le 3 janvier 1521, par la bulle pontificale Decet romanum pontificem.
L'empereur du Saint-Empire romain germanique et roi d'Espagne, Charles Quint, convoque Martin Luther en 1521 devant la Diète de Worms.
Un sauf-conduit lui est accordé afin qu'il puisse s'y rendre sans risque.
Devant la Diète de Worms, il refuse de se rétracter, se déclarant convaincu par le témoignage de l'Écriture et s'estimant soumis à l'autorité de la Bible et de sa conscience plutôt qu'à celle de la hiérarchie ecclésiastique.
La Diète de Worms, sous la pression de Charles Quint, décide alors de mettre Martin Luther et ses disciples au ban de l'Empire.
Il est accueilli par son ami l'électeur de Saxe Frédéric III le Sage au château de la Wartbourg, où il compose ses textes les plus connus et les plus diffusés.
C'est là qu'il se lance dans une traduction de la Bible en allemand à partir des textes originaux, traduction dont l'influence culturelle sera primordiale, tant pour la fixation de la langue allemande que pour l'établissement des principes de l'art de la traduction.
Luther adopte vers la fin de son existence une attitude de plus en plus judéophobe.
En 1543, trois ans avant sa mort, il publie Des Juifs et de leurs mensonges, pamphlet d'une extrême violence où il prône des solutions telles que brûler les synagogues, abattre les maisons des Juifs, détruire leurs écrits, confisquer leur argent et tuer les rabbins qui enseigneraient le judaïsme.
Condamnés par quasiment tous les courants luthériens, ces écrits et l'influence de Luther sur l'antisémitisme ont contribué à rendre son image controversée.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Martin Luther
Mohandas Karamchand Gandhi 1869 - 1948
 Mohandas Karamchand Gandhi, né à Porbandar (Gujarat) le 2 octobre 1869 et mort assassiné à Delhi le 30 janvier 1948, est un dirigeant politique, important guide spirituel de l'Inde et du mouvement pour l'indépendance de ce pays.
Mohandas Karamchand Gandhi, né à Porbandar (Gujarat) le 2 octobre 1869 et mort assassiné à Delhi le 30 janvier 1948, est un dirigeant politique, important guide spirituel de l'Inde et du mouvement pour l'indépendance de ce pays.
Il est communément connu et appelé en Inde et dans le monde comme Mahatma Gandhi (du sanskrit mahātmā, « grande âme »), voire simplement Gandhi, Gandhiji ou Bapu (« père » dans plusieurs langues en Inde). « Mahatma » étant toutefois un titre qu'il refusa toute sa vie d'associer à sa personne.
Il a été un pionnier et un théoricien du satyāgraha, de la résistance à l'oppression par la désobéissance civile de masse, cette théorisation était fondée sur l'ahiṃsā (« non-violence »), qui a contribué à conduire l'Inde à l'indépendance.
Gandhi a inspiré de nombreux mouvements de libération et de défense des droits civiques dans le monde.
Son analyse critique de la modernité occidentale, des formes d'autorité et d'oppression (dont l'État), sont une remise en cause du développement qui influença nombre de théoriciens et de dirigeants politiques.
Avocat ayant fait ses études de droit en Grande-Bretagne, Gandhi développa, au fil de ses actions pour la dignité humaine et la justice sociale, une méthode de désobéissance civile non-violente en Afrique du Sud, en organisant la lutte de la communauté indienne pour ses droits civiques.
À son retour en Inde, Gandhi incita les fermiers et les travailleurs pauvres à protester contre les taxes jugées trop élevées et la discrimination dont ils étaient victimes, et porta sur la scène nationale la lutte contre les lois coloniales instaurées par les Britanniques.
Devenu le dirigeant du Congrès national indien, Gandhi mena une campagne nationale pour l'aide aux pauvres, pour la libération des femmes, pour la fraternité entre les communautés de différentes religions ou ethnies, pour la fin de l'intouchabilité et de la discrimination des castes, et pour l'autosuffisance économique de la nation, mais surtout pour le Swaraj — l'indépendance de l'Inde de toute domination étrangère.
Gandhi conduisit la marche du sel, célèbre opposition à la taxe sur le sel. Il lança également l'appel au mouvement Quit India le 8 août 1942.
Il fut emprisonné plusieurs fois en Afrique du Sud et en Inde pour ses activités ; il passa en tout six ans en prison.
Hindou profondément religieux et adepte de la philosophie indienne, Gandhi vivait simplement, organisant un ashram qui était autosuffisant.
Il faisait et lavait ses propres vêtements — la traditionnelle dhoti indienne et le châle, avec du coton filé avec un charkha (rouet) — et était un militant végétarien.
Il pratiquait de rigoureux jeûnes sur de longues périodes, pour s'auto-purifier mais aussi comme moyen de protestation, d'influence et de réforme chez autrui.
Gandhi est reconnu comme le Père de la Nation en Inde, où son anniversaire est une fête nationale.
Cette date a également été déclarée « Journée internationale de la non-violence » par l'Assemblée générale des Nations unies en 2007.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Mohandas_Karamchand_Gandhi
Niels Henrik David Bohr 1885 - 1962
 Niels Henrik David Bohr (7 octobre 1885 à Copenhague, Danemark - 18 novembre 1962 à Copenhague) est un physicien danois.
Niels Henrik David Bohr (7 octobre 1885 à Copenhague, Danemark - 18 novembre 1962 à Copenhague) est un physicien danois.
Il est surtout connu pour son apport à l'édification de la mécanique quantique, pour lequel il a reçu de nombreux honneurs.
Il est notamment lauréat du prix Nobel de physique de 1922.
Né de Christian Bohr, professeur de médecine et recteur d'université, de confession luthérienne, et de Ellen Adler, de confession juive, Niels Bohr a un frère cadet, Harald Bohr, mathématicien et sportif de haut niveau (il joua dans l'équipe nationale de football et participa aux Jeux olympiques de 1908 tenus à Londres), ainsi qu'une sœur aînée, Jenny.
Il est lui-même un très bon footballeur.
Niels entre à l'université de Copenhague en 1903.
Dès 1906, il travaille sur le thème des vibrations d'un jet de liquide et son mémoire obtient une récompense de l'Académie royale danoise des sciences et des lettres.
Il obtient un doctorat à l'université de Copenhague en 1911 « Sur la théorie électronique des métaux », émettant ses premières idées sur la structure atomique.
Quelques mois avant la soutenance, il se fiance avec Margrethe Norlung (1890-1984).
Il obtient une bourse de la Fondation Carlsberg et veut dans un premier temps travailler à l'université de Cambridge avec le professeur Joseph John Thomson dont le modèle atomique, sphère de charge positive dans laquelle sont plongés les électrons, ne satisfait pas totalement son élève.
Bohr rencontre alors Ernest Rutherford qu'il rejoint à Manchester (Angleterre).
Se basant sur les théories de Rutherford, il publie en 1913 un modèle de la structure de l'atome mais aussi de la liaison chimique dans une série de trois articles de la revue Philosophical Magazine.
Cette théorie présente l'atome comme un noyau autour duquel gravitent des électrons, qui déterminent les propriétés chimiques de l'atome. Les électrons ont la possibilité de passer d'une couche à une autre, émettant un quantum d'énergie, le photon.
Cette théorie est à la base de la mécanique quantique. Albert Einstein s'intéresse de très près à cette théorie dès sa publication.
Ce modèle est confirmé expérimentalement quelques années plus tard.
Il rentre au Danemark en 1912 et se marie peu après. De cette union naissent six garçons, le plus connu étant Aage Bohr, lauréat du prix Nobel de physique de 1975.
Il devient assistant à la chaire de physique de l'université de Copenhague.
En 1913, en manipulant différentes notions de mécanique classique et de la naissante mécanique quantique, il obtient l'équation de Bohr, « le résultat le plus important de toute la mécanique quantique, peu importe comment il est analysé » :
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Niels Bohr
Edward Charles Pickering 1846 - 1919
 Edward Charles Pickering (19 juillet 1846 à Boston - 3 février 1919 (à 72 ans) à Cambridge, Massachusetts, États-Unis) est un astronome et physicien américain, frère d'un autre astronome William Henry Pickering.
Edward Charles Pickering (19 juillet 1846 à Boston - 3 février 1919 (à 72 ans) à Cambridge, Massachusetts, États-Unis) est un astronome et physicien américain, frère d'un autre astronome William Henry Pickering.
Il reçoit son baccalauréat ès sciences de Harvard en 1865 et devient professeur au Massachusetts Institute of Technology peu de temps après.
Avec l'astronome allemand Hermann Carl Vogel, Pickering fut le premier à découvrir une étoile binaire spectroscopique.
Il fut également directeur du Harvard College Observatory (HCO), où il accomplit de grandes avancées dans la collecte des données spectrales sur les étoiles, notamment grâce à l'usage de l'astrophotographie.
À Harvard, il recruta un bon nombre de collègues astronomes féminines, notamment Annie Jump Cannon, Henrietta Swan Leavitt, Williamina Fleming et Antonia Maury.
Elles réalisèrent d'importantes découvertes au HCO sous la houlette de Pickering.
En 1911, il cofonda avec William Tyler Olcott l'American Association of Variable Star Observers (AAVSO, Association américaine des observateurs d'étoiles variables).
De nos jours, Pickering est encore reconnu pour avoir donné à l'observatoire de Harvard un renom international.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Edward Charles Pickering
Ejnar Hertzsprung 1873 - 1967
 Ejnar Hertzsprung (8 octobre 1873 à Copenhague – 21 octobre 1967 à Roskilde) est un chimiste et astronome danois.
Ejnar Hertzsprung (8 octobre 1873 à Copenhague – 21 octobre 1967 à Roskilde) est un chimiste et astronome danois.
Durant la période 1911-1913, il développa le diagramme de Hertzsprung-Russell avec Henry Norris Russell.
En 1913, il détermina les distances de plusieurs étoiles céphéides de la Galaxie par la méthode de la parallaxe statistique, et put ainsi calibrer la relation découverte par Henrietta Leavitt entre la période des céphéides et leur luminosité.
Lors de cette détermination, il commit une erreur en positionnant les étoiles 10 fois trop près.
Il utilisa cette relation pour estimer la distance du petit Nuage de Magellan.
De 1919 à 1946, Hertzsprung travailla à l'observatoire de Leyde aux Pays-Bas et en fut le directeur à partir de 1937.
En 1922, il développa un système d’abréviations de deux lettres pour désigner les constellations.
Russell en fit une version à trois lettres qui fut immédiatement adoptée par l’Union astronomique internationale lors de son Assemblée Générale d’inauguration à Rome en 1922 (Transactions of the International Astronomical Union, vol. I, 1922, p. 158).
Russell co-crédita Hertzsprung, mais ce dernier renia cette paternité.
Il découvrit deux astéroïdes, dont l'astéroïde Amor (1627) Ivar.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Ejnar Hertzsprung
Nikola Tesla 1856 - 1943
 Nikola Tesla, né dans la nuit du 9 au 10 juillet 1856 à Smiljan dans l'Empire d'Autriche (actuelle Croatie) et mort le 7 janvier 1943 à New York, est un inventeur et ingénieur américain d'origine serbe.
Nikola Tesla, né dans la nuit du 9 au 10 juillet 1856 à Smiljan dans l'Empire d'Autriche (actuelle Croatie) et mort le 7 janvier 1943 à New York, est un inventeur et ingénieur américain d'origine serbe.
Il est notoirement connu pour son rôle prépondérant dans le développement et l'adoption du courant alternatif pour le transport et la distribution de l'électricité.
Tesla a d'abord travaillé dans la téléphonie et l'ingénierie électrique avant d'émigrer aux États-Unis en 1884 pour travailler avec Thomas Edison puis avec George Westinghouse, qui enregistra un grand nombre de ses brevets.
Considéré comme l’un des plus grands scientifiques dans l’histoire de la technologie, pour avoir déposé quelque 300 brevets couvrant au total 125 inventions (qui seront pour beaucoup attribuées à tort à Edison) et avoir décrit de nouvelles méthodes pour réaliser la « conversion de l’énergie », Tesla est reconnu comme l’un des ingénieurs les plus créatifs de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.
Quant à lui, il préférait plutôt se définir comme un découvreur.
Ses travaux les plus connus et les plus largement diffusés portent sur l’énergie électrique.
Il a mis au point les premiers alternateurs permettant la naissance des réseaux électriques de distribution en courant alternatif, dont il est l’un des pionniers.
Tesla s’est beaucoup intéressé aux technologies modernes se focalisant sur l’électricité qui était le noyau de ses inventions.
Il est connu pour avoir su mettre en pratique la découverte du caractère ondulatoire de l’électromagnétisme (théorisé par James Clerk Maxwell en 1864), en utilisant les fréquences propres des composants des circuits électriques afin de maximiser leur rendement.
De son vivant, Tesla était renommé pour ses inventions ainsi que pour son sens de la mise en scène, faisant de lui un archétype du « savant fou ».
Grand humaniste qui se fixait comme objectif d'apporter gratuitement l'électricité dans les foyers et de la véhiculer sans fil, il resta malgré tout dans un relatif anonymat jusqu'à plusieurs décennies après sa mort. Son œuvre trouve un regain d'intérêt dans la culture populaire depuis les années 1990.
En 1960, son nom a été donné au tesla (T), l’unité internationale d’induction magnétique.
En 2003, le constructeur automobile de voitures électriques Tesla Inc. est créé, le nom de la marque faisant référence à Nikola Tesla.
Son lieu de sépulture est à Belgrade, en Serbie, dans le musée Nikola-Tesla.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Nikola Tesla
Paul Nurse 1949 -
 Sir Paul M. Nurse, né le 25 janvier 1949 à Norwich en Angleterre, est un biochimiste britannique, prix Nobel de physiologie ou médecine en 2001 avec Leland H. Hartwell et Sir R. Timothy Hunt pour leur découverte de la régulation du cycle cellulaire par la cycline et des enzymes kinases dépendantes de la cycline.
Sir Paul M. Nurse, né le 25 janvier 1949 à Norwich en Angleterre, est un biochimiste britannique, prix Nobel de physiologie ou médecine en 2001 avec Leland H. Hartwell et Sir R. Timothy Hunt pour leur découverte de la régulation du cycle cellulaire par la cycline et des enzymes kinases dépendantes de la cycline.
Les parents de Nurse sont originaires du Norfolk.
Il grandit à Wembley au nord-ouest de Londres et étudie à la Harrow County Grammar School.
Il reçoit son Bachelor of Science en 1970 de l'Université de Birmingham et son doctorat en 1973 à l'University of East Anglia.
En 1976, Paul Nurse identifie le gène cdc2 dans des levures (Schizosaccharomyces pombe).
Ce gène contrôle la progression du cycle cellulaire de la phase G1 à la phase S et la transition de la phase G2 à la mitose du cycle cellulaire.
En 1987, Paul Nurse identifie le gène correspondant chez l'homme, la cdk1.
En 1984, il rejoint l'Imperial Cancer Research Fund (ICRF). En 1988, il quitte la chaire de microbiologie de l'université d'Oxford.
Il retourne à l'ICRF comme directeur de recherche en 1993 et en 1996 il en est nommé directeur général.
L'ICRF devient le Cancer Research UK en 2002.
En 2003 il est nommé président de l'université Rockefeller à New York où il continue à travaille sur le cycle cellulaire chez la levure.
Il est président du Conseil scientifique de l'Institut Curie.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Paul Nurse
Pieter Zeeman 1865 - 1943
 Pieter Zeeman, né le 25 mai 1865 à Zonnemaire (Zélande, Pays-Bas) et mort le 9 octobre 1943 à Amsterdam, est un physicien néerlandais.
Pieter Zeeman, né le 25 mai 1865 à Zonnemaire (Zélande, Pays-Bas) et mort le 9 octobre 1943 à Amsterdam, est un physicien néerlandais.
Il est colauréat avec Hendrik Lorentz du prix Nobel de physique de 1902 pour sa découverte de l'effet Zeeman.
Il fait ses études à l'université de Leyde, où il enseigne jusqu'à ce qu'il devienne professeur de physique à l'université d'Amsterdam en 1900.
Ses travaux portent entre autres sur l'émission de lumière par les atomes excités et sur la propagation des signaux lumineux dans les milieux en mouvement.
On lui doit la découverte de l'effet Zeeman.
En 1896, Zeeman découvre que les raies spectrales d'une source de lumière soumise à un champ magnétique possèdent plusieurs composantes, chacune d'elles présentant une certaine polarisation.
Ce phénomène, appelé par la suite effet Zeeman, confirme la théorie électromagnétique de la lumière.
Zeeman partage, en 1902, le prix Nobel de physique avec Hendrik Lorentz « en reconnaissance des extraordinaires services qu'ils ont rendus par leurs recherches sur l'influence du magnétisme sur les phénomènes radiatifs ».
Il est lauréat de la médaille Rumford en 1922 et de la médaille Franklin en 1925. Pieter Zeeman est devenu membre étranger de la Royal Society le 5 mai 1921.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Pieter Zeeman
Henri Becquerel 1852 - 1908
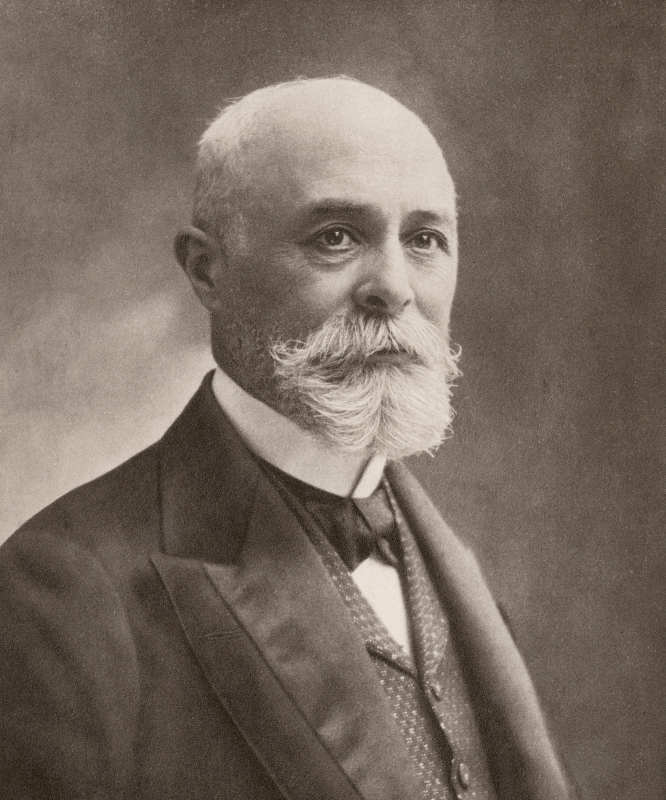 Antoine Henri Becquerel, né le 15 décembre 1852 à Paris et mort le 25 août 1908 au Croisic, est un physicien français. Il est lauréat de la moitié du prix Nobel de physique de 1903 (partagé avec Marie Curie et son mari Pierre Curie).
Antoine Henri Becquerel, né le 15 décembre 1852 à Paris et mort le 25 août 1908 au Croisic, est un physicien français. Il est lauréat de la moitié du prix Nobel de physique de 1903 (partagé avec Marie Curie et son mari Pierre Curie).
Son père, Alexandre Edmond Becquerel, et son grand-père, Antoine Becquerel, étaient des physiciens, professeurs au muséum national d'histoire naturelle de Paris. Il naît même dans ces bâtiments, tout comme son père.
Il effectue ses études au lycée Louis-le-Grand. En 1872, il entre à l'École polytechnique, puis en 1874 obtient l'école d'application des Ponts et Chaussées.
En 1874, il se marie avec Lucie Jamin, fille de Jules Jamin, un de ses professeurs de physique à l'École polytechnique, avec qui il a un fils, Jean (1878-1953). En 1890, devenu veuf, il épouse en secondes noces Louise Lorieux (1864-1945), fille d'Edmond Lorieux, inspecteur général des Mines, et nièce du vice-président du Conseil général des ponts et chaussées.
Il obtient son diplôme d'ingénieur en 1877, et s'oriente vers la recherche. Ses premiers travaux concernent l'optique, puis il s'oriente à nouveau à partir de 1875 vers la polarisation.
En 1883, il étudie le spectre infrarouge des vapeurs métalliques, avant de se consacrer, en 1886, à l'absorption de la lumière par les cristaux. Il finit par soutenir sa thèse de doctorat en 1888 (Recherches sur l'absorption de la lumière).
L'année suivante, il est élu à l'Académie des sciences, comme son père et son grand-père l'avaient été avant lui.
Après la mort de son père en 1892, il poursuit son travail et finit par entrer comme professeur à l'École polytechnique en 1895, où il succède à Alfred Potier.
En 1896, Becquerel découvre la radioactivité par hasard, alors qu'il fait des recherches sur la fluorescence des sels d'uranium.
Sur une suggestion d'Henri Poincaré, il cherchait à déterminer si ce phénomène était de même nature que les rayons X.
C'est en observant une plaque photographique mise en contact avec le matériau qu'il s'aperçoit qu'elle est impressionnée même lorsque le matériau n'a pas été soumis à la lumière du Soleil : le matériau émet son propre rayonnement sans nécessiter une excitation par de la lumière.
Ce rayonnement fut baptisé hyperphosphorescence. Il annonce ses résultats le 2 mars 1896, avec quelques jours d'avance sur les travaux de Silvanus P. Thompson (en) qui travaillait en parallèle sur le même sujet à Londres.
Cette découverte lui vaut la médaille Rumford en 1900.
En 1897, Marie Curie choisit ce sujet pour sa thèse de doctorat. Elle révèle les propriétés ionisantes de ce rayonnement puis, avec son époux Pierre Curie, découvre les éléments chimiques qui en sont à l'origine. Elle rebaptise cette propriété radioactivité.
En 1903, après la découverte du polonium et du radium par Marie et Pierre Curie, Becquerel reçoit la moitié du prix Nobel de physique (l'autre moitié est remise aux époux Curie) « en reconnaissance des services extraordinaires qu'il a rendus en découvrant la radioactivité spontanée ».
En 1908, il devient membre étranger de la Royal Society.
Il meurt quelque temps plus tard, au manoir de Pen Castel, propriété que sa belle-famille, les Lorieux, possédait au Croisic.
Par ailleurs, l'unité physique de la radioactivité, le becquerel (Bq) fut nommée en son honneur.
NDLR : la suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Henri Becquerel
Henry Ford 1863 - 1947
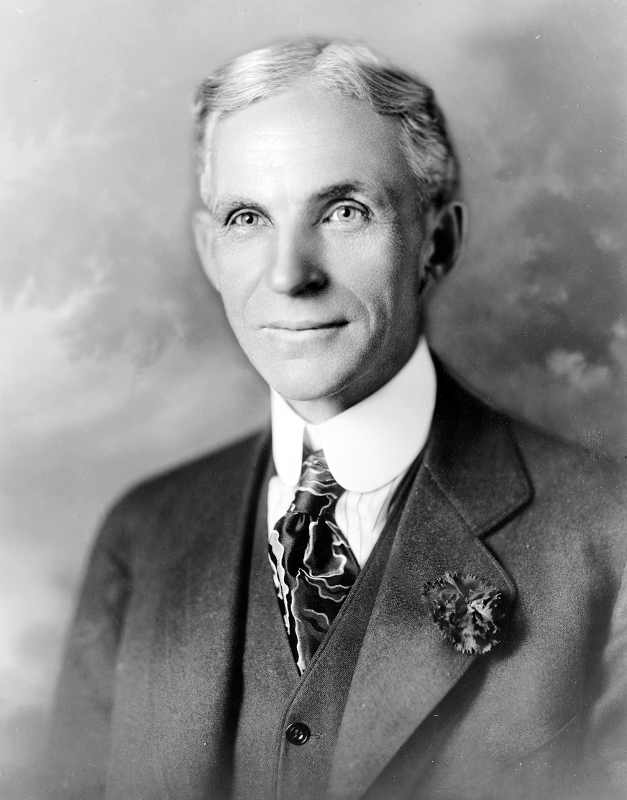 Henry Ford, né le 30 juillet 1863 à Dearborn (Michigan, États-Unis) et mort le 7 avril 1947 dans la même ville, est un industriel américain de la première moitié du XXe siècle et le fondateur du constructeur automobile Ford.
Henry Ford, né le 30 juillet 1863 à Dearborn (Michigan, États-Unis) et mort le 7 avril 1947 dans la même ville, est un industriel américain de la première moitié du XXe siècle et le fondateur du constructeur automobile Ford.
Son nom est notamment attaché au fordisme, une méthode industrielle alliant un mode de production en série fondé sur le principe de ligne d’assemblage et un modèle économique ayant recours à des salaires élevés.
La mise en place de cette méthode au début des années 1910 révolutionne l’industrie américaine en favorisant une consommation de masse et lui permet de produire à plus de 16 millions d’exemplaires la Ford T ; il devient alors l’une des personnes les plus riches et les plus connues au monde.
Ford a une vision globale de son action : il voit dans la consommation la clé de la paix. Son important engagement à réduire les coûts aboutit à de nombreuses innovations techniques mais également commerciales ; il met ainsi en place tout un système de franchises qui installe une concession Ford dans un maximum de villes en Amérique du Nord et dans les grandes villes des six continents.
La Fondation Ford hérite de la majeure partie de la fortune de Ford, mais l’industriel veille néanmoins à ce que sa famille en conserve le contrôle de façon permanente.
D’ailleurs, il assumera très longtemps le poste de président de la Ford Motor Company.
Dans les années 1930, Ford se constitue, selon l'expression du New York Times, « la plus importante troupe militaire privée du monde ». Il s'associe à la pègre de Détroit, notamment afin de recruter des mercenaires capables d'intimider les syndicalistes et de mener des actions punitives contre les ouvriers grévistes.
Le diplôme de docteur en ingénierie lui est délivré par l’Université du Michigan et le collège de l’État du Michigan. Il reçoit par ailleurs un LL.D. honoraire de l’Université de Colgate.
En collaboration avec Samuel Crowther, il écrit My Life, and Work (1922), Today and Tomorrow (1926) et Moving Forward (1930) qui décrivent le développement de son entreprise et expose ses théories sociales et industrielles.
Son nom est également associé au livre The International Jew ainsi qu’au journal The Dearborn Independent, ce qui lui vaudra de nombreuses controverses concernant son antisémitisme et ses liens avec le régime nazi, certains voyant en lui l'un des maîtres à penser de Hitler.
NDLR : la suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Henry_Ford
Friedrich Nietzsche 1844 - 1900
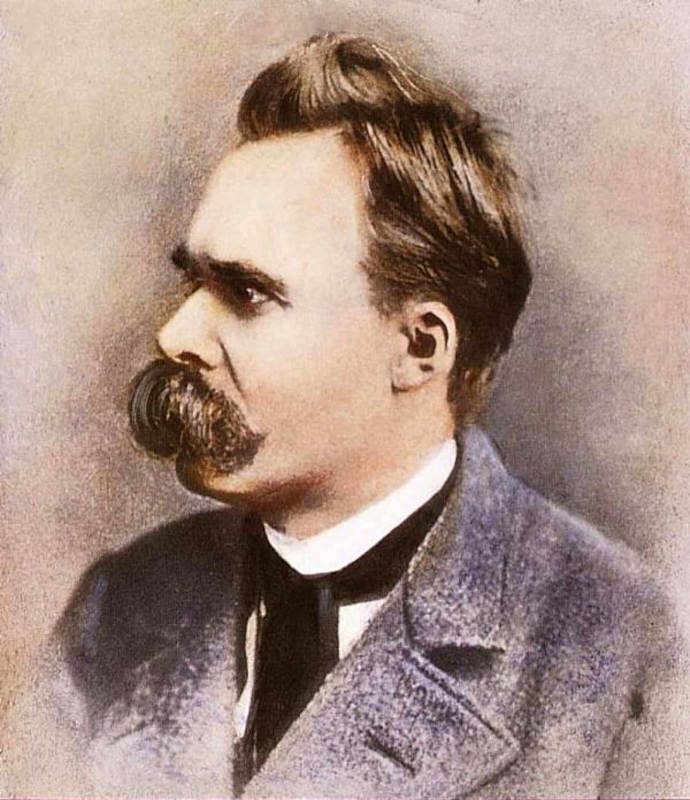 Friedrich Nietzsche est un philologue, philosophe, poète et pianiste allemand, né le 15 octobre 1844 à Röcken, en province de Saxe, et mort le 25 août 1900 à Weimar, en Saxe-Weimar-Eisenach.
Friedrich Nietzsche est un philologue, philosophe, poète et pianiste allemand, né le 15 octobre 1844 à Röcken, en province de Saxe, et mort le 25 août 1900 à Weimar, en Saxe-Weimar-Eisenach.
Friedrich Wilhelm Nietzsche naît à Röcken, en Prusse, le 15 octobre 1844, dans une famille pastorale luthérienne.
Son père, Karl-Ludwig, né en 1813 à Eilenbourg, pasteur évangélique et son grand-père paternel, Friedrich August Ludwig, pasteur à Wohlmirstedt, puis superintendant à Eilenbourg ont tous deux enseigné la théologie.
Le père de Nietzsche, qui étudie la théologie à Halle avant de devenir précepteur de membres de la famille royale de Prusse, à la cour ducale d'Altenbourg, est un protégé de Frédéric-Guillaume IV.
Mais la maladie (de violents maux de tête) le contraint à demander une paroisse dans la région de sa famille, vers Naumburg. Karl-Ludwig et une partie de sa famille s'installent à Röcken en 1842.
Il rencontre sa femme, Franziska Oehler(1826 – 1897), fille d'un pasteur, et l'épouse en 1843. Ils ont deux fils, Friedrich Wilhelm et Ludwig Joseph (27 février 1848 – 4 janvier 1850), et une fille, Elisabeth Nietzsche (18 juillet 1846).
Franziska, la mère de Friedrich.
En août 1848, le père de Nietzsche fait une chute, sa tête heurte les marches de pierre d'un perron. Il meurt un an plus tard, l'esprit égaré, âgé de trente-cinq ans, le 30 juillet 1849.
Quelque temps plus tard, en janvier 1850, le frère de Nietzsche meurt à son tour :
« En ce temps-là, je rêvai que j'entendais l'orgue dans l'église résonner tristement, comme aux enterrements.
Et comme je cherchais la cause de cela, une tombe s'ouvrit rapidement et mon père apparut marchant dans son linceul.
Il traversa l'église et revint bientôt avec un petit enfant dans les bras. […]
Dès le matin, je racontai ce rêve à ma mère bien-aimée. Peu après, mon petit frère Joseph tomba malade, il eut des attaques de nerfs et mourut en peu d'heures. »
En 1850, alors qu'il a six ans, ce qui reste de la famille vient s’installer à Naumburg. Friedrich Nietzsche ressent ce départ de Röcken comme un abandon de son village natal :
« l'abandon du village natal ; l'entrée dans l'agitation urbaine, tout cela agit sur moi avec une telle force que chaque jour je la ressens en moi »
— Note d'octobre 1862.
Il souhaite à cette époque être pasteur comme son père.
Il développe une conscience scrupuleuse, particulièrement portée à l'analyse et à la critique de soi, et fière, croyant à la noblesse de la famille Nietzsche (selon une tradition familiale transmise par sa grand-mère, les ancêtres des Nietzsche venaient de Pologne et s'appelaient alors Nietzki).
Son caractère est bien résumé par cette remarque qu'il fit à sa mère : « Un comte Nietzki ne doit pas mentir. »
Vers 1853, à l'âge de neuf ans, il se met au piano, compose des fantaisies et des mazurkas et écrit de la poésie.
Il s'intéresse à l'architecture et même, pendant le siège de Sébastopol, en 1854, à la balistique.
Il crée également un théâtre des Arts, où il joue avec ses amis des tragédies qu'il écrit (Les dieux de l'Olympe, Orkadal).
Il entre au collège de Naumburg à l'âge de dix ans, en 1854. Élève brillant, sa supériorité fait que sa mère reçoit le conseil de l'envoyer à Pforta.
Elle accepte et obtient une bourse du roi Frédéric-Guillaume IV.
En 1858, avant de partir pour Pforta, le jeune Nietzsche, 14 ans, s'interroge sur la nature de Dieu :
« À douze ans, j'ai vu Dieu dans sa toute-puissance. »
— Note de 1858.
Cherchant à expliquer le mal, il l'intègre à la Trinité :
le Père, le Fils et le Diable.
Nietzsche rédige alors un cahier où il consigne l'histoire de son enfance, et conclut :
« Il est si beau de faire repasser devant sa vue le cours de ses premières années et d'y suivre le développement de l'âme.
J'ai raconté sincèrement toute la vérité, sans poésie, sans ornement littéraire… Puissé-je écrire encore beaucoup d'autres cahiers pareils à celui-ci ! »
En 1858, âgé de quatorze ans, il entre au collège de Pforta, collège où passèrent Novalis, les frères Schlegel, Fichte.
Il y fait ses humanités, y rencontre Gersdorff (1844 – 1904) et Paul Deussen (1845 – 1919), le futur sanskritiste.
Cette époque est marquée par les premières questions angoissées sur son avenir, par de profonds troubles religieux et philosophiques, et par les premiers symptômes violents de la maladie.
L'unique document dont nous disposons sur les premiers mois de la vie de Nietzsche dans ce collège relate une anecdote qui exprime sa personnalité :
il y avait une discussion à propos de l'histoire de Mucius Scaevola.
Les camarades de Nietzsche la tenaient pour une légende, personne ne pouvant avoir le courage de plonger sa main dans le feu.
Nietzsche, alors, se saisit d'un charbon brûlant dans un poêle allumé et le tint devant les yeux de ses camarades.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Friedrich Nietzsche
Hippolyte Morestin 1869-1919
 Hippolyte Morestin est un médecin et chirurgien français né le 1er septembre 1869 à Basse-Pointe (Martinique) et mort le 12 février 1919 à Paris.
Hippolyte Morestin est un médecin et chirurgien français né le 1er septembre 1869 à Basse-Pointe (Martinique) et mort le 12 février 1919 à Paris.
Pionner de la chirurgie esthétique, il est notamment connu pour avoir réparé les visages de nombreux soldats défigurés pendant la Première Guerre mondiale (les « Gueules cassées »), en inventant des techniques toujours utilisées en médecine contemporaine.
Professeur agrégé d'anatomie à la Faculté de médecine de Paris, spécialiste de chirurgie réparatrice à l'Hôpital du Val-de-Grâce, il est l'auteur d'importantes contributions, notamment dans le domaine de la chirurgie maxillo-faciale lors de la Grande guerre.
Hippolyte Morestin naît le 1er septembre 1869 à Basse-Pointe en Martinique.
Fils du Dr Charles Amédée Morestin (1837-1901), médecin à l'Hôpital civil de Saint-Pierre, il est issu du milieu aisé des Blancs créoles de cette ville.
Il passe son enfance en Martinique, étudiant au séminaire collège de Saint-Pierre, où il est un élève médiocre et turbulent.
À l'âge de 14 ans, son père l'envoie poursuivre ses études en Métropole, avec son frère aîné.
Il intègre le lycée Louis-le-Grand à Paris, et passe un bac littéraire, puis un bac scientifique l'année d'après.
Il s'inscrit ensuite à la faculté de médecine, où il se révèle un bon élève.
Il devient interne des hôpitaux de Paris en 1890, puis obtient son doctorat en 1894, à l'âge de 25 ans.
Il se prend de passion pour la chirurgie esthétique, et développe une connaissance approfondie de l'anatomie humaine ainsi qu'une grande dextérité manuelle.
Il se spécialise alors dans la chirurgie des articulations et dans l'opération des cancers labio-bucco-pharyngés et maxillaires.
Hippolyte Morestin est notamment connu pour opérer de nombreux « cas difficiles » avec un soin inédit pour l'époque, tels des lupus, des kystes, des appendicites ou des becs de lièvre.
Il est également connu pour soigner sans distinction d'âge, de fortune ou de provenance, opérant même gratuitement des patients martiniquais dans le besoin lorsqu'il fait des séjours sur son île natale.
Il travaille au sein de plusieurs institutions médicales parisiennes, dont l’hôpital Saint-Antoine, l’hôpital Tenon ainsi que l’hôpital Saint-Louis, où il devient chef de service.
En 1904, il obtient son agrégation en chirurgie, puis se met à enseigner l'anatomie à la Faculté de médecine de Paris.
Ayant acquis une bonne réputation auprès de ses pairs dans le domaine de la chirurgie maxillo-faciale, il participe à des congrès de médecine et de sociétés savantes, en France comme à l'étranger (notamment à Bruxelles, Madrid et New York).
En 35 ans de carrière, il rédige plus de 600 articles publiés dans des revues médicales spécialisées.
Au fur et à mesure que sa réputation s'installe, sa clientèle évolue et se fidélise : des femmes viennent ainsi le consulter pour subir des opérations à objectif purement esthétique (visage, cou, seins, ventre).
Pendant la Première Guerre mondiale, il est mobilisé en tant que médecin aide-major de deuxième classe.
Il est l'un des premiers chirurgiens à opérer des Gueules cassées, ces soldats défigurés pendant les combats, notamment à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce ainsi qu'à l'hôpital Rothschild à Paris. Il en opère ainsi plusieurs milliers.
NDLR : la suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Hippolyte Morestin
James Watt 1736 - 1819
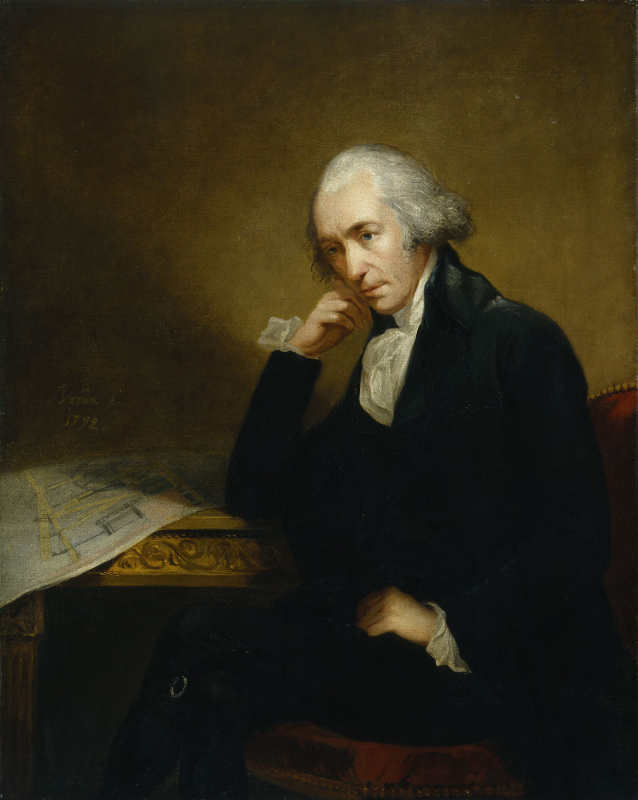 James Watt, né le 19 janvier 1736 à Greenock en Écosse et mort le 25 août 1819 à Heathfield Hall, dans sa maison à Handsworth (en) (localité maintenant intégrée à Birmingham, en Angleterre) est un ingénieur écossais dont les améliorations sur la machine à vapeur furent une des étapes clé dans la révolution industrielle.
James Watt, né le 19 janvier 1736 à Greenock en Écosse et mort le 25 août 1819 à Heathfield Hall, dans sa maison à Handsworth (en) (localité maintenant intégrée à Birmingham, en Angleterre) est un ingénieur écossais dont les améliorations sur la machine à vapeur furent une des étapes clé dans la révolution industrielle.
Il a animé la Lunar Society de Birmingham.
En hommage à ses recherches, le watt (symbole W), a été donné à l'Unité internationale de puissance, ou de flux énergétique (dont le flux thermique).
James Watt est né le 19 janvier 1736 à Greenock, petite ville d'Écosse.
Son père, charpentier de marine, était aussi propriétaire de bateaux, entrepreneur et occupait une fonction dans la magistrature municipale.
Sa mère, Agnes Muirhead, venait d'une famille distinguée et elle était instruite.
Tous les deux étaient des presbytériens et des covenantaires convaincus.
James Watt était préférentiellement instruit dans la demeure de ses parents par le soin de sa mère.
Il faisait montre d'une grande dextérité manuelle et d'une aptitude pour les mathématiques, tandis que les langues grecques et latines lui déplaisaient.
1736 : naissance à Greenock, en Écosse le 19 janvier 1736.
1750 : une centaine de machines de Thomas Newcomen fonctionnent en Angleterre.
1754 : apprend la fabrication d’instruments mathématiques à Londres avant de retourner à Glasgow.
1763 : en tant que fabricant d’instruments à l’université de Glasgow, répare une machine à vapeur de Newcomen, ce qui l’amène à réfléchir aux manières d’améliorer la machine.
1765 : en se promenant dans le « Parcours de Golf ' du parc Glasgow Green, l’idée lui vient d'une chambre de condensation séparée pour les machines à vapeur.
1765 : son ami et professeur à l'université de Glasgow, le chimiste Joseph Black (1728-1799), découvreur de la chaleur latente de la vapeur d'eau investit dans l'entreprise.
1765 : Joseph Black lui présente le savant et industriel John Roebuck, qui propose de l'aider financièrement et industriellement en échange d'une participation des deux-tiers du capital. John Roebuck avait percé une mine de charbon se heurtant à des ruissellements d'eau, qui génèrent un niveau d'humidité tel que la machine brevetée par Thomas Newcomen en 1712 ne suffisait pas pour évacuer l'eau et s'intéressait pour cette raison à la machine de James Watt.
1767 : arpenteur du canal de Forth et Clyde.
1768 : il accepte la proposition de John Roebuck, qui se retrouve cependant en difficultés financières dès 1772.
1769 : il fait breveter la chambre de condensation séparée pour la machine à vapeur.
1774 : il crée une entreprise à Soho, près de Birmingham, pour produire sa machine à vapeur améliorée.
1775 : Matthew Boulton rachète les 66 % du capital détenus par John Roebuck, alors en difficulté financière dans une manufacture de sulfate de fer créée pour approvisionner en blanchisseurs les fabricants de vêtements en lin.
1781 : il fait breveter l’engrenage soleil et planète inventé par William Murdoch pour convertir un mouvement vertical en mouvement de rotation.
1782 : invente la machine à double action.
1784 : il fait breveter une locomotive à vapeur.
1788 : il adapte le régulateur à boules pour une utilisation sur la machine à vapeur.
1800 : environ 500 machines à vapeur de James Watt en service.
1819 : mort le 25 août à Heathfield Hall, dans sa maison à Handsworth .
NDLR : la suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: James Watt
Garry Kasparov
 Garry (ou Garri ou Gary) Kimovitch Kasparov, né le 13 avril 1963 à Bakou (RSS d'Azerbaïdjan, URSS), est un joueur d'échecs soviétique puis russe d'origine arménienne.
Garry (ou Garri ou Gary) Kimovitch Kasparov, né le 13 avril 1963 à Bakou (RSS d'Azerbaïdjan, URSS), est un joueur d'échecs soviétique puis russe d'origine arménienne.
En exil depuis 2013, il a acquis la nationalité croate en 2014 et vit aujourd'hui à New York.
Treizième champion du monde d'échecs de l'histoire, de 1985 à 2000 et vainqueur de nombreux tournois, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire.
En janvier 1990, il est le premier joueur à dépasser les 2 800 points Elo. En juillet 1999, il atteint le classement Elo le plus élevé jusqu'alors, avec 2 851 points.
Ce record ne fut battu que 14 ans plus tard, en 2013, par Magnus Carlsen.
En 2005, Kasparov renonce à la reconquête de son titre de champion du monde perdu en 2000.
Il s'engage en politique dans l'opposition au président russe Vladimir Poutine.
En 2007, le magazine américain Time le place dans la liste des Time 100, une liste des cent personnes les plus influentes dans le monde.
En 2012, il devient président de l'ONG Human Rights Foundation, qui promeut les droits de l'homme dans le monde.
Il reste néanmoins impliqué dans l'univers des échecs.
Il entraîne pendant un an Magnus Carlsen en 2009, publie trois séries de livres sur les échecs et sa carrière : My Great Predecessors (2003-2006), Garry Kasparov on Modern Chess (2007-2010) et Garry Kasparov on Garry Kasparov (2011-2014), et brigue la présidence de la Fédération internationale des échecs (FIDE) en 2014.
Garik Kimovitch Vaïnstein (transcription allemande : Weinstein) nait le 13 avril 1963 d'un père juif, Kim Moïssevitch Vaïnstein (ou Weinstein) et d'une mère d'origine arménienne du Haut-Karabagh, Klara Chaguenovna Kasparova.
Ses parents s'étaient rencontrés au laboratoire industriel de Bakou (Azerbaïdjan) où ils travaillaient comme ingénieurs. Le père de Garik était issu d'une famille de musiciens.
Le père de Kim, Moïsseï (mort en 1971) était un compositeur et chef d'orchestre.
Le frère cadet de Kim Vaïnstein, Léonide Vaïnstein, était compositeur en Azerbaïdjan.
Le père de Garik, opposé à ce qu'il apprenne la musique, lui apprit les échecs lorsqu'il eut cinq ans.
Il lui donna également le goût de la géographie. La mère de Garik lui transmit sa passion pour l'histoire.
Son père tombe malade pendant l'été 1970 et meurt en 1971, à l'âge de trente-neuf ans, d'un lymphome de Hodgkin.
La mère de Garik ne l'emmène pas à l'enterrement et Garik raconte à son école que son père est parti en voyage d'affaires.
Son grand-père maternel, Chaguen, un ouvrier du pétrole et fervent communiste, prend sa retraite en 1971 et s'occupe de Garik.
Ils ont ensemble de nombreuses conversations sur le régime soviétique. En 1975, Garik prend le nom de sa mère (qui avait gardé son nom lors du mariage) en russifiant son nom, devenant Garri (Garry ou Gary) Kasparov.
En janvier 1990, Kasparov est victime des pogroms anti-arméniens de Bakou (du 13 au 16 janvier) et contraint de fuir la capitale azérie, comme des milliers d'autres Arméniens, en direction de l'Arménie.
Garri Kasparov a quatre enfants :
Polina (née en 1993 de sa première épouse, Macha — Maria Arapova — épousée le 3 mars 1989),
Vadim (né en 1997, de sa deuxième épouse Julia),
Aida (née en 2006, de sa troisième épouse Daria) et
Nickolas (né le 6 juillet 2015, de son épouse Dasha).
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Garry Kasparov
Georg Friedrich Bernhard Riemann 1826 - 1866
 Georg Friedrich Bernhard Riemann, né le 17 septembre 1826 à Breselenz, Royaume de Hanovre, mort le 20 juillet 1866 à Selasca, hameau de la commune de Verbania, Italie, est un mathématicien allemand.
Georg Friedrich Bernhard Riemann, né le 17 septembre 1826 à Breselenz, Royaume de Hanovre, mort le 20 juillet 1866 à Selasca, hameau de la commune de Verbania, Italie, est un mathématicien allemand.
Influent sur le plan théorique, il a apporté de nombreuses contributions importantes à la topologie, l'analyse, la géométrie différentielle et le calcul, certaines d'entre elles ayant permis par la suite le développement de la relativité générale.
Bernhard Riemann est né à Breselenz, un village du royaume de Hanovre.
Son père, Friedrich Bernhard Riemann, pasteur luthérien, a combattu l'armée napoléonienne.
Sa mère, Charlotte Ebell, meurt avant que ses enfants aient atteint l’âge adulte.
Les circonstances affectent profondément les Riemann qui ont souffert toute leur vie de sévères privations.
Comme en témoigne plus tard le mathématicien, son enfance, avec son frère et ses quatre sœurs, bien que pleine d'amour, est marquée par le manque de nourriture et de soins médicaux.
Ces carences sont probablement la cause du décès prématuré de Bernhard, ainsi que de celui de son frère et de ses sœurs, tous morts à peu près au même âge.
Dans un premier temps, les enfants Riemann reçoivent un enseignement primaire à domicile.
Cependant, Bernhard révèle très vite un grand talent pour les mathématiques : il résout parfaitement tous les problèmes arithmétiques que lui pose son père, mais invente aussi lui-même des problèmes toujours plus complexes et variés.
Lorsque Bernhard a dix ans, son père engage un professeur particulier pour qu'il enseigne à son fils la géométrie et l'arithmétique.
En 1840, Bernhard s'établit à Hanovre pour vivre chez sa grand-mère et aller au Lyceum (collège) qu'il intègre directement en troisième année.
Après le décès de sa grand-mère en 1842, il va à Lunebourg pour continuer ses études secondaires.
Au Johanneum Gymnasium (lycée), ses professeurs sont surpris par ses capacités à résoudre des problèmes complexes en mathématique.
Riemann a son premier contact avec les mathématiques supérieures grâce au professeur Schmalfuss qui lui donne libre accès à sa bibliothèque personnelle.
En 1846, âgé de 19 ans, il intègre l'université de Göttingen grâce à l'argent de sa famille, et commence à étudier la philosophie et la théologie pour devenir pasteur afin de financer sa famille.
Il étudie la Bible intensivement, mais il est distrait par les mathématiques.
Après avoir assisté aux cours de Carl Gauss, il ne peut se soustraire à sa vocation et sollicite l'autorisation de son père pour étudier les mathématiques.
Riemann excelle à l'université de Göttingen, mais il n'y reste pas longtemps puisqu'il rejoint en 1847 l'université de Berlin pour y parfaire sa formation dans les matières où Göttingen ne dispose pas d'enseignants suffisamment compétents, où il a entre autres comme professeurs Jacobi, Steiner et Dirichlet.
En 1849, il retourne à Göttingen, où il commence sa thèse de doctorat, sous la direction de Gauss. En décembre 1851, il soutient sa thèse intitulée Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Functionen einer veränderlichen complexen Grösse qui pose les bases de la topologie moderne et fait l'unanimité du jury.
Gauss dit de lui, après la défense de sa thèse « La dissertation présentée par Monsieur Riemann démontre de façon convaincante que celui-ci a effectué des recherches minutieuses et approfondies sur les parties du thème traitées dans la dissertation, qu'il est doué d'un esprit créatif, véritablement mathématique, et qu'il possède une originalité admirable et féconde ».
Sa carrière scientifique ne dura qu'un peu plus de dix ans : elle débute en 1849, lorsqu'il commence sa thèse doctorale, et se termine prématurément au début des années 1860, avec la rédaction de ses derniers articles.
Au début des années 1850, le souhait le plus cher de Riemann est de devenir professeur de mathématiques ou de physique à l'université de Göttingen.
Dans ce but, il doit produire un travail supplémentaire appelé Habilitationsschrift qui consiste à effectuer des recherches préliminaires sur trois sujets très différents les uns des autres qu'il choisit lui-même.
Au tout début de 1854, il est en mesure de communiquer à son maître — Carl Gauss — ses premier, deuxième et troisième choix.
Gauss voit d'emblée que la troisième proposition — une reformulation de la géométrie — contient en germe une idée importante et innovante à laquelle il avait déjà réfléchi, même s'il n'avait jamais rien publié à ce sujet.
En soutenant cette thèse le 10 juin 1854, Riemann fonde la géométrie riemannienne qui servira de cadre mathématique à la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein.
Après avoir soutenu sa thèse d'habilitation en 1854, Riemann prend du repos à Quickborn où il vit toujours avec ses parents, son frère et certaines de ses sœurs.
En septembre, il commence à travailler à l'université de Göttingen en qualité d'enseignant rémunéré.
Il est désormais en mesure, malgré ses faibles revenus, d'aider financièrement tous les membres de sa famille.
Le 23 février 1855, Gauss décède ; preuve du respect que Riemann a gagné à Göttingen, certains collègues suggèrent qu'il reprenne la chaire du mathématicien allemand, mais la chaire est proposée à Dirichlet, qui l'accepte et quitte Berlin pour occuper son nouveau poste. Riemann obtient cependant un salaire régulier et poursuit ses recherches en physique.
Il publie en 1855 un article sur « La théorie des anneaux colorés de Nobili » et, peu de temps après, il est atteint de surmenage, souffre de dépression nerveuse et doit, sur avis médical, passer quelques mois de repos dans la région montagneuse du Harz.
En 1857, il réintègre l'université.
Le 30 juillet 1859, à la suite de la mort de Dirichlet, il est promu à la tête du département de mathématiques de l'Université de Göttingen.
Peu de temps après, il est élu membre de l'Académie des sciences de Berlin.
En juin 1862, il épouse Elise Koch, une amie proche de ses sœurs. En juillet 1862, il contracte une pleurite qui évolue rapidement en tuberculose.
Sa santé ne s'améliorant pas avec le temps, il se rend avant l'hiver en Italie où il recouvre quelque peu la santé. En mars 1863, il retourne à Göttingen pour y reprendre ses devoirs académiques mais il est contraint de repartir quelques mois plus tard dans la péninsule italienne.
Durant ce nouveau séjour méditerranéen, naît sa fille Ida.
Deux ans plus tard, en octobre 1865, Riemann revient pour la dernière fois de sa vie à Göttingen. Il se réunit avec quelques-uns de ses collègues et met de l'ordre dans ses affaires avant de retourner en Italie.
Il quitte Göttingen avant que les armées de Hanovre et de Prusse s'affrontent en 1866.
Il meurt de tuberculose en Italie, à Selasca (aujourd'hui un hameau de Verbania sur le lac Majeur), où il est enterré au cimetière de Biganzolo (Verbania).
Riemann était un chrétien dévoué, le fils d'un ministre protestant, et a vu sa vie en tant que mathématicien comme une autre manière de servir Dieu.
Au cours de sa vie, il a tenu étroitement à sa foi chrétienne et l'a considérée comme l'aspect le plus important de sa vie.
Au moment de sa mort, il récitait la Prière du Seigneur avec sa femme et mourut avant qu'ils aient fini la prière.
Pendant ce temps, à Göttingen, sa femme de ménage a jeté quelques-uns des papiers dans son bureau, y compris beaucoup de travail inédit.
Riemann a refusé de publier un travail incomplet, et certaines idées profondes ont peut-être été perdues pour toujours.
La pierre tombale de Riemann à Biganzolo (Italie) se réfère au Huitième chapitre de l'Épître aux Romains dans le Nouveau Testament de la Bible chrétienne
(« Et nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, à ceux qui sont appelés selon son dessein »)
Ici repose en Dieu Georg Friedrich Bernhard Riemann
Professeur à Göttingen
né à Breselenz, Allemagne 17 septembre 1826
mort à Selasca, Italie 20 juillet 1866
Pour ceux qui aiment Dieu, toutes choses doivent travailler ensemble pour le meilleur.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Bernhard Riemann
Godfrey Harold Hardy 1877 - 1947
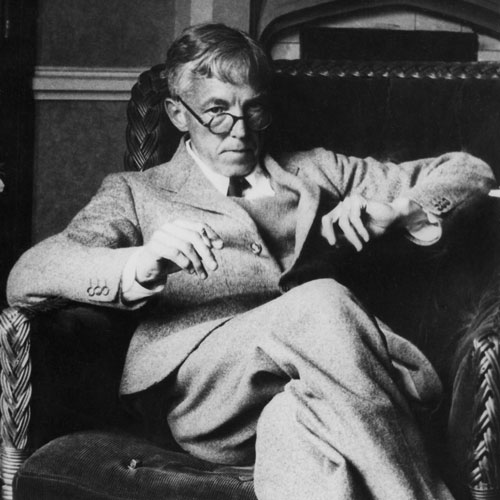 Godfrey Harold Hardy est un mathématicien britannique, né le 7 février 1877 à Cranleigh (en) (comté de Surrey) et mort le 1er décembre 1947 à Cambridge.
Godfrey Harold Hardy est un mathématicien britannique, né le 7 février 1877 à Cranleigh (en) (comté de Surrey) et mort le 1er décembre 1947 à Cambridge.
Il a été lauréat de la médaille Sylvester en 1940 et de la médaille Copley en 1947 ;
il est connu pour ses travaux en théorie des nombres et en analyse.
Les non-mathématiciens le connaissent surtout pour deux choses :
- L'Apologie d'un mathématicien, son essai de 1940 sur l'esthétique des mathématiques avec un certain contenu personnel
qui est peut-être le meilleur témoignage sur la pensée d'un mathématicien au travail ;
- Sa relation particulière comme mentor à partir de 1914 avec le mathématicien indien Srinivasa Ramanujan ;
Hardy reconnut immédiatement le génie inclassable de Ramanujan, pourtant tout séparait ces deux mathématiciens :
Hardy était un athée britannique rigoureux et précis, et Ramanujan un Indien mystique et intuitif, mais ils devinrent amis et collègues ;
dans une interview à Paul Erdős, quand celui-ci lui demanda quelle était sa plus grande contribution aux mathématiques,
Hardy répondit sans hésitation que ce fut la découverte de Ramanujan.
Après sa scolarité à Winchester, Hardy entra au Trinity College (Cambridge) après avoir été quatrième à l'examen du Tripos.
Il appartint à la société secrète des Cambridge Apostles.
Des années plus tard, Hardy a cherché à supprimer le système Tripos ayant estimé que cela devenait une fin en soi au lieu d'être des moyens à une fin.
Hardy est aussi crédité de sa réforme dans les mathématiques britanniques en leur ayant apporté la rigueur, qui avait été précédemment une caractéristique de mathématiques françaises, suisses et allemandes.
Les mathématiciens britanniques étaient largement dans une tradition de mathématiques appliquées, dans la lignée de la réputation d'Isaac Newton ;
Hardy était en harmonie avec les méthodes, dominantes en France, du Cours d'analyse de l'École polytechnique de Camille Jordan, et promouvait de façon agressive sa conception des mathématiques pures, en particulier contre l'hydrodynamique qui était une part importante des mathématiques de Cambridge.
Hardy fut professeur Sadleirien à Cambridge de 1931 à 1942 ;
il quitta Cambridge pour prendre la chaire savilienne de géométrie à Oxford à la suite des conséquences de l'affaire Bertrand Russell pendant la Première Guerre mondiale.
Depuis 1911, il collaborait avec J. E. Littlewood, sur un travail étendu d'analyse et de théorie analytique des nombres.
Cet apport (parmi bien d'autres) fit de quantitatifs progrès sur le problème de Waring, en tant qu'élément de ce qui fut appelé la méthode du cercle de Hardy-Littlewood.
Dans la théorie des nombres premiers ils prouvèrent aussi des résultats et certains résultats conditionnels (en) notables.
Ceci fut un facteur majeur dans le développement de la théorie des nombres comme un système de conjectures ; par exemple, la première et la seconde conjecture de Hardy-Littlewood.
Il est aussi connu pour avoir formulé le principe de Hardy-Weinberg, théorème fondamental en génétique des populations, indépendamment de Wilhelm Weinberg (en) en 1908.
Socialement, il était associé avec le Groupe Bloomsbury et les Cambridge Apostles et fut un fan de cricket avide.
D'après les témoignages de ceux qui l'ont connu le mieux (son collaborateur de longue date J. E. Littlewood, son étudiant Alan Turing, et son ami Charles Percy Snow), Hardy avait une orientation homosexuelle.
On ne connaissait pas à Hardy de petit ami ou de petite amie, de sorte qu'il était apparemment asexuel, « un homosexuel non pratiquant », selon l'expression de Littlewood.
Hardy ne s'est jamais marié, et vers la fin de sa vie, c'est sa sœur qui s'est occupée de lui.
Source Wikipédia: Godfrey Harold Hardy
Johannes Gutenberg 1400 - 1468
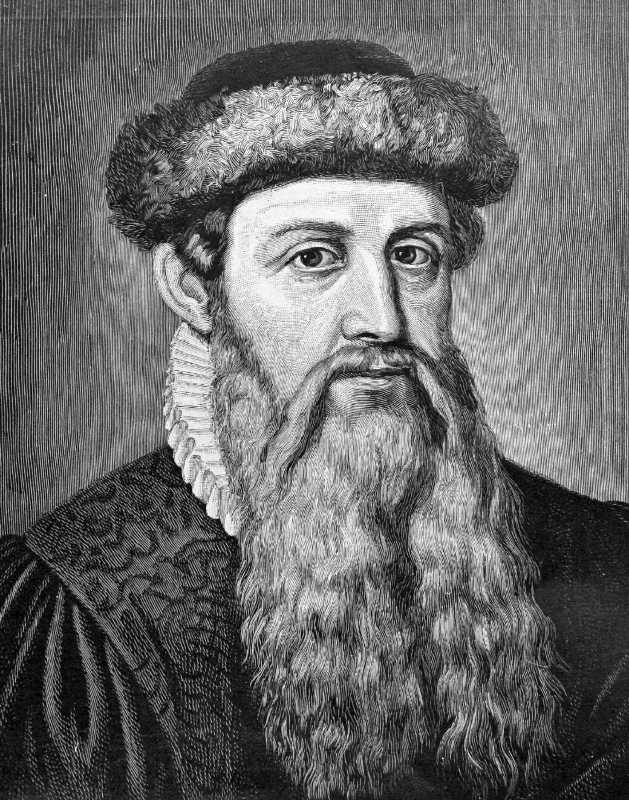 Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, dit Gutenberg (on trouve aussi dans des ouvrages anciens l'orthographe francisée Gutemberg, de même que son prénom est parfois francisé en Jean), né vers 1400 à Mayence dans le Saint-Empire romain germanique et mort le 3 février 1468 dans sa ville natale, est un imprimeur dont l'invention des caractères métalliques mobiles en Europe a été déterminante dans la diffusion des textes et du savoir.
Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, dit Gutenberg (on trouve aussi dans des ouvrages anciens l'orthographe francisée Gutemberg, de même que son prénom est parfois francisé en Jean), né vers 1400 à Mayence dans le Saint-Empire romain germanique et mort le 3 février 1468 dans sa ville natale, est un imprimeur dont l'invention des caractères métalliques mobiles en Europe a été déterminante dans la diffusion des textes et du savoir.
Alors que son invention est considérée comme un événement majeur de la Renaissance, Gutenberg connut une existence difficile.
Associé à Johann Fust et Peter Schoeffer, il perdit en octobre 1455 le procès contre son créancier Fust qui saisit l’atelier avec le matériel et les impressions réalisées. Gutenberg ne sera sauvé de la misère que grâce à Adolphe II de Nassau qui lui accorda une pension à vie et le titre de gentilhomme de sa cour.
La documentation concernant ce personnage est maigre :
on ne connaît que trente-six documents antérieurs à sa mort, la majorité étant des archives judiciaires particulièrement arides et sujettes à diverses interprétations, ce qui a donné lieu à de nombreux portraits fantasmés et ambivalents : génial inventeur ou voleur d'idées, victime dépouillée de son invention ou usurpateur qui aurait exploité un procédé mis au point par d'autres inventeurs avant lui, humaniste ou homme d'affaires uniquement motivé par l'appât du gain.
Johannes Gutenberg, né à Mayence aux alentours de 1400 est le troisième enfant d'une famille aisée de la haute bourgeoisie, celle de Friele Gensfleisch zur Laden, orfèvre de profession mais également commerçant d'étoffes, et d'Else Wirich.
On croit qu'il a été baptisé dans l'église Saint-Christophe proche de sa maison natale.
Les lieux de séjour et les activités de Gutenberg, ne sont pas connus entre 1400 et 1420.
Au regard de ses activités ultérieures et du niveau social de sa famille, des études universitaires sont probables.
En 1429, les corporations d'artisans et de commerçants de la ville libre de Mayence se soulèvent contre le patriarcat oligarchique et forcent les familles dirigeantes à l'exil.
Entre 1434 et 1444 (peut-être dès 1429), la famille Gutenberg s'installe dans le quartier Saint-Arbogast de Strasbourg.
Gutenberg a peut-être été formé à des techniques d'orfèvrerie.
Il se forme notamment à la ciselure et à la maîtrise des alliages, qui constitueront les bases de sa future invention, lui permettant de concevoir des caractères d'imprimerie résistants et reproductibles.
Il s'associe notamment vers 1438 avec le bailli de Lichtenau et des négociants pour fabriquer des enseignes de pèlerinage certaines constituées d'un alliage où dominent le plomb et l'étain, et serties d'un petit miroir, d'autres peut-être constituées d'une feuille de métal estampé, toutes devant être mises en vente lors du pèlerinage d'Aix-la-Chapelle de 1439.
Il n'existe aucune trace de son activité sur les quatre années suivantes. De retour à Mayence en 1448 au plus tard, il poursuit les travaux commencés à Strasbourg et emprunte de l'argent à son cousin Arnold Gelthus pour construire une presse.
NDLR : la suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Johannes Gutenberg
John fitzgerald kennedy 1917 - 1963
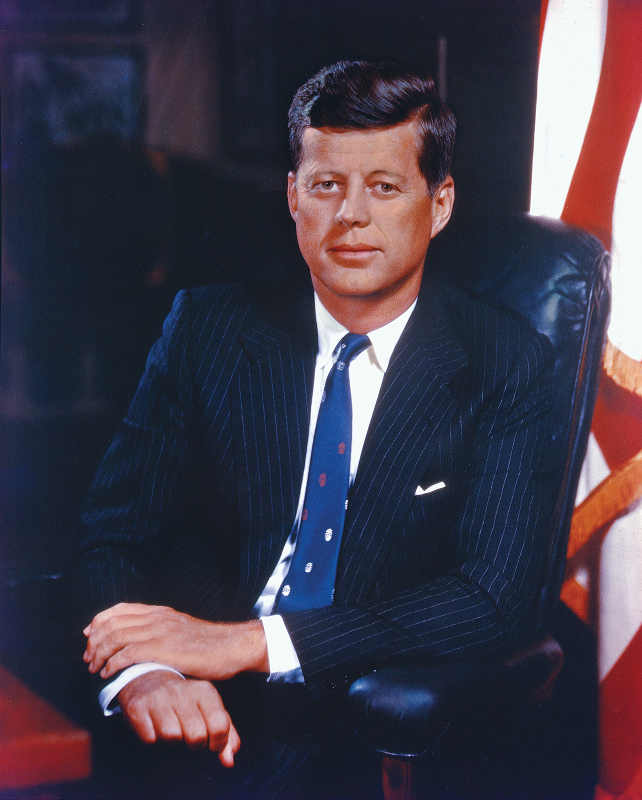 John Fitzgerald Kennedy, dit Jack Kennedy, communément appelé John Kennedy et par ses initiales JFK, né le 29 mai 1917 à Brookline (Massachusetts) et mort assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas (Texas), est un homme d'État américain, 35e président des États-Unis. Entré en fonction le 20 janvier 1961, il est, à 43 ans, le plus jeune président élu des États-Unis, et également le plus jeune président à mourir, moins de trois ans après son entrée à la Maison-Blanche, à l'âge de 46 ans.
John Fitzgerald Kennedy, dit Jack Kennedy, communément appelé John Kennedy et par ses initiales JFK, né le 29 mai 1917 à Brookline (Massachusetts) et mort assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas (Texas), est un homme d'État américain, 35e président des États-Unis. Entré en fonction le 20 janvier 1961, il est, à 43 ans, le plus jeune président élu des États-Unis, et également le plus jeune président à mourir, moins de trois ans après son entrée à la Maison-Blanche, à l'âge de 46 ans.
Il laisse son empreinte dans l'histoire des États-Unis par :
- sa gestion de la crise des missiles de Cuba,
- son autorisation du débarquement de la baie des Cochons,
- son engagement pour le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires,
- le programme Apollo dans le cadre de la course à l'espace,
- son opposition à la construction du mur de Berlin,
- sa politique d'égalité des sexes et son assassinat.
Ses prises de position en faveur de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce lui valent d'être respecté jusque chez les républicains, et le mouvement afro-américain des droits civiques — qu'il soutient, voulant mieux intégrer les minorités dans la société — qui prend place durant sa présidence annonce la déségrégation.
En campagne pour sa réélection, il circule dans Dallas le 22 novembre 1963 à bord d'un véhicule découvert devant un nombreux public et alors qu'il traverse Dealey Plaza, des coups de feu l'atteignent mortellement. Les circonstances de son assassinat par Lee Harvey Oswald, seul coupable reconnu, ont donné lieu à de nombreuses enquêtes, ouvrages écrits et filmés, interprétations et théories du complot au fil des décennies ayant suivi son assassinat.
NDLR : la suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: John Fitzgerald Kennedy
Orville Wright 1871 - 1948
 Les frères Orville Wright (19 août 1871 - 30 janvier 1948 soit 76 ans) et Wilbur Wright (16 avril 1867 - 30 mai 1912 soit 45 ans) sont deux célèbres pionniers américains de l'aviation, à la fois chercheurs, ingénieurs, concepteurs, constructeurs et pilotes.
Les frères Orville Wright (19 août 1871 - 30 janvier 1948 soit 76 ans) et Wilbur Wright (16 avril 1867 - 30 mai 1912 soit 45 ans) sont deux célèbres pionniers américains de l'aviation, à la fois chercheurs, ingénieurs, concepteurs, constructeurs et pilotes.
Après de nombreux vols sur planeurs entre 1900 et 1902, ils effectuent fin 1903 leurs premiers vol motorisés.
Les frères Wright se sont distingués de leurs prédécesseurs et de leurs contemporains par leur approche analytique et expérimentale du problème.
Leur contribution essentielle sera d'avoir correctement analysé la mécanique de vol du virage et d'avoir réalisé, en 1902, les premiers vols contrôlés grâce au couplage de la gouverne de direction et du gauchissement (obtenu par vrillage) des ailes.
Maîtrisant le pilotage, ils effectuent en 1905 les premiers vols pouvant être qualifiés de « contrôlés », de longue durée, avec des virages inclinés et non dérapés.
Cependant, leur obsession du secret autour de leurs machines et de leurs capacités à réaliser un vol motorisé contrôlé (qu'ils maintiendront presque totalement jusqu'à l'obtention de brevet d'invention en 1905) entraînera un scepticisme général, en particulier en Europe, quand ils commenceront à communiquer en 1905 tout en exigeant un contrat commercial ferme avant toute démonstration.
Cela explique le décalage de plusieurs années entre les premiers vols contrôlés de 1905, à l'écart de tout spectateur dans les dunes de Caroline du Nord, et les vols publics de 1908 en France dans la Sarthe où leur maîtrise du pilotage sera reconnue.
Consacrant leur énergie à protéger leur invention et à des luttes de brevets, ils ne remettent pas en cause la configuration atypique de leur machine (configuration canard, pas d'ailerons, pas de roues, hélices à l'arrière), qui est obsolète en 1910 et ne sera pas poursuivie.
NDLR : Il n'y a qu'une seule page Wikipédia pour les deux frères "Orville et Wilbur Wright".
Source Wikipédia: Orville et Wilbur Wright
Wilbur Wright 1867 - 1912
 Les frères Orville Wright (19 août 1871 - 30 janvier 1948 soit 76 ans) et Wilbur Wright (16 avril 1867 - 30 mai 1912 soit 45 ans) sont deux célèbres pionniers américains de l'aviation, à la fois chercheurs, ingénieurs, concepteurs, constructeurs et pilotes.
Les frères Orville Wright (19 août 1871 - 30 janvier 1948 soit 76 ans) et Wilbur Wright (16 avril 1867 - 30 mai 1912 soit 45 ans) sont deux célèbres pionniers américains de l'aviation, à la fois chercheurs, ingénieurs, concepteurs, constructeurs et pilotes.
Après de nombreux vols sur planeurs entre 1900 et 1902, ils effectuent fin 1903 leurs premiers vol motorisés.
Les frères Wright se sont distingués de leurs prédécesseurs et de leurs contemporains par leur approche analytique et expérimentale du problème.
Leur contribution essentielle sera d'avoir correctement analysé la mécanique de vol du virage et d'avoir réalisé, en 1902, les premiers vols contrôlés grâce au couplage de la gouverne de direction et du gauchissement (obtenu par vrillage) des ailes.
Maîtrisant le pilotage, ils effectuent en 1905 les premiers vols pouvant être qualifiés de « contrôlés », de longue durée, avec des virages inclinés et non dérapés.
Cependant, leur obsession du secret autour de leurs machines et de leurs capacités à réaliser un vol motorisé contrôlé (qu'ils maintiendront presque totalement jusqu'à l'obtention de brevet d'invention en 1905) entraînera un scepticisme général, en particulier en Europe, quand ils commenceront à communiquer en 1905 tout en exigeant un contrat commercial ferme avant toute démonstration.
Cela explique le décalage de plusieurs années entre les premiers vols contrôlés de 1905, à l'écart de tout spectateur dans les dunes de Caroline du Nord, et les vols publics de 1908 en France dans la Sarthe où leur maîtrise du pilotage sera reconnue.
Consacrant leur énergie à protéger leur invention et à des luttes de brevets, ils ne remettent pas en cause la configuration atypique de leur machine (configuration canard, pas d'ailerons, pas de roues, hélices à l'arrière), qui est obsolète en 1910 et ne sera pas poursuivie.
NDLR : Il n'y a qu'une seule page Wikipédia pour les deux frères "Orville et Wilbur Wright".
Source Wikipédia: Orville et Wilbur Wright
Ennio Morricone 1928-2020
 Ennio Morricone, né le 10 novembre 1928 à Rome et mort le 6 juillet 2020 dans la même ville, est un compositeur, musicien, producteur, arrangeur musical et chef d'orchestre italien.
Ennio Morricone, né le 10 novembre 1928 à Rome et mort le 6 juillet 2020 dans la même ville, est un compositeur, musicien, producteur, arrangeur musical et chef d'orchestre italien.
Il est mondialement connu pour ses musiques de films pour lesquelles il est considéré comme un des meilleurs compositeurs. Entre les années 1960 et 2020, il a composé plus de 500 musiques pour le cinéma et la télévision.
Parmi ses musiques les plus connues figurent celles réalisées pour les films Pour une poignée de dollars, Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois en Amérique, Sacco et Vanzetti, Les Moissons du ciel, Le Professionnel, Mission et Les Incorruptibles, Le Clan des Siciliens.
En 2007, il est récompensé par un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Six fois nommé pour l'Oscar de la meilleure musique de film, il remporte une seule fois cette récompense en 2016 à l'âge de 87 ans pour le film Les Huit Salopards de Quentin Tarantino.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Ennio Morricone 1928-2020
Aaron Klug 1926 - 2018
 Aaron Klug (11 août 1926 à Zelvas (Lituanie) et mort le 20 novembre 2018 à Cambridge (Royaume-Uni)1) est un physicien biologique et chimiste britannique d'origine juive lituanienne.
Aaron Klug (11 août 1926 à Zelvas (Lituanie) et mort le 20 novembre 2018 à Cambridge (Royaume-Uni)1) est un physicien biologique et chimiste britannique d'origine juive lituanienne.
Il reçut le prix Nobel de chimie en 19822.
Parti vivre à l'âge de deux ans à Durban en Afrique du Sud, Aaron Klug fit ses études à l'université du Witwatersrand à Johannesburg et étudia la cristallographie à l'université du Cap, avant de partir en Angleterre, complétant son doctorat au Trinity College de Cambridge en 1953.
Travaillant avec Rosalind Franklin chez le professeur John Desmond Bernal à Londres, il montra un grand intérêt pour l'étude des virus, et fit des découvertes sur les structures de certains d'entre eux.
Pendant les années 1970, Klug utilisa les méthodes de diffraction de rayons X, de microscopie et de modélisation structurale pour développer la microscopie électronique cristallographique avec une séquence d'images en deux dimensions de cristaux prises sous différents angles et combinées pour produire des images tridimensionnelles.
Ces travaux lui valurent la médaille Copley en 1985.
En 1982, il est lauréat du prix Nobel de chimie « pour son développement de la microscopie électronique cristallographique et ses découvertes sur la structure des complexes protéines-acides nucléiques biologiquement importants».
Entre 1986 et 1996 il fut le directeur du Laboratory of Molecular Biology de Cambridge et fut anobli en 19883. Il fut de plus président de la Royal Society de 1995 à 2000.
Source Wikipédia: Aaron Klug
Louis Pasteur 1822 - 1895
 Louis Pasteur, né à Dole (Jura) le 27 décembre 1822 et mort à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine, à cette époque en Seine-et-Oise) le 28 septembre 1895, est un scientifique français, chimiste et physicien de formation. Pionnier de la microbiologie, il connut, de son vivant même, une grande notoriété pour avoir mis au point un vaccin contre la rage. Il fut également candidat sans étiquette à l'élection présidentielle française de 1887, mais ne reçut que deux voix, soit 0,24%.
Louis Pasteur, né à Dole (Jura) le 27 décembre 1822 et mort à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine, à cette époque en Seine-et-Oise) le 28 septembre 1895, est un scientifique français, chimiste et physicien de formation. Pionnier de la microbiologie, il connut, de son vivant même, une grande notoriété pour avoir mis au point un vaccin contre la rage. Il fut également candidat sans étiquette à l'élection présidentielle française de 1887, mais ne reçut que deux voix, soit 0,24%.
Louis Pasteur est né à deux heures du matin le 27 décembre 1822 dans la maison familiale de Dole, troisième enfant de Jean-Joseph Pasteur et de Jeanne-Étiennette Roqui. Il est baptisé dans la Collégiale Notre-Dame de Dole le 15 janvier 1823. Son père, après avoir été sergent dans l’armée napoléonienne, reprit la profession familiale de tanneur. En 1827, la famille quitte Dole pour Marnoz, lieu de la maison familiale des Roqui, pour finalement s'installer dans une nouvelle maison en 1830 à Arbois, localité plus propice à l'activité de tannage. Le jeune Pasteur suit à Arbois les cours d'enseignement mutuel puis entre au collège de la ville. C'est à cette époque qu'il se fait connaître pour ses talents de peintre ; il a d'ailleurs fait de nombreux portraits de membres de sa famille et des habitants de la petite ville.
Il part au lycée royal de Besançon. Puis, en octobre 1838, il le quitte pour l'Institution Barbet, à Paris, afin de se préparer au baccalauréat puis aux concours. Cependant, déprimé par cette nouvelle vie, il renonce à son projet, quitte Paris et termine son année scolaire 1838-1839 au collège d'Arbois. À la rentrée 1839, il réintègre le collège royal de Franche-Comté, à Besançon. En 1840, il obtient le baccalauréat en lettres puis, en 1842, après un échec, le baccalauréat en sciences mathématiques. Pasteur retourne à Paris en novembre. Logé à la pension Barbet, où il fait aussi office de répétiteur, il suit les cours du lycée Saint-Louis et assiste avec enthousiasme à ceux donnés à la Sorbonne par le chimiste Jean-Baptiste Dumas ; il a pu également prendre quelques leçons avec Claude Pouillet. En 1843, il est finalement admis — quatrième — à l'École normale. Plus tard il sera élève de Jean-Baptiste Boussingault au Conservatoire national des arts et métiers.
Il se marie le 29 mai 1849 avec Marie Laurent, fille du recteur de la faculté de Strasbourg. Ensemble ils ont cinq enfants : Jeanne (1850-1859), Jean Baptiste (1851-1908) sans descendance, Cécile Marie Louise Marguerite – dite Cécile – (1853-1866), Marie-Louise (1858-1934) mariée en 1879 avec René Vallery-Radot, et Camille (1863-1865). De l'union de Marie-Louise et de René Vallery-Radot sont issus Camille Vallery-Radot (1880-1927), sans descendance, et Louis Pasteur Vallery-Radot (1886-1970), membre de l'Académie française et de l'Académie de Médecine, également sans enfant et dernier descendant de Pasteur.
Son épouse Marie, dont Émile Roux dit qu'« elle a été le meilleur collaborateur de Louis Pasteur », écrit sous sa dictée, réalise les revues de presse et veille à son image puis à sa mémoire jusqu'à sa mort, en 1910.
À l'École normale, Pasteur étudie la chimie et la physique, ainsi que la cristallographie. Il devient agrégé-préparateur de chimie, dans le laboratoire d'Antoine-Jérôme Balard, et soutient en 1847 à la faculté des sciences de Paris ses thèses pour le doctorat en sciences. Ses travaux sur la chiralité moléculaire lui vaudront la médaille Rumford en 1856.
Il est professeur à Dijon puis à Strasbourg de 1848 à 1853. Le 19 janvier 1849, il est nommé professeur suppléant à la faculté des sciences de Strasbourg ; il occupe également la suppléance de la chaire de chimie à l’école de pharmacie de cette même ville, du 4 juin 1849 au 17 janvier 1851.
En 1853 il est fait chevalier de la Légion d'honneur.
En février 1854, pour avoir le temps de mener à bien des travaux qui puissent lui valoir le titre de correspondant de l'Institut, il se fait octroyer un congé rémunéré de trois mois à l'aide d'un certificat médical de complaisance. Il fait prolonger le congé jusqu'au 1er août, date du début des examens. « Je dis au Ministre que j'irai faire les examens, afin de ne pas augmenter les embarras du service. C'est aussi pour ne pas laisser à un autre une somme de 6 ou 700 francs ».
NDLR : Vu l’immensité du sujet, je vous invite à poursuivre sur le site officiel de Wikipédia.
Source Wikipédia: Louis Pasteur
Erin Brockovich
Film sur Erin Brockovitch : Erin Brockovich, seule contre tous
 Erin Brockovich-Ellis (née Erin L. E. Pattee le 22 juin 1960 à Lawrence, Kansas, États-Unis) est une autodidacte, devenue adjointe juridique et militante de l'environnement.
Erin Brockovich-Ellis (née Erin L. E. Pattee le 22 juin 1960 à Lawrence, Kansas, États-Unis) est une autodidacte, devenue adjointe juridique et militante de l'environnement.
Elle est connue pour avoir révélé une affaire de pollution des eaux potables à Hinkley (en) (Californie) par la société Pacific Gas and Electric Company (PG&E), condamnée en 1993.
Cette pollution a entraîné des morts et maladies graves comme des cancers.
Elle étudie à l'université d'État du Kansas, continue dans les arts appliqués, puis travaille pour la chaîne Kmart et devient « Miss côte ouest des USA ».
Malgré un manque de formation en droit, elle réussit à se faire embaucher dans un petit cabinet d'avocats et, intriguée par des dossiers d'indemnisations immobilières croisés avec des requêtes en soins médicaux sur les mêmes personnes, elle enquête, découvre des causes probables de pollution par le chrome hexavalent dans les eaux potables, instruit le dossier des centaines de victimes et leur fait obtenir un dédommagement élevé (333 millions $US) auprès de la société Pacific Gas and Electric Company (PG&E) de Californie en 1993.
Erin Brockovich est ensuite animatrice des séries télévisées Challenge America with Erin Brockovich sur la chaîne ABC et Final Justice sur Lifetime.
En mars 2009, elle demande à l'ambassadeur des États-Unis en Grèce de pousser pour la résolution du problème de la pollution de l'Asopos qui contient entre autres du chrome hexavalent.
En 2016, elle est présidente de Brockovich Research & Consulting et poursuit l'instruction d'affaires similaires.
Son histoire est racontée dans le film portant son nom : Erin Brockovich, seule contre tous (2000), où elle est incarnée par Julia Roberts, qui obtient un Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle.
Elle y fait elle-même une courte apparition, dans le rôle d'une serveuse portant un badge marqué Julia.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Erin Brockovich
Charles de Gaulle 1890 - 1970
 Charles de Gaulle, communément appelé le général de Gaulle ou parfois simplement le Général, né le 22 novembre 1890 à Lille et mort le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises, est un militaire, résistant, homme d'État et écrivain français.
Charles de Gaulle, communément appelé le général de Gaulle ou parfois simplement le Général, né le 22 novembre 1890 à Lille et mort le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises, est un militaire, résistant, homme d'État et écrivain français.
Il est notamment chef de la France libre puis
dirigeant du Comité français de libération nationale pendant la Seconde Guerre mondiale,
président du Gouvernement provisoire de la République française de 1944 à 1946,
président du Conseil des ministres de 1958 à 1959,
instigateur de la Cinquième République, fondée en 1958,
et président de la République de 1959 à 1969, étant le premier à occuper la magistrature suprême sous ce régime.
Élevé dans une culture de grandeur nationale, Charles de Gaulle choisit une carrière d'officier.
Au cours de la Première Guerre mondiale, il est blessé et fait prisonnier.
Par la suite, il sert et publie dans l'entourage de Philippe Pétain, prônant auprès de personnalités politiques l'usage des divisions de blindés dans la guerre contemporaine.
En mai 1940, devenu colonel, il est placé à la tête d'une division blindée et mène plusieurs contre-attaques pendant la bataille de France ; il est dans la foulée promu général de brigade à titre temporaire.
Pendant l'exode qui suit, il est sous-secrétaire d'État à la Guerre et à la Défense nationale dans le gouvernement Reynaud.
Rejetant l'armistice demandé par Pétain à l'Allemagne nazie, il lance de Londres, à la BBC, l'« appel du 18 Juin », qui incite le peuple français à résister et à rejoindre les Forces françaises libres.
Condamné à mort par contumace et déclaré déchu de la nationalité française par le régime de Vichy, il entend incarner la légitimité de la France et être reconnu en tant que puissance par les Alliés.
Ne contrôlant que quelques colonies, mais reconnu par la Résistance, il entretient des relations froides avec Franklin Roosevelt, mais bénéficie généralement de l'appui de Winston Churchill.
En 1943, il fusionne la France libre au sein du Comité français de libération nationale, dont il finit par prendre la direction.
Il dirige le pays à partir de la Libération ; favorable à un pouvoir exécutif fort, il s'oppose aux projets parlementaires et démissionne en 1946.
Il fonde l'année suivante le Rassemblement du peuple français (RPF), mais son refus de tout compromis avec le « régime des partis » l'écarte de toute responsabilité.
Il revient au pouvoir après la crise de mai 1958, dans le cadre de la guerre d'Algérie. Investi président du Conseil, il fait approuver la Cinquième République par un référendum.
Élu président de la République par un collège élargi de grands électeurs, il prône une « politique de grandeur » de la France.
Il affermit les institutions, la monnaie (nouveau franc) et donne un rôle de troisième voie économique à un État planificateur et modernisateur de l'industrie.
Il renonce par étapes à l'Algérie française malgré l'opposition des pieds-noirs et des militaires, qui avaient favorisé son retour.
Il poursuit la décolonisation de l'Afrique noire et y maintient l'influence française.
En rupture avec le fédéralisme européen et le partage de Yalta, de Gaulle défend l'« indépendance nationale » : il préconise une « Europe des nations » impliquant la réconciliation franco-allemande et qui irait « de l'Atlantique à l'Oural », réalise la force de dissuasion nucléaire française, retire la France du commandement militaire de l'OTAN, oppose un veto à l'entrée du Royaume-Uni dans la Communauté européenne, soutient le « Québec libre », condamne la guerre du Viêt Nam et reconnaît la Chine communiste.
Sa vision du pouvoir, c'est-à-dire un chef directement approuvé par la Nation, l'oppose aux partis communiste, socialiste et centristes pro-européens.
Ces formations critiquent un style de gouvernance trop personnel, voire un « coup d'État permanent », selon la formule du socialiste François Mitterrand, contre lequel de Gaulle est réélu en 1965 au suffrage universel direct — un mode de scrutin qu’il a fait adopter par référendum en 1962 à la suite de l’attentat du Petit-Clamart le visant.
Il surmonte la crise de Mai 68 après avoir semblé se retirer, convoquant des élections législatives qui envoient une écrasante majorité gaulliste à l'Assemblée nationale.
Mais en 1969, il engage son mandat sur un référendum (sur la réforme du Sénat et la régionalisation) et démissionne après la victoire du « non ».
Il se retire dans sa propriété de Colombey-les-Deux-Églises, où il meurt dix-huit mois plus tard.
Considéré comme l'un des dirigeants français les plus influents de l'histoire, Charles de Gaulle est aussi un écrivain de renom.
Il laisse notamment des Mémoires de guerre, où il affirme s'être toujours « fait une certaine idée de la France », jugeant que « la France ne peut être la France sans la grandeur ».
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Charles de Gaulle
Adolf Hitler 1889 1945
Trailer du film: Hitler, la naissance du mal
Wikipédia : Adolf Hitler
.jpg) Adolf Hitler est un idéologue et homme d'État allemand, né le 20 avril 1889 à Braunau am Inn en Autriche-Hongrie (aujourd'hui en Autriche et toujours ville-frontière avec l’Allemagne) et mort par suicide le 30 avril 1945 à Berlin. Fondateur et figure centrale du nazisme, il prend le pouvoir en Allemagne en 1933 et instaure une dictature totalitaire, impérialiste, antisémite, raciste et xénophobe désignée sous le nom de Troisième Reich.
Membre du Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP, le parti nazi), créé en 1920, il s'impose à la tête du mouvement en 1921 et tente en 1923 un coup d'État qui échoue. Il met à profit sa courte peine de prison pour rédiger le livre Mein Kampf dans lequel il expose ses conceptions racistes et ultranationalistes.
Dans les années 1920, dans un climat de violence politique, il occupe une place croissante dans la vie publique allemande jusqu'à devenir chancelier le 30 janvier 1933, pendant la Grande Dépression. Son régime met très rapidement en place les premiers camps de concentration destinés à la répression des opposants politiques (notamment socialistes, communistes et syndicalistes). En août 1934, après une violente opération d’élimination physique d’opposants et rivaux — connue sous le nom de nuit des Longs Couteaux — et la mort du vieux maréchal Hindenburg, président du Reich, il se fait plébisciter chef de l'État. Il porte dès lors le double titre de « Führer » (en français : « guide ») et « chancelier du Reich », sabordant ainsi la république de Weimar et mettant fin à la première démocratie parlementaire en Allemagne. La politique qu'il conduit est pangermaniste, antisémite, revanchiste et belliqueuse. Son régime adopte en 1935 une législation anti-juive et les nazis prennent le contrôle de la société allemande (travailleurs, jeunesse, médias et cinéma, industrie, sciences, etc.).
Adolf Hitler est un idéologue et homme d'État allemand, né le 20 avril 1889 à Braunau am Inn en Autriche-Hongrie (aujourd'hui en Autriche et toujours ville-frontière avec l’Allemagne) et mort par suicide le 30 avril 1945 à Berlin. Fondateur et figure centrale du nazisme, il prend le pouvoir en Allemagne en 1933 et instaure une dictature totalitaire, impérialiste, antisémite, raciste et xénophobe désignée sous le nom de Troisième Reich.
Membre du Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP, le parti nazi), créé en 1920, il s'impose à la tête du mouvement en 1921 et tente en 1923 un coup d'État qui échoue. Il met à profit sa courte peine de prison pour rédiger le livre Mein Kampf dans lequel il expose ses conceptions racistes et ultranationalistes.
Dans les années 1920, dans un climat de violence politique, il occupe une place croissante dans la vie publique allemande jusqu'à devenir chancelier le 30 janvier 1933, pendant la Grande Dépression. Son régime met très rapidement en place les premiers camps de concentration destinés à la répression des opposants politiques (notamment socialistes, communistes et syndicalistes). En août 1934, après une violente opération d’élimination physique d’opposants et rivaux — connue sous le nom de nuit des Longs Couteaux — et la mort du vieux maréchal Hindenburg, président du Reich, il se fait plébisciter chef de l'État. Il porte dès lors le double titre de « Führer » (en français : « guide ») et « chancelier du Reich », sabordant ainsi la république de Weimar et mettant fin à la première démocratie parlementaire en Allemagne. La politique qu'il conduit est pangermaniste, antisémite, revanchiste et belliqueuse. Son régime adopte en 1935 une législation anti-juive et les nazis prennent le contrôle de la société allemande (travailleurs, jeunesse, médias et cinéma, industrie, sciences, etc.).
Source Wikipédia: Adolf Hitler
Albert Abraham Michelson 1852 - 1931
 Albert Abraham Michelson, né le 19 décembre 1852 à Strelno en Prusse dans la province de Posnanie et mort le 9 mai 1931 à Pasadena, en Californie, est un physicien américain. Il a reçu le prix Nobel de physique de 1907 « pour ses instruments optiques de précision et les études spectroscopiques et métrologiques qu'il a menés grâce à ces appareils », devenant ainsi le premier récipiendaire américain du prix de physique. Il reçut par ailleurs la médaille Copley la même année.
Albert Abraham Michelson, né le 19 décembre 1852 à Strelno en Prusse dans la province de Posnanie et mort le 9 mai 1931 à Pasadena, en Californie, est un physicien américain. Il a reçu le prix Nobel de physique de 1907 « pour ses instruments optiques de précision et les études spectroscopiques et métrologiques qu'il a menés grâce à ces appareils », devenant ainsi le premier récipiendaire américain du prix de physique. Il reçut par ailleurs la médaille Copley la même année.
Source Wikipédia: Albert Abraham Michelson
Albert Einstein 1879 - 1955
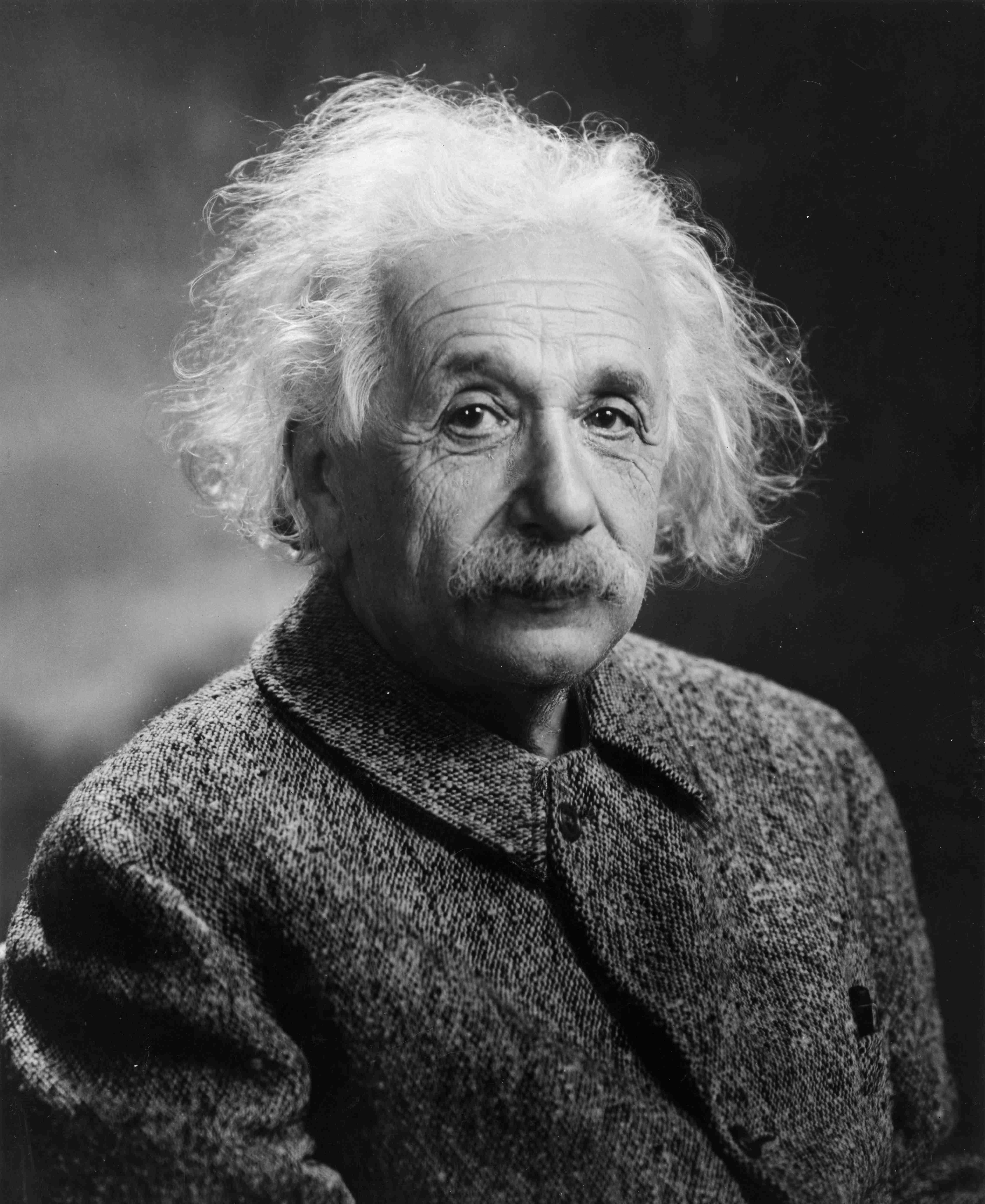 Albert Einstein né le 14 mars 1879 à Ulm, dans le Wurtemberg (Empire allemand), et mort le 18 avril 1955 à Princeton, dans le New Jersey (États-Unis),
est un physicien théoricien. Il fut successivement allemand, apatride (1896), suisse (1901) et de double nationalité helvético-américaine (1940). Il épousa Mileva Marić, puis sa cousine Elsa Einstein.
Il publie sa théorie de la relativité restreinte en 1905 et sa théorie de la gravitation, dite relativité générale, en 1915. Il contribue largement au développement de la mécanique quantique et de la cosmologie,
et reçoit le prix Nobel de physique de 1921 pour son explication de l’effet photoélectrique. Son travail est notamment connu du grand public pour l’équation E=mc2, qui établit une équivalence entre la masse et l’énergie d’un système.
Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire, et sa renommée dépasse largement le milieu scientifique. Il est la personnalité du XXe siècle selon l'hebdomadaire Time.
Dans la culture populaire, son nom et sa personne sont directement liés aux notions d'intelligence, de savoir et de génie.
Albert Einstein né le 14 mars 1879 à Ulm, dans le Wurtemberg (Empire allemand), et mort le 18 avril 1955 à Princeton, dans le New Jersey (États-Unis),
est un physicien théoricien. Il fut successivement allemand, apatride (1896), suisse (1901) et de double nationalité helvético-américaine (1940). Il épousa Mileva Marić, puis sa cousine Elsa Einstein.
Il publie sa théorie de la relativité restreinte en 1905 et sa théorie de la gravitation, dite relativité générale, en 1915. Il contribue largement au développement de la mécanique quantique et de la cosmologie,
et reçoit le prix Nobel de physique de 1921 pour son explication de l’effet photoélectrique. Son travail est notamment connu du grand public pour l’équation E=mc2, qui établit une équivalence entre la masse et l’énergie d’un système.
Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire, et sa renommée dépasse largement le milieu scientifique. Il est la personnalité du XXe siècle selon l'hebdomadaire Time.
Dans la culture populaire, son nom et sa personne sont directement liés aux notions d'intelligence, de savoir et de génie.
Source Wikipédia: Albert Einstein
Alexander Fleming 1881 - 1955
 Alexander Fleming est un médecin, biologiste et pharmacologue britannique, né le 6 août 1881 à Darvel, Ayrshire en Écosse et mort le 11 mars 1955 à Londres. Il a publié de nombreux articles concernant la bactériologie, l'immunologie et la chimiothérapie.
Ses découvertes les plus connues sont celle de l'antibiotique appelé pénicilline qu'il a isolée à partir du champignon Penicillium notatum en 1928, découverte pour laquelle il a partagé le prix Nobel de physiologie ou médecine avec Howard Walter Florey et Ernst Boris Chain en 1945, et celle de l'enzyme lysozyme en 1922.
En fait, il n'a fait qu une redécouverte puisque, dès la fin du XIXe siècle dans sa thèse de pharmacie, Ernest Duchesne, élève officier pharmacien de l'école de santé militaire de Lyon, avait fortement évoqué le rôle antibiotique des pénicillium.
Alexander Fleming est un médecin, biologiste et pharmacologue britannique, né le 6 août 1881 à Darvel, Ayrshire en Écosse et mort le 11 mars 1955 à Londres. Il a publié de nombreux articles concernant la bactériologie, l'immunologie et la chimiothérapie.
Ses découvertes les plus connues sont celle de l'antibiotique appelé pénicilline qu'il a isolée à partir du champignon Penicillium notatum en 1928, découverte pour laquelle il a partagé le prix Nobel de physiologie ou médecine avec Howard Walter Florey et Ernst Boris Chain en 1945, et celle de l'enzyme lysozyme en 1922.
En fait, il n'a fait qu une redécouverte puisque, dès la fin du XIXe siècle dans sa thèse de pharmacie, Ernest Duchesne, élève officier pharmacien de l'école de santé militaire de Lyon, avait fortement évoqué le rôle antibiotique des pénicillium.
Source Wikipédia: Alexander Fleming
Alexander Graham Bell 1847 - 1922
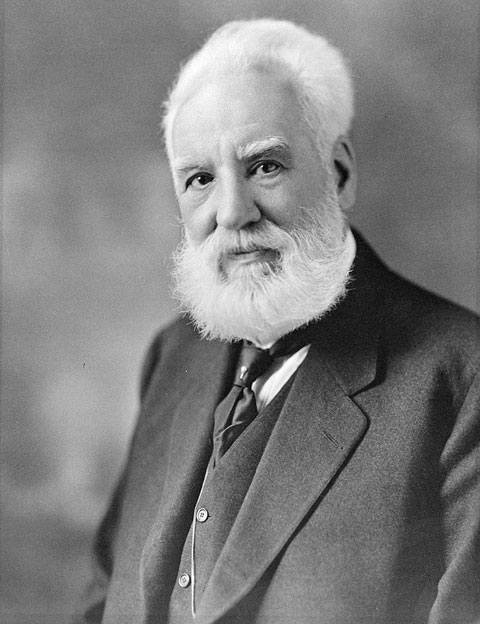 Alexander Graham Bell, né le 3 mars 1847 à Édimbourg en Écosse et mort le 2 août 1922 à Beinn Bhreagh au Canada, est un scientifique, un ingénieur et un inventeur scotto-canadien, naturalisé américain en 1882, qui est surtout connu pour l'invention du téléphone, pour laquelle l'antériorité d'Antonio Meucci a depuis été officiellement reconnue le 11 juin 2002 par la Chambre des représentants des États-Unis. Il a été lauréat de la médaille Hughes en 1913.
La mère et la femme (Mabel Gardiner Hubbard) d'Alexander Bell étaient sourdes, ce qui a encouragé Bell à consacrer sa vie à apprendre à parler aux sourds. Il était en effet professeur de diction à l'université de Boston et un spécialiste de l'élocution, profession connue aujourd'hui sous les noms de phonologue ou phoniatre. Le père, le grand-père et le frère de Bell se sont joints à son travail sur l'élocution et la parole. Ses recherches sur l'audition et la parole l'ont conduit à construire des appareils auditifs, dont le couronnement fut le premier brevet pour un téléphone en 1876. Toutefois, Bell considéra par la suite son invention la plus connue comme une intrusion dans son travail de scientifique et refusa même d'avoir un téléphone dans son laboratoire.
D'autres inventions marquèrent la vie d'Alexander Graham Bell : les travaux exploratoires en télécommunications optiques, l'hydroptère en aéronautique. En 1888, il devint l'un des membres fondateurs de la National Geographic Society.
Alexander Graham Bell, né le 3 mars 1847 à Édimbourg en Écosse et mort le 2 août 1922 à Beinn Bhreagh au Canada, est un scientifique, un ingénieur et un inventeur scotto-canadien, naturalisé américain en 1882, qui est surtout connu pour l'invention du téléphone, pour laquelle l'antériorité d'Antonio Meucci a depuis été officiellement reconnue le 11 juin 2002 par la Chambre des représentants des États-Unis. Il a été lauréat de la médaille Hughes en 1913.
La mère et la femme (Mabel Gardiner Hubbard) d'Alexander Bell étaient sourdes, ce qui a encouragé Bell à consacrer sa vie à apprendre à parler aux sourds. Il était en effet professeur de diction à l'université de Boston et un spécialiste de l'élocution, profession connue aujourd'hui sous les noms de phonologue ou phoniatre. Le père, le grand-père et le frère de Bell se sont joints à son travail sur l'élocution et la parole. Ses recherches sur l'audition et la parole l'ont conduit à construire des appareils auditifs, dont le couronnement fut le premier brevet pour un téléphone en 1876. Toutefois, Bell considéra par la suite son invention la plus connue comme une intrusion dans son travail de scientifique et refusa même d'avoir un téléphone dans son laboratoire.
D'autres inventions marquèrent la vie d'Alexander Graham Bell : les travaux exploratoires en télécommunications optiques, l'hydroptère en aéronautique. En 1888, il devint l'un des membres fondateurs de la National Geographic Society.
Source Wikipédia: Alexander Graham Bell
Oskar Schindler 1908 - 1974 ==> Le film: La liste Schindler
 Oskar Schindler, né le 28 avril 1908 à Zwittau (à l'extrême Ouest du margraviat de Moravie et mort le 9 octobre 1974 à Hildesheim, en Allemagne, est un industriel allemand.
Durant la Shoah, il sauve entre 1 100 et 1 200 Juifs en les faisant travailler dans ses fabriques d'émail et de munitions situées respectivement dans le Gouvernement général de Pologne et dans le protectorat de Bohême-Moravie.
Il est honoré du titre de « Juste parmi les nations », par le Mémorial de Yad Vashem, en 1967. Sa vie est le sujet d'un roman de Thomas Keneally (La Liste de Schindler) en 1982 et d'un film (du même nom) de Steven Spielberg en 1993. Il est enterré au cimetière chrétien du mont Sion à Jérusalem.
Oskar Schindler, né le 28 avril 1908 à Zwittau (à l'extrême Ouest du margraviat de Moravie et mort le 9 octobre 1974 à Hildesheim, en Allemagne, est un industriel allemand.
Durant la Shoah, il sauve entre 1 100 et 1 200 Juifs en les faisant travailler dans ses fabriques d'émail et de munitions situées respectivement dans le Gouvernement général de Pologne et dans le protectorat de Bohême-Moravie.
Il est honoré du titre de « Juste parmi les nations », par le Mémorial de Yad Vashem, en 1967. Sa vie est le sujet d'un roman de Thomas Keneally (La Liste de Schindler) en 1982 et d'un film (du même nom) de Steven Spielberg en 1993. Il est enterré au cimetière chrétien du mont Sion à Jérusalem.
Source Wikipédia: Oskar Schindler
Srinivasa Ramanujan 1887-1920
Voir le trailer du film sur Ramanujan :
Trailer : L'homme qui défiait l'infini.
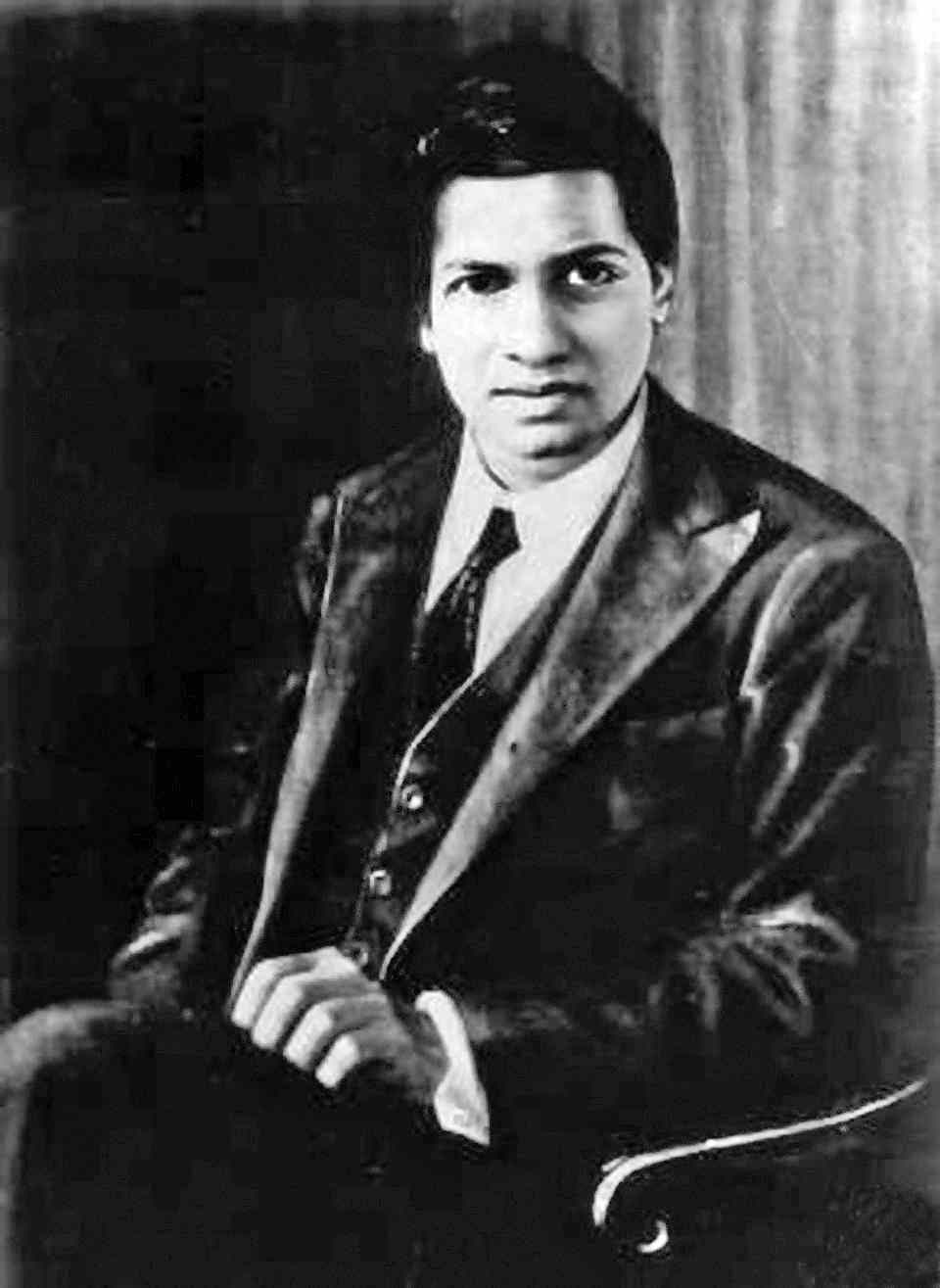 Srinivasa Ramanujan, né le 22 décembre 1887 à Erode et mort le 26 avril 1920 à Kumbakonam, est un mathématicien indien.
Issu d'une famille modeste de brahmanes orthodoxes, il est autodidacte, faisant toujours preuve d'une pensée indépendante et originale. Il apprend seul les mathématiques à partir de deux livres qu'il s'est procurés avant l'âge de seize ans, ouvrages qui lui permettent d'établir une grande quantité de résultats sur la théorie des nombres, sur les fractions continues et sur les séries divergentes, tandis qu'il se crée son propre système de notations. Jugeant son entourage académique dépassé, il publie plusieurs articles dans des journaux mathématiques indiens et tente d'intéresser les mathématiciens européens à son travail par des lettres qu'il leur envoie.
Une de ces lettres, envoyée en janvier 1913 à Godfrey Harold Hardy, contient une longue liste de formules et de théorèmes sans démonstration. Hardy considère tout d'abord cet envoi inhabituel comme une supercherie, puis en discute longuement avec John Littlewood pour aboutir à la conviction que son auteur est certainement un « génie », un qualificatif souvent repris de nos jours. Hardy répond en invitant Ramanujan à venir en Angleterre ; une collaboration fructueuse, en compagnie de Littlewood, en résulte.
Affecté toute sa vie par des problèmes de santé, Ramanujan voit son état empirer lors de son séjour en Angleterre ; il retourne en Inde en 1919 où il meurt peu de temps après à Kumbakonam à l'âge de trente-deux ans. Il laisse derrière lui des cahiers entiers de résultats non démontrés (appelés les cahiers de Ramanujan) qui, en ce début de XXIe siècle, continuent à être étudiés.
Ramanujan a travaillé principalement sur les fonctions elliptiques et sur la théorie analytique des nombres ; il est devenu célèbre pour ses résultats calculatoires impliquant des constantes telles que π et e, les nombres premiers ou encore la fonction partition d'un entier, qu'il a étudiée avec Hardy. Grand créateur de formules mathématiques, il en a inventé plusieurs milliers qui se sont pratiquement toutes révélées exactes, mais dont certaines ne purent être démontrées qu'après 1980 ; à propos de certaines d'entre elles, Hardy, stupéfié par leur originalité, a déclaré qu’« un seul coup d'œil suffisait à se rendre compte qu'elles ne pouvaient être pensées que par un mathématicien de tout premier rang. Elles devaient être vraies, car si elles avaient été fausses, personne n'aurait eu assez d'imagination pour les inventer ».
Srinivasa Ramanujan, né le 22 décembre 1887 à Erode et mort le 26 avril 1920 à Kumbakonam, est un mathématicien indien.
Issu d'une famille modeste de brahmanes orthodoxes, il est autodidacte, faisant toujours preuve d'une pensée indépendante et originale. Il apprend seul les mathématiques à partir de deux livres qu'il s'est procurés avant l'âge de seize ans, ouvrages qui lui permettent d'établir une grande quantité de résultats sur la théorie des nombres, sur les fractions continues et sur les séries divergentes, tandis qu'il se crée son propre système de notations. Jugeant son entourage académique dépassé, il publie plusieurs articles dans des journaux mathématiques indiens et tente d'intéresser les mathématiciens européens à son travail par des lettres qu'il leur envoie.
Une de ces lettres, envoyée en janvier 1913 à Godfrey Harold Hardy, contient une longue liste de formules et de théorèmes sans démonstration. Hardy considère tout d'abord cet envoi inhabituel comme une supercherie, puis en discute longuement avec John Littlewood pour aboutir à la conviction que son auteur est certainement un « génie », un qualificatif souvent repris de nos jours. Hardy répond en invitant Ramanujan à venir en Angleterre ; une collaboration fructueuse, en compagnie de Littlewood, en résulte.
Affecté toute sa vie par des problèmes de santé, Ramanujan voit son état empirer lors de son séjour en Angleterre ; il retourne en Inde en 1919 où il meurt peu de temps après à Kumbakonam à l'âge de trente-deux ans. Il laisse derrière lui des cahiers entiers de résultats non démontrés (appelés les cahiers de Ramanujan) qui, en ce début de XXIe siècle, continuent à être étudiés.
Ramanujan a travaillé principalement sur les fonctions elliptiques et sur la théorie analytique des nombres ; il est devenu célèbre pour ses résultats calculatoires impliquant des constantes telles que π et e, les nombres premiers ou encore la fonction partition d'un entier, qu'il a étudiée avec Hardy. Grand créateur de formules mathématiques, il en a inventé plusieurs milliers qui se sont pratiquement toutes révélées exactes, mais dont certaines ne purent être démontrées qu'après 1980 ; à propos de certaines d'entre elles, Hardy, stupéfié par leur originalité, a déclaré qu’« un seul coup d'œil suffisait à se rendre compte qu'elles ne pouvaient être pensées que par un mathématicien de tout premier rang. Elles devaient être vraies, car si elles avaient été fausses, personne n'aurait eu assez d'imagination pour les inventer ».
Source Wikipédia: Srinivasa Ramanujan
Christopher Paul Gardner 1954 -
Voir le trailer du film sur la vie de: Christopher Paul Gardner
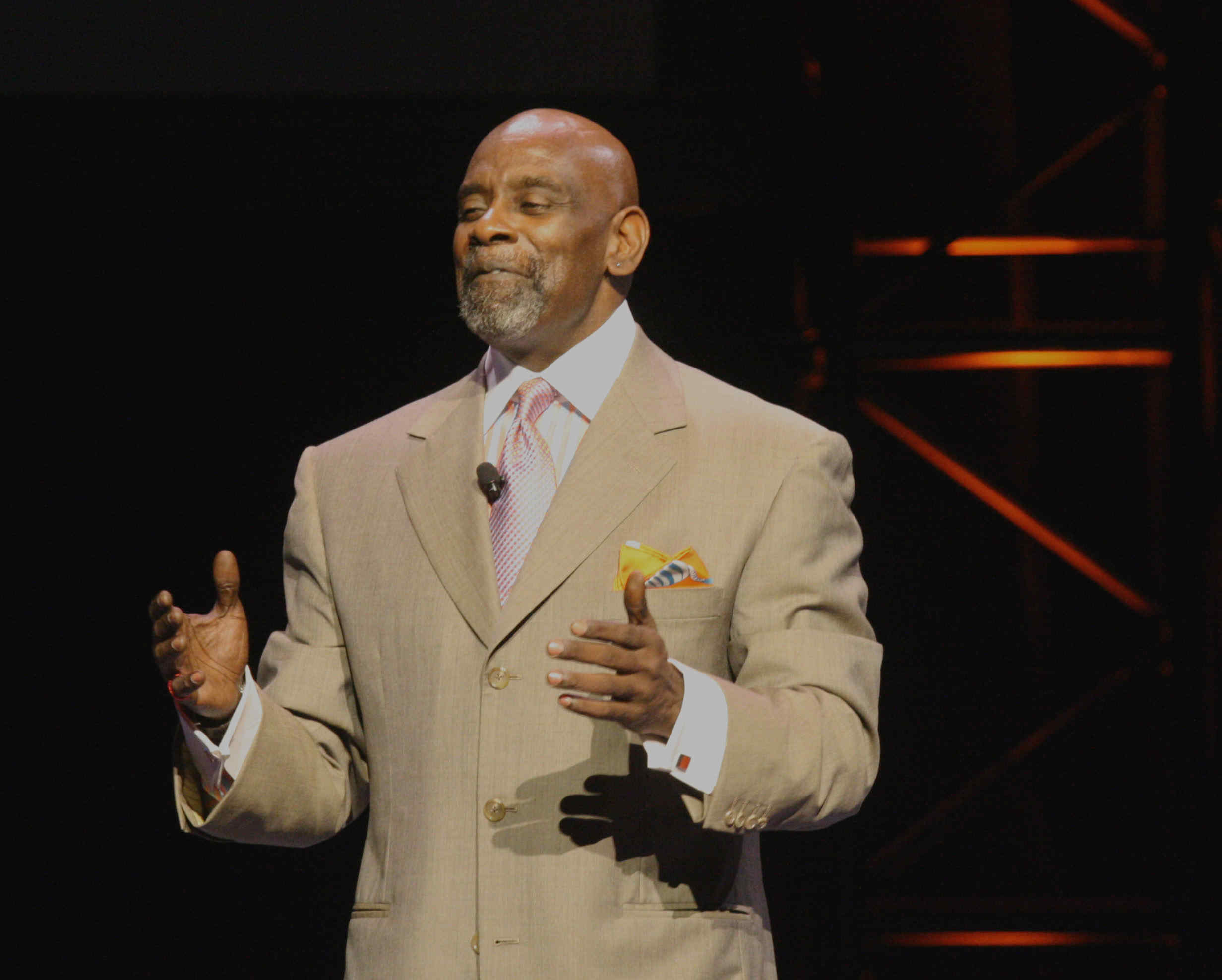 Christopher Paul Gardner (né le 9 février 1954 à Milwaukee, Wisconsin) est un entrepreneur, financier et philanthrope américain.
Aujourd'hui multi-millionnaire, Christopher Gardner a vécu, au début des années 1980, comme sans-abri avec son fils, Christopher, Jr., qu'il a élevé durant plus d'un an. En 2006, il est chef de la direction de sa propre entreprise, Gardner Rich & Co (en), basée à Chicago, en Illinois, où il réside quand il ne vit pas à New York. Par la puissance de son mental, il a su transgresser sa condition sociale et est devenu un homme hors du commun qui illustre parfaitement le rêve américain des années 1960 et 70. Gardner crédite sa ténacité et son succès à sa spiritualité qui lui a été transmise par sa mère, Bettye Jean Triplett, née Gardner et à la hauteur des attentes placées en lui par ses enfants, Chris Jr. (né en 1981) et sa fille, Jacintha (né en 1985).
Christopher Paul Gardner (né le 9 février 1954 à Milwaukee, Wisconsin) est un entrepreneur, financier et philanthrope américain.
Aujourd'hui multi-millionnaire, Christopher Gardner a vécu, au début des années 1980, comme sans-abri avec son fils, Christopher, Jr., qu'il a élevé durant plus d'un an. En 2006, il est chef de la direction de sa propre entreprise, Gardner Rich & Co (en), basée à Chicago, en Illinois, où il réside quand il ne vit pas à New York. Par la puissance de son mental, il a su transgresser sa condition sociale et est devenu un homme hors du commun qui illustre parfaitement le rêve américain des années 1960 et 70. Gardner crédite sa ténacité et son succès à sa spiritualité qui lui a été transmise par sa mère, Bettye Jean Triplett, née Gardner et à la hauteur des attentes placées en lui par ses enfants, Chris Jr. (né en 1981) et sa fille, Jacintha (né en 1985).
Source Wikipédia: Chris Gardner
John Forbes Nash, Jr 1928-2015
Voir le trailer du film sur la vie de: John Nash
 John Forbes Nash, Jr., né le 13 juin 1928 à Bluefield (Virginie-Occidentale) et mort le 23 mai 2015 à Monroe Township (New Jersey), est un mathématicien et économiste américain. Il a travaillé sur la théorie des jeux, la géométrie différentielle et les équations aux dérivées partielles.
Il est le seul mathématicien et économiste à être lauréat à la fois du prix dit Nobel d'économie en 1994 et du prix Abel pour les mathématiques en 2015.
À l'aube d'une carrière mathématique prometteuse, John Nash a commencé à souffrir de schizophrénie. Il a appris à vivre avec cette maladie seulement vingt-cinq ans plus tard. Sa vie est racontée de façon romancée dans le film Un homme d'exception.
John Forbes Nash, Jr., né le 13 juin 1928 à Bluefield (Virginie-Occidentale) et mort le 23 mai 2015 à Monroe Township (New Jersey), est un mathématicien et économiste américain. Il a travaillé sur la théorie des jeux, la géométrie différentielle et les équations aux dérivées partielles.
Il est le seul mathématicien et économiste à être lauréat à la fois du prix dit Nobel d'économie en 1994 et du prix Abel pour les mathématiques en 2015.
À l'aube d'une carrière mathématique prometteuse, John Nash a commencé à souffrir de schizophrénie. Il a appris à vivre avec cette maladie seulement vingt-cinq ans plus tard. Sa vie est racontée de façon romancée dans le film Un homme d'exception.
Source Wikipédia: John Forbes Nash
Don Shirley 1927-2013
Voir le trailer du film sur Don Shirley
Wikipédia: Don Shirley
Wikipédia: Film Greenbook
 Don Shirley est un pianiste et compositeur américain d'origine jamaïcaine, né le 29 janvier 1927 à Pensacola en Floride, et mort le 6 avril 2013 à Manhattan. Donald Walbridge Shirley est né en Floride, de Stella Gertrude (née Young ; 1903-1936) et Edwin S. Shirley (1885-1982), immigrants de Jamaïque aux États-Unis. Kingston, en Jamaïque, est parfois mentionné comme son lieu de naissance, à cause des promoteurs qui l'ont faussement présenté natif de Jamaïque. Son père est prêtre épiscopalien. Sa mère, enseignante, meurt quand Donald a neuf ans. Celui-ci a trois frères et une sœur : le Dr Calvin Shirley (1921-2012), le Dr Edwin Shirley, Jr. (1922-2006), Stella Lucille Shirley (1924-1926) et Maurice Shirley (né en 1936). Il a aussi une demi-sœur nommée Edwina Nalchawee (née vers 1955).
Don Shirley est un pianiste et compositeur américain d'origine jamaïcaine, né le 29 janvier 1927 à Pensacola en Floride, et mort le 6 avril 2013 à Manhattan. Donald Walbridge Shirley est né en Floride, de Stella Gertrude (née Young ; 1903-1936) et Edwin S. Shirley (1885-1982), immigrants de Jamaïque aux États-Unis. Kingston, en Jamaïque, est parfois mentionné comme son lieu de naissance, à cause des promoteurs qui l'ont faussement présenté natif de Jamaïque. Son père est prêtre épiscopalien. Sa mère, enseignante, meurt quand Donald a neuf ans. Celui-ci a trois frères et une sœur : le Dr Calvin Shirley (1921-2012), le Dr Edwin Shirley, Jr. (1922-2006), Stella Lucille Shirley (1924-1926) et Maurice Shirley (né en 1936). Il a aussi une demi-sœur nommée Edwina Nalchawee (née vers 1955).
Source Wikipédia: Don Shirley
Katherine Johnson 1918-2020
Voir le trailer du film sur Katherine Johnson : Les Figures de l'ombre
 Katherine Coleman Goble Johnson, née le 26 août 1918 à White Sulphur Springs (Virginie-Occidentale) et morte le 24 février 2020 à Newport News (Virginie), est une physicienne, mathématicienne et ingénieure spatiale américaine.
Elle contribue aux programmes aéronautiques et spatiaux du National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) puis de la National Aeronautics and Space Administration (NASA).
Réputée pour la fiabilité de ses calculs en navigation astronomique, elle conduit des travaux techniques à la NASA qui s'étalent sur des décennies. Durant cette période, elle calcule et vérifie les trajectoires, les fenêtres de lancement et les plans d'urgence de nombreux vols du programme Mercury, dont les premières missions de John Glenn et Alan Shepard, et des procédures de rendez-vous spatial pour Apollo 11 en 1969 jusqu'au programme de la navette spatiale américaine. Ses calculs furent essentiels à la conduite effective de ces missions. Elle travaille enfin sur une mission pour Mars.
En 2015, elle reçoit la médaille présidentielle de la Liberté et, en 2019, le Congrès des États-Unis lui décerne la médaille d'or du Congrès.
Katherine Coleman Goble Johnson, née le 26 août 1918 à White Sulphur Springs (Virginie-Occidentale) et morte le 24 février 2020 à Newport News (Virginie), est une physicienne, mathématicienne et ingénieure spatiale américaine.
Elle contribue aux programmes aéronautiques et spatiaux du National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) puis de la National Aeronautics and Space Administration (NASA).
Réputée pour la fiabilité de ses calculs en navigation astronomique, elle conduit des travaux techniques à la NASA qui s'étalent sur des décennies. Durant cette période, elle calcule et vérifie les trajectoires, les fenêtres de lancement et les plans d'urgence de nombreux vols du programme Mercury, dont les premières missions de John Glenn et Alan Shepard, et des procédures de rendez-vous spatial pour Apollo 11 en 1969 jusqu'au programme de la navette spatiale américaine. Ses calculs furent essentiels à la conduite effective de ces missions. Elle travaille enfin sur une mission pour Mars.
En 2015, elle reçoit la médaille présidentielle de la Liberté et, en 2019, le Congrès des États-Unis lui décerne la médaille d'or du Congrès.
Source Wikipédia: Katherine Johnson
Dorothy Vaughan 1910-2008
Voir le trailer du film sur Dorothy Vaughan : Les Figures de l'ombre
 Dorothy Vaughan née Dorothy Jean Johnson (20 septembre 1910 - 10 novembre 2008) est une mathématicienne et informaticienne américaine qui a travaillé pour le National Advisory Committee for Aeronautics (NACA), puis à la National Aeronautics and Space Administration (NASA) qui a contribué aux premières décennies du programme spatial américain et qui fut la première directrice de division afro-américaine du NACA puis de la NASA.
Dorothy Vaughan née Dorothy Jean Johnson (20 septembre 1910 - 10 novembre 2008) est une mathématicienne et informaticienne américaine qui a travaillé pour le National Advisory Committee for Aeronautics (NACA), puis à la National Aeronautics and Space Administration (NASA) qui a contribué aux premières décennies du programme spatial américain et qui fut la première directrice de division afro-américaine du NACA puis de la NASA.
Source Wikipédia: Dorothy Vaughan
Mary Jackson 1921-2005
Voir le trailer du film sur Mary Jackson : Les Figures de l'ombre
.jpg) Mary Jackson née Mary Winston, née le 9 avril 1921 à Hampton dans l'état de Virginie, morte le 11 février 2005 à Hampton, est une mathématicienne et ingénieure en aérospatiale américaine.
Elle travaille au National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) qui devient la NASA en 1958.
Le 25 juin 2020, l'administrateur de la NASA honore sa mémoire en baptisant de son nom les bâtiments du siège de la NASA, à Washington.
Mary Jackson née Mary Winston, née le 9 avril 1921 à Hampton dans l'état de Virginie, morte le 11 février 2005 à Hampton, est une mathématicienne et ingénieure en aérospatiale américaine.
Elle travaille au National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) qui devient la NASA en 1958.
Le 25 juin 2020, l'administrateur de la NASA honore sa mémoire en baptisant de son nom les bâtiments du siège de la NASA, à Washington.
Source Wikipédia: Mary Jackson
Christopher McCandless 1968-1992
Voir le trailer du film sur Christopher McCandless : Into the wild
Wikipédia : Christopher McCandless
Wikipédia : Into the Wild
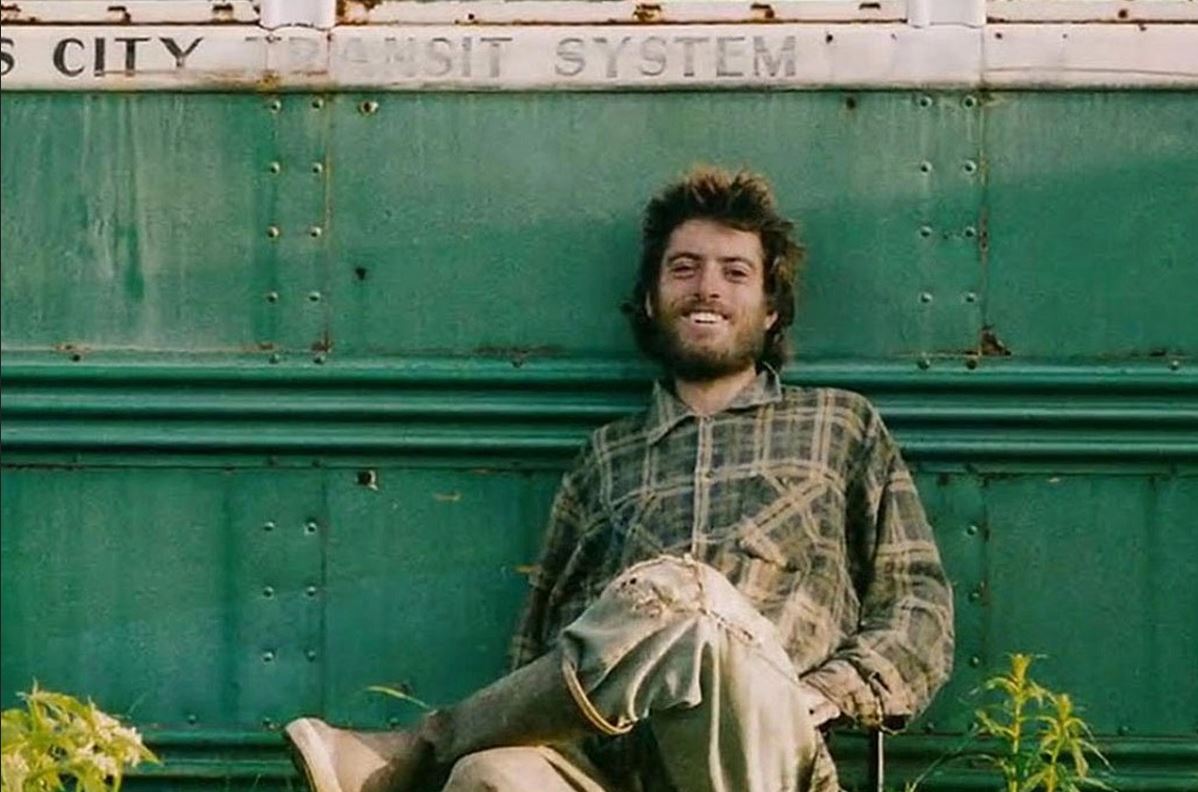 Christopher Johnson McCandless dit « Alexander Super tramp », né le 12 février 1968 à El Segundo en Californie et mort le 18 août 1992 sur la piste Stampede en Alaska, est un aventurier américain ayant fait l'objet du récit biographique Voyage au bout de la solitude (Into the Wild) de Jon Krakauer, adapté au cinéma en 2007 par Sean Penn sous le titre Into the Wild.
Christopher Johnson McCandless dit « Alexander Super tramp », né le 12 février 1968 à El Segundo en Californie et mort le 18 août 1992 sur la piste Stampede en Alaska, est un aventurier américain ayant fait l'objet du récit biographique Voyage au bout de la solitude (Into the Wild) de Jon Krakauer, adapté au cinéma en 2007 par Sean Penn sous le titre Into the Wild.
Source Wikipédia: Christopher Johnson McCandless
Rosa Parks 1913-2005
Une vie : Rosa Parks (Brut.)
Hommage : Rosa de Pascal Obispo
Wikipédia: Rosa Parks
 Rosa Louise McCauley Parks, dite Rosa Parks [ɹoʊzə pɑɹks], née le 4 février 1913 à Tuskegee en Alabama et morte le 24 octobre 2005 à Détroit dans le Michigan, est une femme afro-américaine, figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, surnommée « mère du mouvement des droits civiques » par le Congrès américain.
Elle est devenue célèbre le 1er décembre 1955, à Montgomery (Alabama) en refusant de céder sa place à un passager blanc dans l'autobus conduit par James F. Blake. Arrêtée par la police, elle se voit infliger une amende de quinze dollars. Le 5 décembre 1955, elle fait appel de ce jugement. Un jeune pasteur noir de vingt-six ans, Martin Luther King, avec le concours de Ralph Abernathy, pasteur de la First Baptist Church in America, lance alors une campagne de protestation et de boycott contre la compagnie de bus qui dure 380 jours. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis casse les lois ségrégationnistes dans les bus, les déclarant anticonstitutionnelles.
Rosa Louise McCauley Parks, dite Rosa Parks [ɹoʊzə pɑɹks], née le 4 février 1913 à Tuskegee en Alabama et morte le 24 octobre 2005 à Détroit dans le Michigan, est une femme afro-américaine, figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, surnommée « mère du mouvement des droits civiques » par le Congrès américain.
Elle est devenue célèbre le 1er décembre 1955, à Montgomery (Alabama) en refusant de céder sa place à un passager blanc dans l'autobus conduit par James F. Blake. Arrêtée par la police, elle se voit infliger une amende de quinze dollars. Le 5 décembre 1955, elle fait appel de ce jugement. Un jeune pasteur noir de vingt-six ans, Martin Luther King, avec le concours de Ralph Abernathy, pasteur de la First Baptist Church in America, lance alors une campagne de protestation et de boycott contre la compagnie de bus qui dure 380 jours. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis casse les lois ségrégationnistes dans les bus, les déclarant anticonstitutionnelles.
Source Wikipédia: Rosa Parks
Saroo Brierley 1981-
Voir le trailer du film sur Saroo Brierley : Trailer : Lion
 Le jeune Saroo, à l'âge de cinq ans, est accidentellement séparé de sa famille. À la recherche de sa famille, il aventure les dures épreuves en traversant l'Inde. Il est ensuite adopté par un couple australien habitant Hobart, en Tasmanie. Désirant retrouver sa famille biologique, il recherche son village natal au moyen des images de Google Earth, ce qui lui permet de le localiser en 2011 et de rencontrer sa mère l'année suivante, après 25 ans de séparation.
Le jeune Saroo, à l'âge de cinq ans, est accidentellement séparé de sa famille. À la recherche de sa famille, il aventure les dures épreuves en traversant l'Inde. Il est ensuite adopté par un couple australien habitant Hobart, en Tasmanie. Désirant retrouver sa famille biologique, il recherche son village natal au moyen des images de Google Earth, ce qui lui permet de le localiser en 2011 et de rencontrer sa mère l'année suivante, après 25 ans de séparation.
Source Wikipédia: Saroo Brierley
Mildred et Richard Loving (1939-2008) (1933-1975)
Voir le trailer du film sur : Mildred et Richard-Loving Trailer : Loving
Wikipédia : Loving v. Virginia
 Loving v. Virginia
Loving v. Virginia
« Loving contre l'État de Virginie » est une décision de la Cour suprême des États-Unis (no 388 U.S. 1), arrêtée le 12 juin 1967. À l'unanimité des neuf juges, elle casse une décision de la Cour suprême de Virginie (en) et déclare comme anticonstitutionnelle la loi de cet État interdisant les mariages inter-raciaux. Plus largement, elle invalide toute loi qui apporterait des restrictions au droit au mariage en se fondant sur l'origine ethnique des époux. De telles lois existaient alors dans seize États des États-Unis. Le nom des plaignants, les Loving, donne en anglais un double sens touchant à l'intitulé de cet arrêt : Loving v. Virginia peut en effet être traduit littéralement par « L'Amour contre l'État de Virginie ».
Faits
Les plaignants, Mildred Delores Jeter Loving, une femme d'ascendance afro-américaine et amérindienne et Richard Perry Loving, un ouvrier du bâtiment d'ascendance européenne, sont résidents en Virginie. Ils se sont mariés en juin 1958 à Washington, ayant quitté la Virginie pour échapper à une loi de cet État interdisant les mariages inter-raciaux, conformément au Racial Integrity Act de 1924 et aux articles de la loi de l'État de Virginie qui en découlent soit les articles 20–54 et 20–58. Le Racial Integrity Act de 1924 est un des volets d'une politique raciste voulant préserver la pureté raciale, éviter les processus dits de « dégénérescence », ainsi la même année, l'État de Virginie publie une loi autorisant la stérilisation des personnes en situation de handicap mental et autres marginaux, le Virginia Sterilization Act of 1924 (en), loi qui est entérinée par la décision du 2 mai 1927 prise par la Cour suprême concernant la requête Buck v. Bell (en).
À leur retour en Virginie, ils sont arrêtés chez eux au milieu de la nuit par le shérif du comté agissant sur une dénonciation anonyme. Accusés de violation de l'interdiction, ils plaident coupable, et sont condamnés à un an de prison, avec suspension de la sentence pour vingt-cinq ans à condition qu'ils quittent l'État de Virginie.
Le juge, Leon Bazile, reprend, pour justifier sa décision, une phrase de l'anthropologue du XVIIIe siècle, Johann Friedrich Blumenbach .
Les Loving déménagent à Washington et en 1963, entament une série de procès pour faire casser leur condamnation en s'appuyant sur le quatorzième amendement de la constitution des États-Unis ; Mildred Loving saisit le procureur général Robert Francis Kennedy qui soumet le cas à l'Union américaine pour les libertés civiles pour en vérifier la constitutionnalité, puis l'affaire remonte jusqu'à la Cour suprême fédérale. (Suite sur Wikipédia)
Source Wikipédia: Loving contre l'État de Virginie.
Winston S Churchill 1874-1965
Trailer du film : Les heures sombres
Wikipédia : Winston Churchill
 Sir Winston Churchill , né le 30 novembre 1874 à Woodstock et mort le 24 janvier 1965 à Londres, est un homme d'État britannique. Sa ténacité face au nazisme, son action décisive en tant que Premier ministre du Royaume-Uni durant la Seconde Guerre mondiale, joints à ses talents d'orateur et à ses bons mots, ont fait de lui un des hommes politiques les plus reconnus du XXe siècle. Ne disposant pas d'une fortune personnelle, il tire l'essentiel de ses revenus de sa plume. Ses dons d'écriture seront couronnés à la fin de sa vie par le prix Nobel de littérature. Il est également un peintre estimé.
Winston Churchill appartient à la famille aristocratique Spencer, dont il est la plus brillante figure depuis son ancêtre John Churchill, 1er duc de Marlborough (1650-1722), auquel il a consacré une biographie. Fils d'un homme politique conservateur atypique n'ayant pas connu le succès escompté et mort relativement jeune, il ambitionne très vite de réussir dans ce domaine. De fait, s'il débute dans la carrière militaire et combat en Inde, au Soudan et lors de la seconde guerre des Boers, il y cherche surtout l'occasion de briller et de se faire connaître. Cette recherche de gloire lui vaut parfois un certain nombre d'inimitiés parmi ses pairs. Assez rapidement, en partie pour des questions financières — l'armée paie moins que le journalisme et il a besoin d'argent —, il sert en tant que correspondant de guerre, écrivant des livres sur les campagnes auxquelles il participe. Bien plus tard, il sert brièvement sur le front de l'Ouest pendant la Première Guerre mondiale, comme commandant du 6e bataillon des Royal Scots Fusiliers.
Sir Winston Churchill , né le 30 novembre 1874 à Woodstock et mort le 24 janvier 1965 à Londres, est un homme d'État britannique. Sa ténacité face au nazisme, son action décisive en tant que Premier ministre du Royaume-Uni durant la Seconde Guerre mondiale, joints à ses talents d'orateur et à ses bons mots, ont fait de lui un des hommes politiques les plus reconnus du XXe siècle. Ne disposant pas d'une fortune personnelle, il tire l'essentiel de ses revenus de sa plume. Ses dons d'écriture seront couronnés à la fin de sa vie par le prix Nobel de littérature. Il est également un peintre estimé.
Winston Churchill appartient à la famille aristocratique Spencer, dont il est la plus brillante figure depuis son ancêtre John Churchill, 1er duc de Marlborough (1650-1722), auquel il a consacré une biographie. Fils d'un homme politique conservateur atypique n'ayant pas connu le succès escompté et mort relativement jeune, il ambitionne très vite de réussir dans ce domaine. De fait, s'il débute dans la carrière militaire et combat en Inde, au Soudan et lors de la seconde guerre des Boers, il y cherche surtout l'occasion de briller et de se faire connaître. Cette recherche de gloire lui vaut parfois un certain nombre d'inimitiés parmi ses pairs. Assez rapidement, en partie pour des questions financières — l'armée paie moins que le journalisme et il a besoin d'argent —, il sert en tant que correspondant de guerre, écrivant des livres sur les campagnes auxquelles il participe. Bien plus tard, il sert brièvement sur le front de l'Ouest pendant la Première Guerre mondiale, comme commandant du 6e bataillon des Royal Scots Fusiliers.
Source Wikipédia: Winston Churchill.
Nathan Bedford Forrest 1821-1877
Dans le film Forrest Gump, l'on dit d'où vient le nom Forrest, ça vient de lui .
Voir le trailer du film ( qui n'a rien à voir avec le vrai Nathan Bedford Forrest) :
Forrest Gump

Nathan Bedford Forrest (13 juillet 1821 - 29 octobre 1877) est un lieutenant général confédéré. Il est un officier confédéré controversé de la guerre de Sécession et est considéré comme l'un des meilleurs tacticiens : les tactiques de mouvement de troupes (cavalerie) qu'il a mises en place à l'époque sont toujours étudiées de nos jours et appliquées par les militaires. Il fut en quelque sorte un précurseur de la doctrine du « Blitzkrieg ». Après la guerre, Forrest devint le premier « Premier Grand Sorcier » du Ku Klux Klan, titre attribué au chef du KKK. Il quittera néanmoins le KKK dont il ordonna en vain la dissolution vers la fin de sa vie en raison des excès de cette organisation et de certaines divergences. En effet, ayant lui-même tenu la promesse de libérer ses propres esclaves juste avant la fin des hostilités, il prit par la suite publiquement position en faveur de la cause des Noirs d'Amérique.
Source Wikipédia: Nathan Bedford Forrest.
Stephen King 1947-
Trailer du film la ligne verte (tiré d'un Roman du génial Stephen King).
Wikipédia: Stephen King
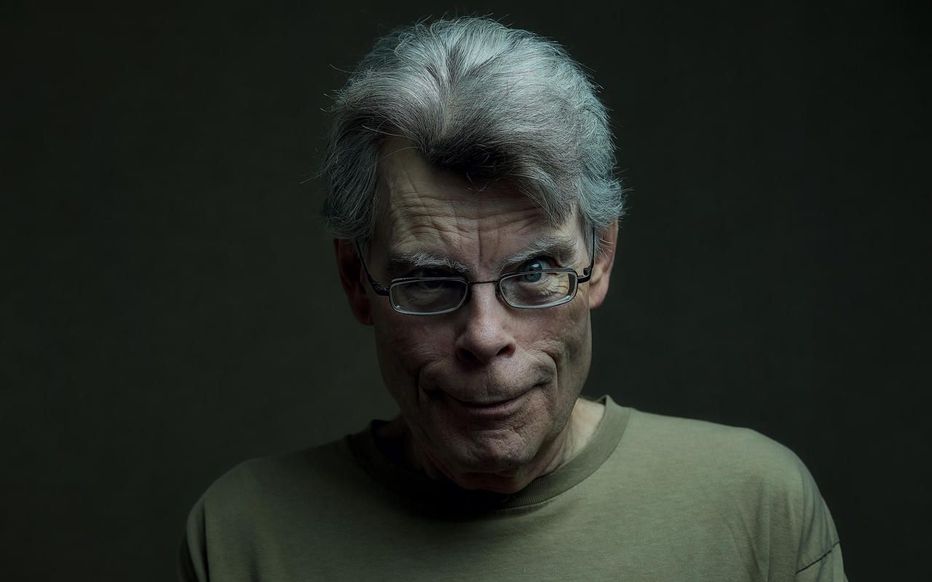 Stephen King est un écrivain américain né le 21 septembre 1947 à Portland (Maine).
Il publie son premier roman en 1974 et devient rapidement célèbre pour ses contributions dans le domaine de l'horreur mais écrit également des livres relevant d'autres genres comme le fantastique, la fantasy, la science-fiction et le roman policier. Tout au long de sa carrière, il écrit et publie plus de soixante romans, dont sept sous le nom de plume de Richard Bachman, et plus de deux cents nouvelles, dont plus de la moitié sont réunies dans dix recueils de nouvelles. Après son grave accident en 1999, il ralentit son rythme d'écriture. Ses livres se sont vendus à plus de 350 millions d'exemplaires à travers le monde et il établit de nouveaux records de ventes dans le domaine de l'édition durant les années 1980, décennie où sa popularité atteint son apogée.
Stephen King est un écrivain américain né le 21 septembre 1947 à Portland (Maine).
Il publie son premier roman en 1974 et devient rapidement célèbre pour ses contributions dans le domaine de l'horreur mais écrit également des livres relevant d'autres genres comme le fantastique, la fantasy, la science-fiction et le roman policier. Tout au long de sa carrière, il écrit et publie plus de soixante romans, dont sept sous le nom de plume de Richard Bachman, et plus de deux cents nouvelles, dont plus de la moitié sont réunies dans dix recueils de nouvelles. Après son grave accident en 1999, il ralentit son rythme d'écriture. Ses livres se sont vendus à plus de 350 millions d'exemplaires à travers le monde et il établit de nouveaux records de ventes dans le domaine de l'édition durant les années 1980, décennie où sa popularité atteint son apogée.
Longtemps dédaigné par les critiques littéraires et les universitaires car considéré comme un auteur « populaire », il acquiert plus de considération depuis les années 1990 même si une partie de ces milieux continue de rejeter ses livres. Il est régulièrement critiqué pour son style familier, son recours au gore et la longueur jugée excessive de certains de ses romans. À l'inverse, son sens de la narration, ses personnages vivants et colorés, et sa faculté à jouer avec les peurs des lecteurs sont salués. Au-delà du caractère horrifique de la plupart de ses livres, il aborde régulièrement les thèmes de l'enfance et de la condition de l'écrivain, et brosse un portrait social très réaliste et sans complaisance des États-Unis à la fin du XXe siècle et au début du siècle suivant.
Source Wikipédia: Stephen King.
L'équipage d'Apollo 11 :
Trailer du film (documentaire) sur La mission apollo 11 : Voir le Trailer du film (documentaire) sur La mission apollo 11 .
Neil Armstrong 1930-2012
 Neil Alden Armstrong, né le 5 août 1930 à Wapakoneta dans l'Ohio aux États-Unis et mort le 25 août 2012 à Cincinnati dans le même État, est un astronaute américain, pilote d'essai, aviateur de l'United States Navy et professeur. Il est le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune le 21 juillet 1969 UTC, durant la mission Apollo 11, prononçant alors une phrase restée célèbre : « That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind » (en français : « C'est un petit pas pour [un] homme, [mais] un bond de géant pour l'humanité »).
Neil Alden Armstrong, né le 5 août 1930 à Wapakoneta dans l'Ohio aux États-Unis et mort le 25 août 2012 à Cincinnati dans le même État, est un astronaute américain, pilote d'essai, aviateur de l'United States Navy et professeur. Il est le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune le 21 juillet 1969 UTC, durant la mission Apollo 11, prononçant alors une phrase restée célèbre : « That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind » (en français : « C'est un petit pas pour [un] homme, [mais] un bond de géant pour l'humanité »).
Armstrong obtient une licence en aéronautique à l'université Purdue. Ses études sont momentanément interrompues en 1950 par son service militaire dans la marine de guerre des États-Unis. Il y suit une formation de pilote d'avion à réaction. Basé sur le porte-avions USS Essex, il participe à la guerre de Corée et réalise 78 missions sur des chasseurs F9F Panther. Après avoir obtenu son diplôme, il intègre, en 1955, le National Advisory Committee for Aeronautics (NACA), organisme de recherche aéronautique ancêtre de la National Aeronautics and Space Administration (NASA). Devenu pilote d'essai, il effectue plus de 900 vols pour mettre au point des bombardiers et des chasseurs ; il pilote également les avions-fusées expérimentaux Bell X-1B, Bell X-5 et North American X-15. En 1962, il rentre dans le corps des astronautes de l'agence spatiale américaine, la NASA.
En 1966, Armstrong effectue son premier vol spatial à bord de Gemini 8 et réalise le premier amarrage de deux engins spatiaux. Il est sélectionné comme commandant d'Apollo 11, la première mission à se poser sur la Lune. Le 20 juillet 1969, il pilote le module lunaire Apollo qui alunit. Avec son copilote Buzz Aldrin, Armstrong réalise une sortie extravéhiculaire d'une durée de deux heures vingt qui constitue les premiers pas de l'homme sur un autre corps que la Terre. Immédiatement après sa mission, Armstrong quitte le corps des astronautes. Il occupe un temps un poste d'enseignant dans le domaine aérospatial et sert de porte-parole pour le compte de plusieurs sociétés américaines. Il est membre des commissions d'enquête formées après l'interruption de la mission Apollo 13 (1970) et l'accident de la navette spatiale Challenger (1986).
Source Wikipédia: Neil Armstrong.
Buzz Aldrin 1930-
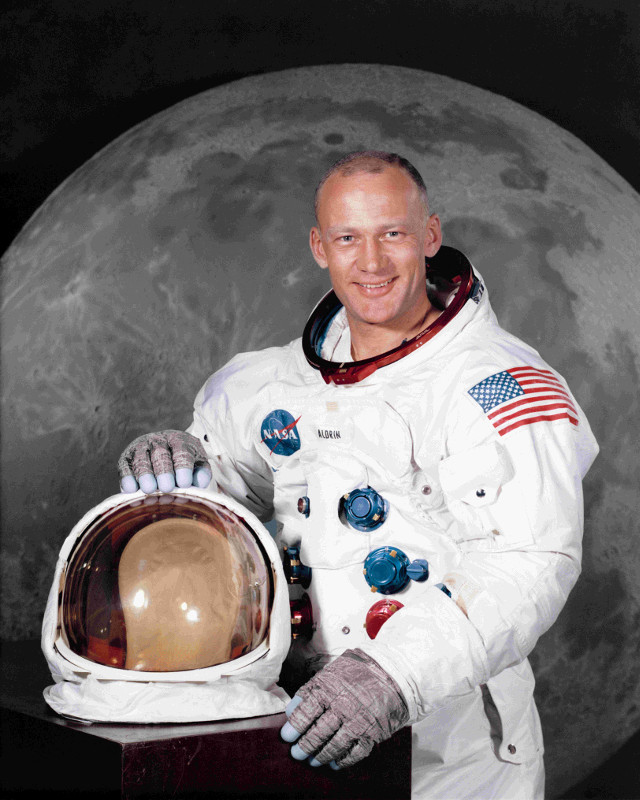 Buzz Aldrin, né Edwin Eugene Aldrin Jr., le 20 janvier 1930 à Glen Ridge dans le New Jersey aux États-Unis, est un militaire, pilote d'essai, astronaute et ingénieur américain. Il effectue trois sorties dans l'espace en tant que pilote de la mission Gemini 12 de 1966 et, en tant que pilote du module lunaire Apollo de la mission Apollo 11 de 1969, il est, avec le commandant de la mission Neil Armstrong, l'un des deux premiers humains à marcher sur la Lune.
Buzz Aldrin, né Edwin Eugene Aldrin Jr., le 20 janvier 1930 à Glen Ridge dans le New Jersey aux États-Unis, est un militaire, pilote d'essai, astronaute et ingénieur américain. Il effectue trois sorties dans l'espace en tant que pilote de la mission Gemini 12 de 1966 et, en tant que pilote du module lunaire Apollo de la mission Apollo 11 de 1969, il est, avec le commandant de la mission Neil Armstrong, l'un des deux premiers humains à marcher sur la Lune.
Aldrin est issu de la promotion 1951 de l'Académie militaire de West Point avec un diplôme en génie mécanique. Il est affecté à l'armée de l'air américaine et devient pilote de chasseur à réaction pendant la guerre de Corée. Il effectue au total 66 missions de combat et abat deux MiG-15. Après avoir obtenu un doctorat en astronautique du Massachusetts Institute of Technology (MIT), Aldrin est choisi pour faire partie du groupe d'astronautes 3 recruté par la National Aeronautics and Space Administration (NASA). Sa thèse de doctorat portant sur les techniques de rendez-vous orbitaux avec équipage, il reçoit le surnom de « Dr. Rendezvous » de la part de ses collègues astronautes. Sa première mission spatiale est la dernière mission du programme Gemini. Elle a lieu en 1966 à bord de Gemini 12 et il réalise plus de cinq heures en sortie extravéhiculaire. Trois ans plus tard, Aldrin pose le pied sur la Lune le 21 juillet 1969, quelques minutes après Armstrong, tandis que le pilote du module de commande Michael Collins reste en orbite lunaire.
À son départ de la NASA en 1971, il devient commandant de l'école des pilotes d'essai de l'United States Air Force. Il prend sa retraite de l'armée de l'air en 1972, après 21 ans de service, et entame une difficile reconversion à la vie civile. Ses principales autobiographies, Return to Earth (1973) et Magnificent Desolation (2009), relatent ses problèmes de dépression et d'alcoolisme au cours des années qui suivent son départ de la NASA. Il continue à plaider en faveur de l'exploration spatiale, en particulier d'une mission habitée sur Mars, et développe une trajectoire particulière pour un vaisseau spatial qui rend le voyage vers cette planète plus rapide et économe en énergie. Il reçoit de nombreux honneurs, dont la médaille présidentielle de la Liberté en 1969, et fait partie de plusieurs temples de la renommée.
Source Wikipédia: Buzz Aldrin.
Michael Collins 1930-
.jpg) Michael Collins, né le 31 octobre 1930 à Rome en Italie, est un militaire, pilote d'essai, astronaute, haut fonctionnaire, cadre et homme d'affaires américain.
Michael Collins, né le 31 octobre 1930 à Rome en Italie, est un militaire, pilote d'essai, astronaute, haut fonctionnaire, cadre et homme d'affaires américain.
Avant de devenir astronaute, il obtient son diplôme de l'Académie militaire de West Point. De là, il rejoint l'armée de l'air américaine et pilote des chasseurs North American F-86 Sabre à la base aérienne de Chambley-Bussières en France. Il est accepté à l'école des pilotes d'essai de l'United States Air Force de la base aérienne Edwards en 1960. Il se porte candidat sans succès pour le groupe d'astronautes 2 de la NASA, mais est accepté pour le troisième.
Sélectionné dans le groupe d'astronautes 3 de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) en 1963, il voyage deux fois dans l'espace. Son premier vol spatial est effectué lors de la mission Gemini 10, dans laquelle lui et John Young effectuent deux rendez-vous avec différents engins spatiaux et réalisent deux sorties extra-véhiculaires. Son second vol spatial est en tant que pilote du module de commande et de service Apollo lors de la mission Apollo 11. Alors qu'il reste en orbite autour de la Lune, Neil Armstrong et Buzz Aldrin partent dans le module lunaire Apollo pour réaliser le premier alunissage. Il est ainsi l'une des 24 personnes du programme Apollo à avoir survolé la Lune. Collins est le 17e Américain dans l'espace, la 4e personne et le 3e Américain à effectuer une sortie extravéhiculaire et la première personne à avoir effectué plus d'une sortie extravéhiculaire.
Après avoir pris sa retraite de la NASA en 1970, ce major général de l'United States Air Force est nommé au poste de secrétaire d'État adjoint aux affaires publiques au département d'État des États-Unis. Un an plus tard, il devient directeur du National Air and Space Museum et occupe ce poste jusqu'en 1978, date à laquelle il démissionne pour devenir sous-secrétaire de la Smithsonian Institution. En 1980, il occupe le poste de vice-président de LTV Aerospace et démissionne en 1985 pour créer son cabinet de conseil.
Source Wikipédia: Michael Collins (astronaute).
Chelsea Elizabeth Manning 1987-
 Chelsea Elizabeth Manning, née Bradley Edward Manning le 17 décembre 1987 à Crescent (Oklahoma), est une ancienne analyste militaire de l'Armée des États-Unis de nationalité américano-britannique qui a été condamnée et incarcérée pour trahison.
Chelsea Elizabeth Manning, née Bradley Edward Manning le 17 décembre 1987 à Crescent (Oklahoma), est une ancienne analyste militaire de l'Armée des États-Unis de nationalité américano-britannique qui a été condamnée et incarcérée pour trahison.
Manning transmet en 2010 à WikiLeaks des documents militaires classés secret défense relevant du domaine de la Défense Nationale, notamment sur la mort de civils pendant la guerre d'Afghanistan (Afghan War Diary),
ainsi que des preuves visuelles d'exactions de l'U.S. Army pendant la guerre d'Irak (photos de l'humiliation de détenus de la prison d'Abou Ghraib, vidéo du raid aérien du 12 juillet 2007 à Bagdad).
La diffusion de ces informations lui vaut d'être condamné le 21 août 2013 à 35 ans de prison.
Au lendemain de sa condamnation, Manning déclare être une personne transgenre et entame des démarches pour changer d'identité et prendre le prénom de Chelsea.
Le 23 avril 2014, la Justice des États-Unis reconnaît le changement de nom de Manning, qui s'appelle désormais officiellement Chelsea Elizabeth Manning.
En février 2015, l'Armée autorise Manning à entamer son traitement hormonal, et le mois suivant, la cour d'appel de l'U.S. Army statue que Chelsea Manning doit être désignée via des pronoms féminins ou neutres.
Le 17 janvier 2017, l'administration Obama décide de commuer la peine de Manning, rendant possible sa libération anticipée.
Manning sort de prison le 17 mai 2017, sept ans après son arrestation survenue le 20 mai 2010.
Chelsea Manning est de nouveau emprisonnée le 16 mai 2019 à la suite de son refus de témoigner dans l'enquête concernant WikiLeaks.
Elle est détenue au Alexandria detention center à Alexandria en Virginie.
Le 12 mars 2020, Chelsea Manning est libérée le lendemain d'une tentative de suicide, après 301 jours d’incarcération.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Chelsea Manning
Solomon Northup 1808-1857 (Date de mort exact non connue)
Wikipédia: Douze ans d'esclavage.
Wikipédia: Solomon Northup.
Trailer du film 12 ans d'Esclavage: Voir le Trailer du film 12 ans d'Esclavage .
.jpg) Solomon Northup, né en juillet 1808, à Minerva, comté d'Essex dans l'État de New York et mort à une date inconnue après 1857, est un Noir afro-américain, né libre, fils d'un esclave affranchi. Il était agriculteur et violoniste, et possédait une propriété à Hebron, dans l’État de New York.
Solomon Northup, né en juillet 1808, à Minerva, comté d'Essex dans l'État de New York et mort à une date inconnue après 1857, est un Noir afro-américain, né libre, fils d'un esclave affranchi. Il était agriculteur et violoniste, et possédait une propriété à Hebron, dans l’État de New York.
En 1841, il est enlevé par des marchands d'esclaves, après avoir été séduit par une offre d'emploi en tant que violoniste. Alors qu'il accompagne ses supposés employeurs à Washington, ils le droguent et le vendent comme esclave. Il est envoyé à la Nouvelle-Orléans où il est vendu à un propriétaire de plantation en Louisiane. Il est détenu dans la région de la Rivière Rouge par plusieurs propriétaires pendant douze ans, période pendant laquelle ses amis et sa famille n'ont pas de nouvelles de lui. Il fait plusieurs tentatives pour s'échapper et faire passer des messages. Finalement, il obtient des nouvelles de sa famille, qui a contacté des amis et rallié à sa cause le gouverneur de New York, Washington Hunt. Il retrouve la liberté en janvier 1853 et retourne dans sa famille à New York.
Solomon Northup poursuivit les trafiquants d'esclaves à Washington, mais perdit devant le tribunal local. La loi du district de Columbia lui interdisait en tant qu'homme noir de témoigner contre les Blancs, et sans son témoignage, il n'était pas en mesure de les poursuivre pour dommages et intérêts. Plus tard, dans l'État de New York, deux hommes furent accusés d'enlèvement mais les accusations furent retirées au bout de deux ans.
Il publie des mémoires, Douze ans d'esclavage, qui deviennent un best-seller et contribuent au débat sur l'abolition de l'esclavage. Devenu militant pour l'abolitionnisme, il donne des dizaines de conférences à travers le nord-est des États-Unis. Il disparaît dans des circonstances inconnues quelques années après avoir retrouvé sa condition d'homme libre.
Ses mémoires sont adaptées au cinéma en 2013 par le réalisateur britannique Steve McQueen, mettant en vedette Chiwetel Ejiofor dans le rôle de Solomon Northup.
Source Wikipédia: Solomon Northup.
L'équipage de la mission Apollo 13 (James Lovell, Fred Haise, Jack Swigert) :
Voir le Trailer du film sur la mission Apollo 13 .
James Lovell 1928-
 James Arthur Lovell, Jr., dit « Jim » Lovell, né le 25 mars 1928 à Cleveland, Ohio, est un astronaute américain de la NASA, principalement connu pour avoir été le commandant de la mission Apollo 13.
James Arthur Lovell, Jr., dit « Jim » Lovell, né le 25 mars 1928 à Cleveland, Ohio, est un astronaute américain de la NASA, principalement connu pour avoir été le commandant de la mission Apollo 13.
Né à Cleveland, dans l'Ohio, d'une mère tchèque, il étudie à l'université du Wisconsin, où il rejoint la fraternité Alpha Phi Omega (en) puis à l'Académie navale d'Annapolis. Il est mobilisé pendant la guerre de Corée.
En 1959, il fait acte de candidature pour faire partie du tout premier groupe d'astronautes de la NASA mais il n'est pas sélectionné en raison d'un taux élevé de bilirubine dans le sang.
En 1962, ayant à nouveau tenté sa chance, il intègre le deuxième groupe de la NASA, baptisé « The New Nine », aux côtés (entre autres) de Neil Armstrong et de Pete Conrad (qui, comme lui, avait échoué à la sélection de 1959).
Après avoir participé à quatre vols spatiaux entre 1965 et 1970 (lire ci-dessous), il prend sa retraite en 1973 et devient entrepreneur jusqu'en 1991.
En 2018, âgés de 90 ans, Lovell et Borman célèbrent avec Anders (85 ans) le cinquantième anniversaire de leur vol autour de la Lune.
Source Wikipédia: James Lovell (astronaute).
Fred Haise 1933-
 Fred Wallace Haise Junior dit Fred Haise est un astronaute américain né le 14 novembre 1933 à Biloxi, Mississippi.
Fred Wallace Haise Junior dit Fred Haise est un astronaute américain né le 14 novembre 1933 à Biloxi, Mississippi.
Haise est né à Biloxi, Mississippi. Il a fréquenté l'école secondaire de Biloxi, la Perkinston Junior College. En 1959, il obtint un diplôme en génie aéronautique à l'Université de l'Oklahoma. Il complète ses cours post-universitaires à l'École de l'US Air Force. Il termine sa formation de pilote de l'aéronavale en 1954 et sert comme pilote de chasse à United States Marine Corps. Il devient pilote d'essais à la base Edwards en 1964.
En avril 1966, il est l'un des 19 pilotes sélectionnés dans le cinquième groupe d'astronautes de la NASA. En 1968, à la suite du retrait de Michael Collins de l'équipage d'Apollo 8, première mission spatiale autour de la Lune, Haise entre dans l'équipage de réserve en tant que doublure de William Anders. Au lendemain de cette mission, en janvier 1969, il est à nouveau nommé doublure, cette fois de Buzz Aldrin, pilote du module lunaire d'Apollo 11, la mission du premier débarquement sur la Lune.
Juste après ce vol, en août 1969, Haise est nommé pilote principal du module lunaire de la mission Apollo 13, ce qui le prédispose à devenir le 6e homme à marcher sur la Lune. Mais le 13 avril 1970, deux jours après le décollage de la fusée, une explosion se produit dans le module de service, contraignant les responsables de la mission à annuler l'alunissage. Les trois membres de l'équipage (Jim Lovell, Jack Swigert et lui-même) sont alors contraints de se réfugier dans le module lunaire, utilisé comme chaloupe de sauvetage, la baisse de la température à l'intérieur du module de commande ayant rendu celui-ci impraticable. L'équipage contourne la Lune et revient en catastrophe vers la Terre. Cette épopée sera rapportée 25 ans plus tard dans un film de fiction, Apollo 13, de Ron Howard, le rôle de Haise étant interprété par l'acteur Bill Paxton.
Juste après cet échec, Haise est prévu pour être désigné commandant de la mission Apollo 19. Mais le 2 septembre 1970, la NASA annonça son annulation ainsi que celle de la mission Apollo 18, à la suite de la décision du congrès pour des raisons budgétaires. Haise est alors désigné commandant de réserve de l'équipage d'Apollo 16, ce qui lui laisse une ultime chance de marcher sur la Lune. Mais le maintien à son poste du commandant titulaire, John Young, lui enlève ses derniers espoirs de fouler le sol de notre satellite. Il présente donc la particularité d'avoir failli marcher sur la Lune à quatre reprises (Apollo 11, 13, 19 et 16) et, finalement, de n'y être jamais allé.
Par la suite, Haise se consacre au programme de la navette spatiale. À trois reprises, en 1977, il commande la navette spatiale Enterprise pour la mise au point des procédures d'approche et d'atterrissage, dans le cadre du programme Approach and Landing Test. La navette est larguée depuis le dos d'un Boeing 747, l'astronaute Gordon Fullerton étant le co-pilote, Haise prend finalement sa retraite de la NASA en juin 1979, laissant à son collègue Jack Lousma commander la deuxième mission de la navette Columbia, en 1981.
Par la suite, il est engagé dans l'entreprise Grumman Aerospace, l'ancien fabricant du module lunaire. Intronisé à l'Aerospace Walk of Honor en 1995, il prend sa retraite l'année suivante.
Source Wikipédia: Fred Haise (astronaute).
Jack Swigert 1931-1982
 John Leonard "Jack" Swigert, Jr., né le 30 août 1931 à Denver dans le Colorado et mort le 27 décembre 1982 à Washington, D.C., est un pilote d'essais et astronaute américain de la National Aeronautics and Space Administration (NASA).
John Leonard "Jack" Swigert, Jr., né le 30 août 1931 à Denver dans le Colorado et mort le 27 décembre 1982 à Washington, D.C., est un pilote d'essais et astronaute américain de la National Aeronautics and Space Administration (NASA).
Né à Denver, Jack Swigert étudie à l'université du Colorado à Boulder, où il joue au football américain universitaire. Il a obtenu un Bachelor of Science Degree en ingénierie mécanique. Il sert dans l'United States Air Force comme pilote de combat en Corée et devient pilote d'essais.
Détenteur d'un master en sciences aérospatiales du Rensselaer Polytechnic Institute et d'un Master of Business Administration de l'université de Hartford, il devient en avril 1966 l'un des 19 du cinquième groupe d'astronautes sélectionnés par la NASA.
Jack Swigert est l'un des trois astronautes de la mission lunaire Apollo 13, lancée le 11 avril 1970. La mission était la troisième tentative d'atterrissage lunaire, mais est annulée après la rupture d'un réservoir d'oxygène dans le module de service du vaisseau spatial. Il est à l'origine de la célèbre phrase « Houston, we've had a problem here » (en français : « Houston, on a eu un problème là »), prononcé avec un calme fantastique pour annoncer la panne. Jack Swigert et les deux autres astronautes, Jim Lovell et Fred Haise, retournent sur Terre en sécurité le 17 avril après près de 5 jours et 23 heures dans l'espace, et reçoivent la Presidential Medal of Freedom en 1970.
Jack Swigert est originellement proposé comme pilote du module de commande du projet test Apollo-Soyouz, mais en est exclu comme punition pour son rôle dans le Scandale du timbre postal d'Apollo 15. Jack Swigert ne faisait pas partie de la mission Apollo 15, mais lors de l'enquête qui suit le scandale, il avoue à l'astronaute Deke Slayton avoir participé à des arrangements similaires. Quand les preuves contre lui commencent à s'accumuler, il est donc considéré indésirable d'un point de vue de relations publiques.
Il devient plus tard directeur du personnel du Comité des sciences et techniques américain de la Chambre des Représentants. Élu pour le Parti républicain dans le sixième district du Colorado, alors nouvellement créé en novembre 1982, il meurt d'un cancer des os avant d'entrer en fonction. Il est le premier astronaute « lunaire » à mourir ; il sera suivi, dans l'ordre, par Donn Eisele, qui a volé sur Apollo 7, mais qui n'est pas allé sur la Lune, Ronald Evans (Apollo 17), James Irwin (Apollo 15), Stuart Roosa et Alan Shepard (tous les deux sur Apollo 14), Pete Conrad (Apollo 12), Gordon Cooper (Programme Mercury, qui n'est pas allé sur la Lune), Walter Schirra (Apollo 7, qui n'est pas allé sur la Lune), Neil Armstrong (Apollo 11), Gene Cernan (Apollo 17), Richard Gordon (Apollo 12), John Watts Young (Apollo 16), Alan Bean (Apollo 12).
Source Wikipédia: Jack Swigert (astronaute).
Jack London 1876-1916
Wikipedia : Jack London .
Voir le trailer de Croc-Blanc . D'après le roman de Jack London.
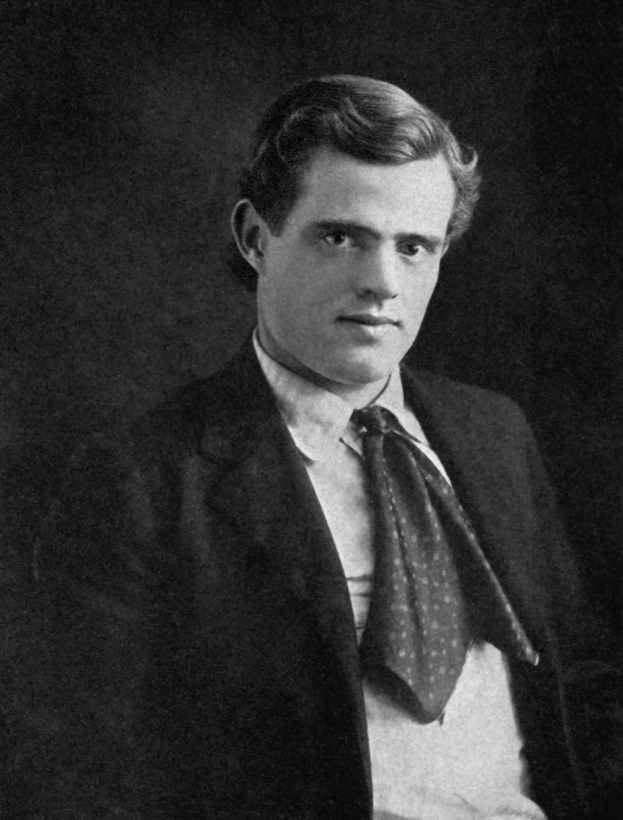 Jack London, né John Griffith Chaney le 12 janvier 1876 à San Francisco et mort le 22 novembre 1916 à Glen Ellen, Californie, est un écrivain américain dont les thèmes de prédilection sont l'aventure et la nature sauvage.
Jack London, né John Griffith Chaney le 12 janvier 1876 à San Francisco et mort le 22 novembre 1916 à Glen Ellen, Californie, est un écrivain américain dont les thèmes de prédilection sont l'aventure et la nature sauvage.
Il est l'auteur de L'Appel de la forêt et d'autres romans célèbres (Croc-Blanc, Le Talon de fer), dont certains (Martin Eden, Le Cabaret de la dernière chance) auto-biographiques, ainsi que plus de deux cents nouvelles (dont cent soixante-quinze publiées de son vivant).
Bien que cet aspect-là de son œuvre soit généralement négligé, il a tiré aussi de ses lectures et de sa propre vie de misère l’inspiration pour de nombreux ouvrages très engagés et à coloration socialiste.
Il a été l'un des écrivains américains les mieux payés du début du XXe siècle.
Source Wikipédia: Jack London
Kim Peek 1951-2009 (Probablement la personne que je préfère).
Wikipédia: Kim Peek
Wikipédia: film Rain Man
Voir le trailer du film Rain Man directement inspiré de Kim Peek
 Laurence Kim Peek, né le 11 novembre 1951 à Salt Lake City et mort dans cette même ville le 19 décembre 2009, est un Américain atteint du syndrome du savant. Tout en étant doué d'une mémoire eidétique, il souffrait de difficultés dans la vie en société, possibles résultats d'anomalies congénitales du cerveau. Il a inspiré le personnage principal du film Rain Man.
Laurence Kim Peek, né le 11 novembre 1951 à Salt Lake City et mort dans cette même ville le 19 décembre 2009, est un Américain atteint du syndrome du savant. Tout en étant doué d'une mémoire eidétique, il souffrait de difficultés dans la vie en société, possibles résultats d'anomalies congénitales du cerveau. Il a inspiré le personnage principal du film Rain Man.
Laurence Kim Peek naît le 11 novembre 1951 à Salt Lake City. Son père Fran lui donne ses deux prénoms en référence au comédien Laurence Olivier et au roman Kim de Rudyard Kipling.
ll est né avec une macrocéphalie, sans corps calleux (le tissu assurant la liaison entre les deux hémisphères cérébraux), le cervelet endommagé, sans commissure antérieure. Cette absence de connexion entre les hémisphères est appelée syndrome du cerveau scindé (en anglais split-brain). Il était cependant doué d'une capacité mnésique développée, ce qui a conduit certains scientifiques à l'hypothèse que, malgré l'absence de corps calleux, ses neurones pouvaient établir des connexions entre eux.
Selon son père Fran, il fut capable de mémoriser des informations dès l'âge de 16 mois. Il mémorisait des livres entiers. Une fois lus, il les déposait à l'envers sur une étagère pour éviter de les relire, pratique qu'il aurait conservée jusqu'à son décès. Il a adopté ce comportement avant de savoir marcher, ce à quoi il parvint à l'âge de 4 ans, bien qu'il conservât une démarche oblique.
Depuis 1969, il travaillait dans un centre de travail pour personnes en situation de handicap.
Il a mémorisé une quantité impressionnante d'informations. Les sujets étaient très divers : histoire, littérature, géographie, nombres et arithmétique, sports, musique et dates. Il était capable de lire à une vitesse de dix secondes par page (soit près d'un livre par heure) et en retenant près de 98 % des informations, tout en étant aussi capable de lire deux pages simultanément, une par œil ; ses médecins le comparaient à un moteur de recherche sur Internet. Il se souvenait d'environ 12 000 livres entièrement. Il était capable de voir la page gauche d'un livre avec son champ visuel gauche et la page droite d'un livre avec son champ visuel droit, de sorte qu'il pouvait lire les deux pages simultanément. Il avait également développé des zones de langage dans les deux hémisphères, ce qui est très rare chez les patients atteints de division du cerveau.
Ses facultés intellectuelles lui permettaient aussi de calculer mentalement des opérations complexes ; par exemple, il préparait de tête des feuilles de calculs pour les salaires au centre de travail.
À partir de 2002, il développa un talent pour le piano. Le désir lui en était venu spontanément, car il n'avait jamais fait montre de dons musicaux auparavant, même s'il pouvait mémoriser des symphonies entières et s'en souvenir des dizaines d'années plus tard. Il pouvait aussi commenter le morceau qu'il était en train de jouer, ou comparer différents morceaux de musique avec ceux qu'il avait déjà entendus. Il pouvait également, à l'écoute, distinguer quel instrument jouait, sur quelle portée, et adorait deviner les compositeurs de nouveaux morceaux en les comparant avec les milliers d'échantillons qu'il avait en mémoire.
En revanche, il ne savait pas boutonner sa chemise et éprouvait des difficultés dans les activités motrices quotidiennes, comme se brosser les dents ou mettre ses chaussures, probablement à cause de son cervelet défaillant. Aux tests de QI, il obtenait un score général inférieur à la moyenne, mais d'excellents résultats dans des domaines spécifiques : cela a mené à la conclusion que de tels tests ne constituaient pas des outils adéquats pour mesurer ses capacités.
Comme la plupart des personnes développant le syndrome du savant, Kim Peek avait des difficultés à accéder psychologiquement à l'abstraction et à l'humour. Son père a relevé que son sens de l'humour s'était développé en 2004, et ses capacités à associer les informations montraient des facultés créatives. Il éprouvait toutefois encore des difficultés à interpréter le sens d'un proverbe ou d'une métaphore.
En 1984, le scénariste Barry Morrow l'a rencontré à Arlington, au Texas. Ce fut sa source d'inspiration pour le film Rain Man (1988). Dustin Hoffman aussi l'a rencontré, ainsi que d'autres personnes autistes, dans le but de s'imprégner de leur spécificité. À la suite de ce film, Kim Peek a été régulièrement invité à différentes émissions de télévision.
En 2004, des scientifiques de la NASA lui ont fait subir de nombreux tests, dont des tomographies et des IRM. Ils souhaitaient comparer l'évolution de son cerveau depuis les derniers tests faits en 1988.
Il est mort d'un arrêt cardiaque le 19 décembre 2009 à Salt Lake City, dans l'Utah, à l'âge de 58 ans.
Source Wikipédia: Kim Peek
Alexei Leonov 1934-2019
Wikipédia: Alexei Leonov
Voir le trailer du film s'inspirant de la vie d'Alexei Leonov
 Alexeï Arkhipovitch Leonov (en russe : Алексе́й Архи́пович Лео́нов), né le 30 mai 1934 à Listvianka (oblast de Kemerovo) et mort le 11 octobre 2019 à Moscou, est un cosmonaute soviétique.
Pilote de chasse de formation, il est sélectionné en 1961, au tout début de l'ère spatiale, pour faire partie du premier groupe de cosmonautes. Il est le premier homme à avoir réalisé une sortie extravéhiculaire dans l'espace dans le cadre de la mission Voskhod 2, le 18 mars 1965. Leonov est un des cosmonautes entrainé pour participer aux premières missions vers la Lune mais le programme lunaire habité soviétique est arrêté en 1974 à la suite des échecs répétés du lanceur géant N1. Pour son deuxième séjour dans l'espace qui a lieu en 1975, il est commandant du Soyouz 19 et participe à la mission Apollo-Soyouz qui constitue le premier vol spatial conjoint entre les États-Unis et l'Union soviétique. Cet événement symbolique marque un réchauffement des relations entre les deux pays qui s'affrontaient jusque là durant la guerre froide. De 1976 jusqu'à sa retraite en 1991 il est responsable de l'entrainement des cosmonautes soviétiques.
Alexeï Leonov naît le 30 mai 1934 dans le village de Listvianka situé dans le district de Tisoulski (oblast de Kemerovo) en région économique de Sibérie occidentale. Il est un des neuf enfants survivants du mineur et électricien Arkhip et de sa femme Ievdokia. Avant même de savoir lire et écrire, il se prend de passion pour le dessin. En 1937, en pleine purges staliniennes, son père est emprisonné pour activités anticommunistes, de fausses accusations selon Alexeï. Sa famille doit quitter le village après avoir été dépouillé de tous ses biens par les autres villageois y compris les vêtements qu'ils portent. Les années de guerre sont comme dans toute l'Union soviétique marquées par les privations. C'est un enfant espiègle. Il continue de dessiner et ses œuvres sont considérées comme suffisamment bonnes pour décorer l’hôpital local. Les autorités soviétiques ayant décidé de repeupler de russes les anciens territoires allemands du bord de la mer Baltique qui ont été annexés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la famille de Leonov doit déménager à Kaliningrad en 1948. Leonov découvre la mer qui devient un des sujets favoris de ses peintures par la suite. La région, bien qu’abandonnée par ses anciens occupants allemands, est imprégnée de leur culture. Ce contexte jouera peut-être un rôle dans la formation de la personnalité de Leonov qui deviendra un des cosmonautes les plus diplomates capable de charmer aussi bien les dirigeants du monde capitaliste que les responsables soviétiques. Leonov, devenu adulte, envisage de suivre une carrière artistique. Mais son frère ayant choisi de devenir mécanicien sur avion, il décide de suivre une formation de pilote dans l'armée de l'air. Entre également en ligne de compte, le fait que, contrairement à l'école des Beaux Arts, l'école militaire lui fournit le logement. Il commence à suivre des cours théoriques de pilotage en juillet 1953, réalise son premier vol en janvier 1955 et effectue son premier vol en solo quatre mois plus tard. Il n'a pas renoncé à sa passion pour la peinture et suit en parallèle des cours de dessin le soir. Il rencontre à cette époque Svletana Pavlova, une future enseignante, avec laquelle il se mariera en 1959. Il décroche en 1957 un diplôme de pilote à l'académie militaire de Tchouhouïv (Ukraine).
Alexeï Arkhipovitch Leonov (en russe : Алексе́й Архи́пович Лео́нов), né le 30 mai 1934 à Listvianka (oblast de Kemerovo) et mort le 11 octobre 2019 à Moscou, est un cosmonaute soviétique.
Pilote de chasse de formation, il est sélectionné en 1961, au tout début de l'ère spatiale, pour faire partie du premier groupe de cosmonautes. Il est le premier homme à avoir réalisé une sortie extravéhiculaire dans l'espace dans le cadre de la mission Voskhod 2, le 18 mars 1965. Leonov est un des cosmonautes entrainé pour participer aux premières missions vers la Lune mais le programme lunaire habité soviétique est arrêté en 1974 à la suite des échecs répétés du lanceur géant N1. Pour son deuxième séjour dans l'espace qui a lieu en 1975, il est commandant du Soyouz 19 et participe à la mission Apollo-Soyouz qui constitue le premier vol spatial conjoint entre les États-Unis et l'Union soviétique. Cet événement symbolique marque un réchauffement des relations entre les deux pays qui s'affrontaient jusque là durant la guerre froide. De 1976 jusqu'à sa retraite en 1991 il est responsable de l'entrainement des cosmonautes soviétiques.
Alexeï Leonov naît le 30 mai 1934 dans le village de Listvianka situé dans le district de Tisoulski (oblast de Kemerovo) en région économique de Sibérie occidentale. Il est un des neuf enfants survivants du mineur et électricien Arkhip et de sa femme Ievdokia. Avant même de savoir lire et écrire, il se prend de passion pour le dessin. En 1937, en pleine purges staliniennes, son père est emprisonné pour activités anticommunistes, de fausses accusations selon Alexeï. Sa famille doit quitter le village après avoir été dépouillé de tous ses biens par les autres villageois y compris les vêtements qu'ils portent. Les années de guerre sont comme dans toute l'Union soviétique marquées par les privations. C'est un enfant espiègle. Il continue de dessiner et ses œuvres sont considérées comme suffisamment bonnes pour décorer l’hôpital local. Les autorités soviétiques ayant décidé de repeupler de russes les anciens territoires allemands du bord de la mer Baltique qui ont été annexés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la famille de Leonov doit déménager à Kaliningrad en 1948. Leonov découvre la mer qui devient un des sujets favoris de ses peintures par la suite. La région, bien qu’abandonnée par ses anciens occupants allemands, est imprégnée de leur culture. Ce contexte jouera peut-être un rôle dans la formation de la personnalité de Leonov qui deviendra un des cosmonautes les plus diplomates capable de charmer aussi bien les dirigeants du monde capitaliste que les responsables soviétiques. Leonov, devenu adulte, envisage de suivre une carrière artistique. Mais son frère ayant choisi de devenir mécanicien sur avion, il décide de suivre une formation de pilote dans l'armée de l'air. Entre également en ligne de compte, le fait que, contrairement à l'école des Beaux Arts, l'école militaire lui fournit le logement. Il commence à suivre des cours théoriques de pilotage en juillet 1953, réalise son premier vol en janvier 1955 et effectue son premier vol en solo quatre mois plus tard. Il n'a pas renoncé à sa passion pour la peinture et suit en parallèle des cours de dessin le soir. Il rencontre à cette époque Svletana Pavlova, une future enseignante, avec laquelle il se mariera en 1959. Il décroche en 1957 un diplôme de pilote à l'académie militaire de Tchouhouïv (Ukraine).
Source Wikipédia: Alexeï Leonov
Charles Darwin 1809 - 1882
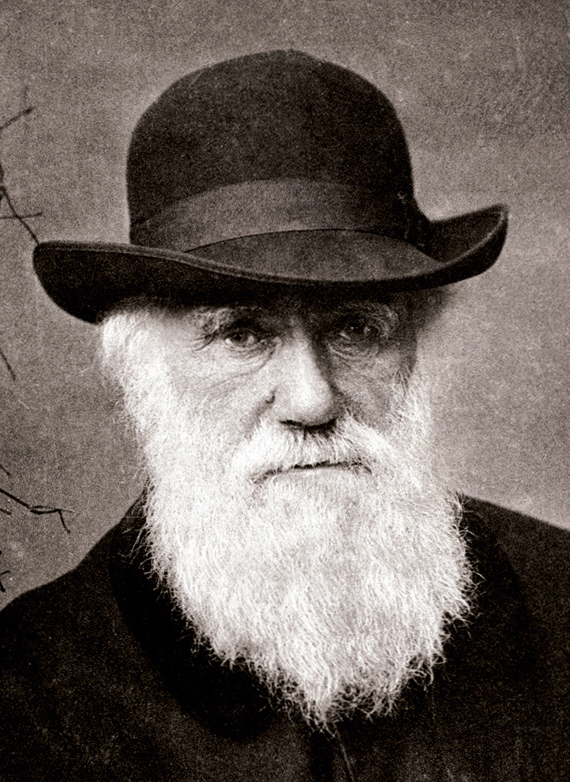 Charles Darwin, né le 12 février 1809 à Shrewsbury dans le Shropshire et mort le 19 avril 1882 à Downe dans le Kent, est un naturaliste et paléontologue anglais dont les travaux sur l'évolution des espèces vivantes ont révolutionné la biologie avec son ouvrage L'Origine des espèces paru en 1859. Célèbre au sein de la communauté scientifique de son époque pour son travail sur le terrain et ses recherches en géologie, il a adopté l'hypothèse émise 50 ans auparavant par le Français Jean-Baptiste de Lamarck selon laquelle toutes les espèces vivantes ont évolué au cours du temps à partir d'un seul ou quelques ancêtres communs et il a soutenu avec Alfred Wallace que cette évolution était due au processus sélection naturelle.
Charles Darwin, né le 12 février 1809 à Shrewsbury dans le Shropshire et mort le 19 avril 1882 à Downe dans le Kent, est un naturaliste et paléontologue anglais dont les travaux sur l'évolution des espèces vivantes ont révolutionné la biologie avec son ouvrage L'Origine des espèces paru en 1859. Célèbre au sein de la communauté scientifique de son époque pour son travail sur le terrain et ses recherches en géologie, il a adopté l'hypothèse émise 50 ans auparavant par le Français Jean-Baptiste de Lamarck selon laquelle toutes les espèces vivantes ont évolué au cours du temps à partir d'un seul ou quelques ancêtres communs et il a soutenu avec Alfred Wallace que cette évolution était due au processus sélection naturelle.
Darwin a vu de son vivant la théorie de l'évolution acceptée par la communauté scientifique et le grand public, alors que sa théorie sur la sélection naturelle a dû attendre les années 1930 pour être généralement considérée comme l'explication essentielle du processus d'évolution. Au XXIe siècle, elle constitue en effet la base de la théorie moderne de l'évolution. Sous une forme modifiée, la découverte scientifique de Darwin reste le fondement de la biologie, car elle explique de façon logique et unifiée la diversité de la vie.
L'intérêt de Darwin pour l'histoire naturelle lui vint alors qu'il avait commencé à étudier la médecine à l'université d'Édimbourg, puis la théologie à Cambridge. Son voyage de cinq ans à bord du Beagle l'établit dans un premier temps comme un géologue dont les observations et les théories soutenaient les théories actualistes de Charles Lyell. La publication de son journal de voyage le rendit célèbre. Intrigué par la distribution géographique de la faune sauvage et des fossiles dont il avait recueilli des spécimens au cours de son voyage, il étudia la transformation des espèces et en conçut sa théorie sur la sélection naturelle en 1838. Il fut fortement influencé par les théories de Georges-Louis Leclerc de Buffon.
Ayant constaté que d'autres avaient été qualifiés d'hérétiques pour avoir avancé des idées analogues, il ne se confia qu'à ses amis les plus intimes et continua à développer ses recherches pour prévenir les objections qui immanquablement lui seraient faites.
En 1858, Alfred Russel Wallace lui fit parvenir un essai qui décrivait une théorie semblable, ce qui les amena à faire connaître leurs théories dans une présentation commune. Son livre de 1859, L'Origine des espèces, fit de l'évolution à partir d'une ascendance commune l'explication scientifique dominante de la diversification des espèces naturelles. Il examina l'évolution humaine et la sélection sexuelle dans La Filiation de l'homme et la sélection liée au sexe, suivi par L'Expression des émotions chez l'homme et les animaux. Ses recherches sur les plantes furent publiées dans une série de livres et, dans son dernier ouvrage, il étudiait les lombrics et leur action sur le sol.
Source Wikipédia: Charles Darwin
Eugen Sanger 1905 - 1964
 Eugène Sänger (né le 22 septembre 1905 à Preßnitz en ex-Autriche-Hongrie et mort le 10 février 1964 à Berlin) était un ingénieur aéronautique autrichien et fut un des pionniers de l'astronautique, surtout connu pour ses recherches sur le corps portant et le statoréacteur.
Eugène Sänger (né le 22 septembre 1905 à Preßnitz en ex-Autriche-Hongrie et mort le 10 février 1964 à Berlin) était un ingénieur aéronautique autrichien et fut un des pionniers de l'astronautique, surtout connu pour ses recherches sur le corps portant et le statoréacteur.
Eugène Sänger est né le 22 septembre 1905 dans l'ancienne ville minière de Pressnitz (en) en Bohême alors dans l'empire austro-hongrois (devenue la ville de Přísečnice et désormais inondée par la construction du barrage de Přísečnice en 1974).
Il étudie le génie civil dans les universités techniques de Graz et de Vienne.
Étudiant, il lit le livre d'Hermann Oberth Die Rakete zu den Planetenräumen (« Dans l'espace planétaire par une fusée »), qui le pousse à changer d'orientation et à s'inscrire aux cours d'aéronautique. Il rejoint aussi le mouvement amateur sur les fusées, le Verein für Raumschiffahrt ou VfR (« Société pour le voyage spatial ») formé autour d'Oberth.
Sänger fait du vol propulsé par fusée le sujet de sa thèse mais celle-ci est rejetée par l'université car jugée trop fantaisiste.
Il obtient son diplôme d'ingénieur en aéronautique en 1930 avec une thèse beaucoup plus banale sur la statique des ailes en treillis.
Sänger tirera plus tard de sa thèse rejetée un livre publié en 1933 à Munich sous le titre Raketenflugtechnik (« Technique de vol des fusées »).
Cet ouvrage allait être l'un des plus importants traités de théorie dans le domaine des fusées.
En 1935 et 1936, il publia des articles sur le vol de fusée dans le journal aéronautique autrichien Flug ("Volant").
Cela attira l'attention du Reichsluftfahrtministerium, le ministère de l'Aviation du Reich, qui voyait dans les idées de Sänger un des moyens possibles pour atteindre l'objectif de construire un bombardier capable de frapper les États-Unis depuis l'Allemagne (le projet Amerika-Bomber).
En 1936, Sänger accepte d'autant plus facilement la direction d'une équipe de développement dans la région de la lande de Lunebourg dans le nord de l'Allemagne, qu'il est lui-même un nazi convaincu, déjà membre du parti en Autriche.
Eugène Sänger conçoit progressivement un chariot équipé de fusée pour lancer un bombardier lui-même propulsé par fusée qui monterait à la limite de l'espace, mais sans se placer en orbite mais capable de couvrir une grande distance par une série de sauts suborbitaux, à la limite de la haute atmosphère.
L'engin baptisé Silbervogel (« Oiseau d'argent ») repose sur l'exploitation de la portance du fuselage (concept du corps portant) qui permet à cet avion spatial de rebondir sur l'atmosphère à chaque fois qu'il retombe vers le sol et pénètre dans les couches denses de l'atmosphère. Sänger est assisté dans ses travaux par la mathématicienne allemande Irene Sänger-Bredt qu'il épousera en 1951.
Sänger conçoit aussi les moteurs-fusées que l'avion spatial devra utiliser et qui doivent générer 1 méganewton de poussée. Il est l'un des premiers ingénieurs à suggérer l'utilisation du carburant de la fusée pour refroidir le moteur en le faisant circuler autour de la tuyère avant qu'il ne soit brulé dans le moteur.
Ses travaux à Peenemünde, comme ceux de von Braun sur les V2, utilisent massivement dans les souterrains du complexe militaro-industriel une main-d'œuvre gratuite de déportés parmi lesquels on comptera des dizaines de milliers de morts.
En 1942, à la suite de la défaite de Stalingrad, le ministère de l'Air annule ces projets, comme d'autres projets ambitieux ou théoriques, pour se concentrer sur des technologies ayant fait leurs preuves. Sänger est transféré au Deutsche Forschungsanstalt für Segelflug ou DFS (« Institut allemand de recherche sur le vol à voile»).
Il y effectue, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un important travail sur la technologie du statoréacteur.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Eugen Sanger
Fiodor Dostoievski 1821 - 1881
 Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski, est un écrivain russe, né à Moscou le 30 octobre 1821 (11 novembre 1821 dans le calendrier grégorien) et mort à Saint-Pétersbourg le 28 janvier 1881 (9 février 1881 dans le calendrier grégorien).
Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski, est un écrivain russe, né à Moscou le 30 octobre 1821 (11 novembre 1821 dans le calendrier grégorien) et mort à Saint-Pétersbourg le 28 janvier 1881 (9 février 1881 dans le calendrier grégorien).
Considéré comme l'un des plus grands romanciers russes, il a influencé de nombreux écrivains et philosophes.
Après une enfance difficile, il fréquente une école d'officiers et se lie avec les mouvements progressistes pétersbourgeois.
Arrêté en avril 1849, il est condamné à mort. Après un simulacre d'exécution, il est finalement déporté dans un bagne de Sibérie pendant quatre ans.
Redevenu sous-lieutenant, il démissionne de l'armée en 1859 et s'engage complètement dans l'écriture. Épileptique, joueur couvert de dettes et d'un caractère sombre, Dostoïevski fuit ses créanciers et mène une vie d'errance en Europe au cours de laquelle il abandonne toute foi dans le socialisme et devient un patriote convaincu de l'Empire russe.
Écrivain admiré après la publication de Crime et Châtiment (1866) et de L'Idiot (1869), l'auteur publie ensuite ses deux œuvres les plus abouties : Les Démons (1871) et Les Frères Karamazov (1880).
Les romans de Dostoïevski sont parfois qualifiés de « métaphysiques », tant la question angoissée du libre arbitre et de l'existence de Dieu est au cœur de sa réflexion, tout comme la figure du Christ.
Ses œuvres ne sont pas des « romans à thèse », mais des romans où s'opposent de façon dialectique des points de vue différents avec des personnages qui se construisent eux-mêmes, au travers de leurs actes et de leurs interactions sociales.
Dostoïevski chemine ainsi principalement sur différents thèmes de la nature humaine et de la condition humaine.
D'origine tatare par son ancêtre Aslan Tchereby-Mours, « demeuré en Moscovie après l'éviction de la Horde d'or », Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski est le second fils de Mikhaïl Andreïevitch Dostoïevski, médecin militaire à l'hôpital des Indigents de Moscou et de Maria Fiodorovna Netchaïev.
Le père, alcoolique, est d'humeur morose et fait régner une atmosphère insupportable à la maison ; selon l'écrivain : « Mikhaïl Andréiévitch n'aimait pas du tout parler de son père et demandait qu'on ne le questionnât pas sur lui. »
En 1827, Mikhaïl Andréiévitch est nommé « assesseur de collège » et obtient ainsi un titre de noblesse héréditaire.
Il fait l'acquisition de deux villages, Darovoié et Tchermachnia, en 1831. En 1832, les deux hameaux sont détruits par un incendie.
Après la mort de la mère, le 27 février 1837, la tante maternelle, Alexandra, joue un grand rôle dans la vie de la famille.
Il lit avec ferveur Shakespeare, Goethe, Victor Hugo et surtout Schiller, auteur déterminant dans sa vocation d'écrivain : « Lorsque j'avais dix ans, je vis à Moscou, une représentation des Brigands de Schiller avec Motchalov, et je vous affirme que l'énorme impression que je subis alors exerça une féconde influence sur mon univers spirituel. »
À l'initiative de son père, qui y voyait probablement les avantages d'un écolage pris en charge par l'État, Fiodor intègre une formation militaire, alors qu'il n'a ni don ni goût pour la vie de soldat.
Après en avoir réussi l'examen d'entrée, Fiodor intègre l'École supérieure des Ingénieurs militaires de Saint-Pétersbourg en 1838.
Tant bien que mal, il effectue sa scolarité dans l'indigence, n'ayant parfois pas de quoi se nourrir, car son oncle (qui l'accueille) refuse de lui envoyer suffisamment d'argent.
C'est un élève taciturne, au regard mystérieusement mélancolique, qui ne s'intègre pas bien à l'école.
Il méprise le matérialisme et le carriérisme de ses camarades.
Selon une rumeur forgée par un riche voisin, P. P. Hotjaïncev, qui lorgnait les terres du village de Darovoié, Mikhaïl Dostoïevski aurait été tué le 8 juin 1839 par les serfs de Darovoié, excédés par les mauvais traitements que leur faisait subir leur maître.
En réalité, il meurt victime d'une crise d'apoplexie, comme le confirme son autopsie.
Selon la tradition familiale, la nouvelle de la mort de son père tué par ses serfs est l'occasion d'une crise nerveuse, qui pourrait bien être une première crise d'épilepsie.
Cette légende familiale, renforcée par le diagnostic de Freud selon lequel cette attaque épileptique était « une autopunition pour le souhait de mort contre le père haï », est aujourd'hui remise en question par certains ou étudiée sous d'autres angles, Dostoïevski ayant probablement eu sa première crise d'épilepsie en 1850 à Omsk.
En 1842, Fiodor Dostoïevski est nommé sous-lieutenant et entre en tant que dessinateur au département des plans de campagne de la direction du Génie à Saint-Pétersbourg, emploi qui l'ennuie profondément.
À 22 ans, pendant l'été 1844, il démissionne pour se consacrer à son premier roman, Les Pauvres Gens.
Porté aux nues par le poète Nikolaï Nekrassov et l'influent critique Vissarion Belinski, le roman est publié en janvier 1846 et connaît un succès public certain. Dostoïevski se retrouve alors propulsé au rang de « nouveau Gogol » et se pavane dans les cercles mondains de Saint-Pétersbourg.
Bientôt, l'élite commence à railler son manque de tenue, son air abattu. Ivan Tourgueniev publie une satire en vers, où il le qualifie de « chevalier à la triste figure » et d'« aimable fanfaron ».
C'est lors d'une de ces soirées que l'écrivain connaît vraisemblablement une première crise d'épilepsie (non diagnostiquée comme telle).
Sa disgrâce est accélérée par la publication de ses romans suivants, Le Double et La Logeuse, qui ne rencontrent pas le succès escompté.
Depuis décembre 1846 ou janvier 1847, il fréquente le Cercle fouriériste de Mikhaïl Petrachevski, un fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, qui combat l'absolutisme de Nicolas Ier.
Il n'adhère pas à un système en particulier (ses opinions se seraient progressivement orientées vers un mysticisme slavophile), mais cherche à maintenir une présence dans les milieux intellectuels progressistes pétersbourgeois.
Il ne fréquente pas ces cercles pour fomenter de réelles actions révolutionnaires, mais pour discuter d'idées nouvelles et surtout parler de l'avenir de la Russie.
Cette même année, il fait sa première crise d'épilepsie, à 26 ans.
En avril 1849, les membres du Cercle de Petrachevski sont arrêtés ; Dostoïevski est emprisonné à la forteresse Pierre-et-Paul. L'empereur Nicolas Ier voit resurgir le spectre de l'insurrection décabriste, un complot qui s'était propagé dans l'armée et avait abouti à la sanglante émeute du 14 décembre 1825 (26 décembre 1825 dans le calendrier grégorien). Mikhaïl Dostoïevski est également brièvement arrêté.
Après une instruction de plusieurs mois, un procès, une condamnation à mort et un simulacre d'exécution sur la place Semenovski le 22 décembre 1849, l'empereur graciant les prisonniers à l'instant même où ils allaient être fusillés, la condamnation à mort est commuée en exil de plusieurs années et la peine en déportation dans un bagne de Sibérie.
Fiodor Dostoïevski voit sa peine commuée en quatre ans de travaux forcés, auxquels s'ajoute l'obligation de servir ensuite comme simple soldat.
Leonid Grossman voit dans cet épisode tragique l'origine du revirement idéologique de Dostoïevski, constaté à plusieurs reprises à partir de son séjour au bagne d'Omsk.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Fiodor Dostoievski
Alfred Nobel 1833 - 1896
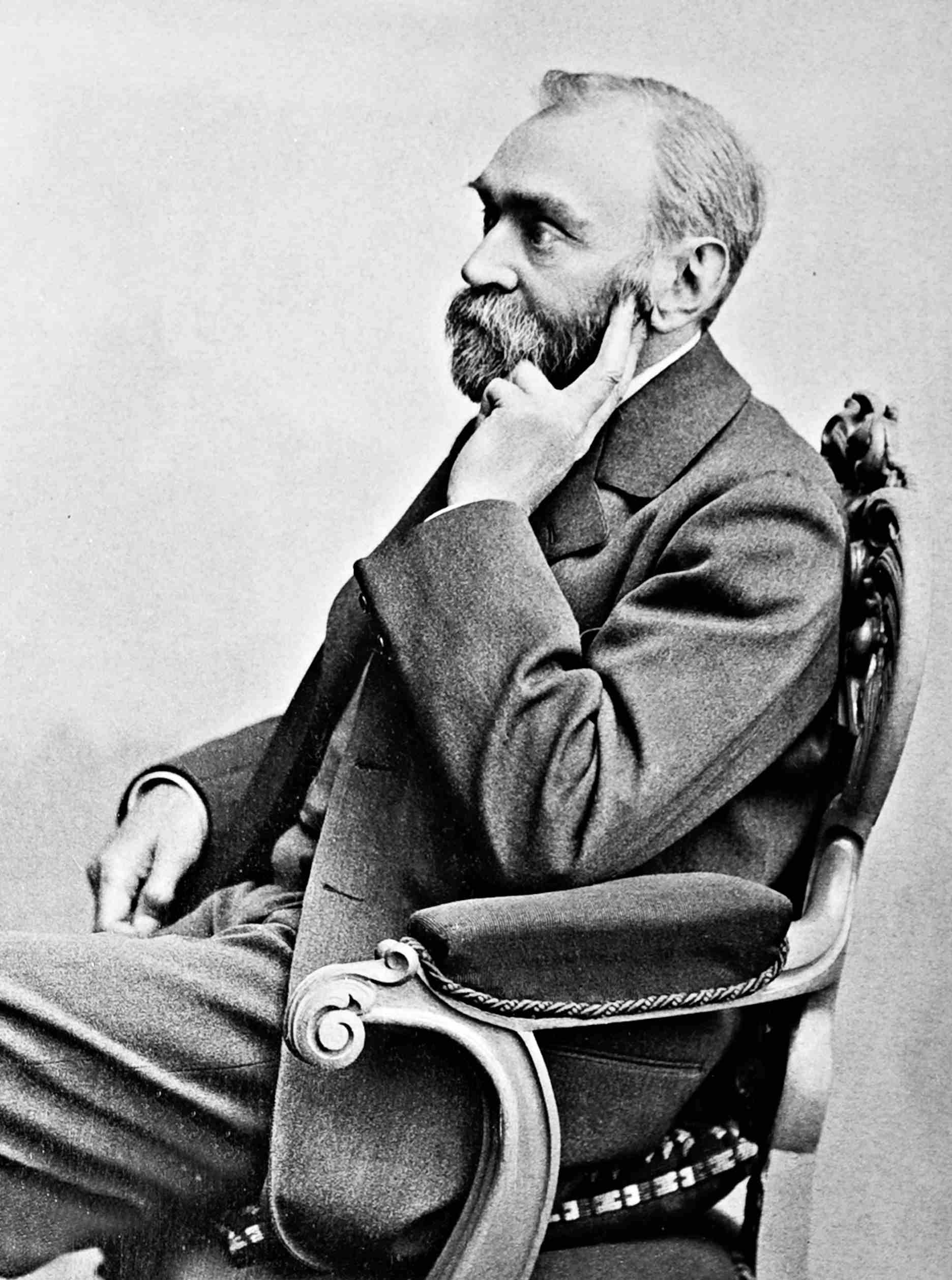 Alfred Bernhard Nobel , né le 21 octobre 1833 à Stockholm en Suède et mort le 10 décembre 1896 à Sanremo en Italie, est un chimiste, industriel et fabricant d'armes suédois. Dépositaire de plus de 350 brevets scientifiques de son vivant, dont celui de la dynamite, invention qui a fait sa renommée. Il fonde l'entreprise KemaNobel en 1871, et rachète l'entreprise d'armement Bofors en 1894.
Alfred Bernhard Nobel , né le 21 octobre 1833 à Stockholm en Suède et mort le 10 décembre 1896 à Sanremo en Italie, est un chimiste, industriel et fabricant d'armes suédois. Dépositaire de plus de 350 brevets scientifiques de son vivant, dont celui de la dynamite, invention qui a fait sa renommée. Il fonde l'entreprise KemaNobel en 1871, et rachète l'entreprise d'armement Bofors en 1894.
Dans son testament, il légua son immense fortune pour la création du prix Nobel. L'élément chimique nobélium a été appelé ainsi en son honneur.
Alfred Bernhard Nobel est le troisième fils d'Immanuel Nobel (1801-1872) et d'Andriette Ahlsell Nobel. Membre de la famille Nobel comportant de nombreux ingénieurs, il descend d'Olof Rudbeck (1630-1702), l'un des scientifiques suédois les plus connus du XVIIe siècle, auteur de l'ouvrage de science-fiction Atlantis.
À l'âge de neuf ans, il déménage avec sa famille pour Saint-Pétersbourg, où son père, qui plus tard inventera le contreplaqué moderne, fonde une entreprise de mines marines. Immanuel Nobel s'est en effet installé en Russie en 1838 après avoir subi un revers de fortune dans son pays à tradition pacifiste, ses inventions d'explosifs, telles les mines, obtenant peu de succès en Suède6. À l'âge de 18 ans, Alfred part aux États-Unis, où il étudie la chimie pendant quatre ans et travaille pendant une courte période avec John Ericsson. En 1859, la direction de l'entreprise paternelle est laissée à son frère Ludvig Nobel (1831-1888), qui plus tard fonda, en Russie, la Machine-Building Factory Ludvig Nobel et Branobel, devenant l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de Russie.
Source Wikipédia: Alfred Nobel
Curie Pierre 1859 - 1906
 Pierre Curie (15 mai 1859 à Paris - 19 avril 1906 à Paris) est un physicien français. Il est principalement connu pour ses travaux en radioactivité, en magnétisme et en piézoélectricité. Lui et son épouse, Marie Curie, pionniers de l'étude des radiations, reçurent une moitié du prix Nobel de physique de 1903 (l'autre moitié a été remise à Henri Becquerel) « en reconnaissance des services extraordinaires qu'ils ont rendus par leur effort conjoint de recherches sur les phénomènes des radiations découvertes par le professeur Henri Becquerel ».
Pierre Curie (15 mai 1859 à Paris - 19 avril 1906 à Paris) est un physicien français. Il est principalement connu pour ses travaux en radioactivité, en magnétisme et en piézoélectricité. Lui et son épouse, Marie Curie, pionniers de l'étude des radiations, reçurent une moitié du prix Nobel de physique de 1903 (l'autre moitié a été remise à Henri Becquerel) « en reconnaissance des services extraordinaires qu'ils ont rendus par leur effort conjoint de recherches sur les phénomènes des radiations découvertes par le professeur Henri Becquerel ».
Pierre Curie est le fils d'un médecin protestant, Eugène Curie (1827-1910) et de Sophie-Claire Depouilly (1832-1897). Il a un frère aîné, Jacques Curie (1856-1941), avec qui, il découvre la piézoélectricité.
Le grand-père de Pierre Curie, Paul Curie (1799-1853), docteur en médecine homéopathe, est un humaniste malthusien engagé et marié à Augustine Hofer, fille de Jean Hofer et arrière-petite-fille de Jean-Henri Dollfus, grands industriels mulhousiens de la seconde moitié du XVIIIe siècle et de la première partie du XIXe siècle.
Par cette grand-mère paternelle, Pierre Curie se trouve également être un descendant en ligne directe du savant et mathématicien bâlois, Jean Bernoulli (1667-1748), tout comme Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de physique 1991.
Pierre Curie ne fréquente ni l'école, ni le lycée, l'enseignement ne devenant obligatoire en France qu'à partir de 1881 (lois Ferry). Son instruction est dès lors assurée par ses parents, puis par un ami de la famille, M. Bazille, qui lui enseigne les mathématiques élémentaires et spéciales, ce qui développe les capacités mentales de Pierre, qui a clairement un intérêt pour cette science. À 16 ans, en novembre 1875, il passe son baccalauréat en sciences.
Source Wikipédia: Pierre Curie
Curie Marie Skłodowska 1867 - 1934
 Marie Skłodowska-Curie, ou simplement Marie Curie, née Maria Salomea Skłodowska) le 7 novembre 1867 à Varsovie (Pologne, alors sous domination russe) et morte le 4 juillet 1934 à Passy (Haute-Savoie), est une physicienne et chimiste polonaise, naturalisée française.
Marie Curie et Pierre Curie — son époux — partagent avec Henri Becquerel le prix Nobel de physique de 1903 pour leurs recherches sur les radiations. En 1911, elle obtient le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium et le radium.
Scientifique d'exception, elle est la première femme à avoir reçu le prix Nobel, et à ce jour la seule femme à en avoir reçu deux. Elle reste à ce jour la seule personne à avoir été récompensée dans deux domaines scientifiques distincts.
Elle est également la première femme lauréate en 1903, avec son mari, de la médaille Davy pour ses travaux sur le radium. Une partie de ses cahiers d'expérience sont conservés à la Bibliothèque nationale de France et ont été numérisés.
Maria Salomea Skłodowska naît à Varsovie, alors dans l'Empire russe, d'un père d'origine noble (herb Dołęga), professeur de mathématiques et de physique, et d'une mère institutrice. Elle est la benjamine d'une famille de trois sœurs, Zofia (1863-1876), Bronisława (Bronia) Dłuska (1865-1939) et Helena Szalay (1866-1961), et un frère, Józef Skłodowski (1863-1937).
En l’espace de deux ans, elle perd sa sœur Zofia, morte du typhus en janvier 1876, et sa mère, qui succombe à la tuberculose le 9 mai 1878. Elle se réfugie alors dans les études où elle excelle dans toutes les matières, et où la note maximale lui est accordée. Elle obtient ainsi son diplôme de fin d’études secondaires avec la médaille d’or en 1883. Elle adhère à la doctrine positiviste d'Auguste Comte et rejoint l'Université volante, illégale, qui participe en Pologne à l'éducation clandestine des masses en réaction à la russification de la société par l'Empire russe.
Elle souhaite poursuivre des études supérieures et enseigner à l'instar de l'Université volante, mais ces études sont interdites aux femmes dans son pays natal. Lorsque sa sœur aînée, Bronia, part faire des études de médecine à Paris, Maria s'engage comme gouvernante en province en espérant économiser pour la rejoindre, tout en ayant initialement pour objectif de revenir en Pologne pour enseigner. Au bout de trois ans, elle regagne Varsovie, où un cousin lui permet d'entrer dans un laboratoire.
En 1891, elle part pour Paris, où elle est hébergée par sa sœur et son beau-frère, rue d'Allemagne, non loin de la gare du Nord. Le 3 novembre 1891, elle s'inscrit pour des études de physique à la faculté des sciences de Paris. Parmi les 776 étudiants de la faculté des sciences en janvier 1895, il se trouve 27 femmes. Si la plupart des étudiantes en faculté de médecine sont des étrangères, elles ne sont que 7 étrangères sur les 27 étudiantes en sciences.
En mars 1892, elle déménage dans une chambre meublée de la rue Flatters dans le quartier latin, plus calme et plus proche des installations de la faculté. Elle suit les cours des physiciens Edmond Bouty et Gabriel Lippmann et des mathématiciens Paul Painlevé et Paul Appell.
Un an plus tard, en juillet 1893, elle obtient sa licence en sciences physiques, en étant première de sa promotion. Pendant l'été, une bourse d'études de 600 roubles lui est accordée, qui lui permet de poursuivre ses études à Paris. Un an plus tard, juillet 1894, elle obtient sa licence en sciences mathématiques, en étant seconde. Elle hésite alors à retourner en Pologne.
Elle rejoint début 1894 le laboratoire des recherches physiques de Gabriel Lippmann, au sein duquel la Société d'encouragement pour l'industrie nationale lui a confié des travaux de recherche sur les propriétés magnétiques de différents aciers. Elle y travaillait à l'étroit et dans des conditions spartiates, et recherche donc une façon de mener à bien ses propres travaux. Le professeur Józef Kowalski de l'Université de Fribourg lui fait alors rencontrer lors d'une soirée Pierre Curie, qui est chef des travaux de physique à l'École municipale de physique et de chimie industrielles et étudie également le magnétisme, avec qui elle va finir par accepter de travailler.
Lors de cette collaboration se développe une inclination mutuelle entre les deux scientifiques. Marie Skłodowska rentre à Varsovie, pour se rapprocher des siens, et dans le but d'enseigner et de participer à l'émancipation de la Pologne, mais Pierre Curie lui demande de rentrer à Paris pour vivre avec lui. Le couple se marie à Sceaux, le 26 juillet 1895.
Durant l'année 1895-1896, elle prépare à la faculté le concours d'agrégation pour l'enseignement des jeunes filles section mathématiques, auquel elle est reçue première. Elle ne prend cependant pas de poste d'enseignant, souhaitant préparer une thèse de doctorat. En parallèle, Marie Skłodowska (désormais Curie) suit également les cours de Marcel Brillouin et documente ses premiers travaux de recherche sur les aciers. Le 12 septembre 1897, elle donne naissance à sa première fille, Irène.
Marie Skłodowska-Curie, ou simplement Marie Curie, née Maria Salomea Skłodowska) le 7 novembre 1867 à Varsovie (Pologne, alors sous domination russe) et morte le 4 juillet 1934 à Passy (Haute-Savoie), est une physicienne et chimiste polonaise, naturalisée française.
Marie Curie et Pierre Curie — son époux — partagent avec Henri Becquerel le prix Nobel de physique de 1903 pour leurs recherches sur les radiations. En 1911, elle obtient le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium et le radium.
Scientifique d'exception, elle est la première femme à avoir reçu le prix Nobel, et à ce jour la seule femme à en avoir reçu deux. Elle reste à ce jour la seule personne à avoir été récompensée dans deux domaines scientifiques distincts.
Elle est également la première femme lauréate en 1903, avec son mari, de la médaille Davy pour ses travaux sur le radium. Une partie de ses cahiers d'expérience sont conservés à la Bibliothèque nationale de France et ont été numérisés.
Maria Salomea Skłodowska naît à Varsovie, alors dans l'Empire russe, d'un père d'origine noble (herb Dołęga), professeur de mathématiques et de physique, et d'une mère institutrice. Elle est la benjamine d'une famille de trois sœurs, Zofia (1863-1876), Bronisława (Bronia) Dłuska (1865-1939) et Helena Szalay (1866-1961), et un frère, Józef Skłodowski (1863-1937).
En l’espace de deux ans, elle perd sa sœur Zofia, morte du typhus en janvier 1876, et sa mère, qui succombe à la tuberculose le 9 mai 1878. Elle se réfugie alors dans les études où elle excelle dans toutes les matières, et où la note maximale lui est accordée. Elle obtient ainsi son diplôme de fin d’études secondaires avec la médaille d’or en 1883. Elle adhère à la doctrine positiviste d'Auguste Comte et rejoint l'Université volante, illégale, qui participe en Pologne à l'éducation clandestine des masses en réaction à la russification de la société par l'Empire russe.
Elle souhaite poursuivre des études supérieures et enseigner à l'instar de l'Université volante, mais ces études sont interdites aux femmes dans son pays natal. Lorsque sa sœur aînée, Bronia, part faire des études de médecine à Paris, Maria s'engage comme gouvernante en province en espérant économiser pour la rejoindre, tout en ayant initialement pour objectif de revenir en Pologne pour enseigner. Au bout de trois ans, elle regagne Varsovie, où un cousin lui permet d'entrer dans un laboratoire.
En 1891, elle part pour Paris, où elle est hébergée par sa sœur et son beau-frère, rue d'Allemagne, non loin de la gare du Nord. Le 3 novembre 1891, elle s'inscrit pour des études de physique à la faculté des sciences de Paris. Parmi les 776 étudiants de la faculté des sciences en janvier 1895, il se trouve 27 femmes. Si la plupart des étudiantes en faculté de médecine sont des étrangères, elles ne sont que 7 étrangères sur les 27 étudiantes en sciences.
En mars 1892, elle déménage dans une chambre meublée de la rue Flatters dans le quartier latin, plus calme et plus proche des installations de la faculté. Elle suit les cours des physiciens Edmond Bouty et Gabriel Lippmann et des mathématiciens Paul Painlevé et Paul Appell.
Un an plus tard, en juillet 1893, elle obtient sa licence en sciences physiques, en étant première de sa promotion. Pendant l'été, une bourse d'études de 600 roubles lui est accordée, qui lui permet de poursuivre ses études à Paris. Un an plus tard, juillet 1894, elle obtient sa licence en sciences mathématiques, en étant seconde. Elle hésite alors à retourner en Pologne.
Elle rejoint début 1894 le laboratoire des recherches physiques de Gabriel Lippmann, au sein duquel la Société d'encouragement pour l'industrie nationale lui a confié des travaux de recherche sur les propriétés magnétiques de différents aciers. Elle y travaillait à l'étroit et dans des conditions spartiates, et recherche donc une façon de mener à bien ses propres travaux. Le professeur Józef Kowalski de l'Université de Fribourg lui fait alors rencontrer lors d'une soirée Pierre Curie, qui est chef des travaux de physique à l'École municipale de physique et de chimie industrielles et étudie également le magnétisme, avec qui elle va finir par accepter de travailler.
Lors de cette collaboration se développe une inclination mutuelle entre les deux scientifiques. Marie Skłodowska rentre à Varsovie, pour se rapprocher des siens, et dans le but d'enseigner et de participer à l'émancipation de la Pologne, mais Pierre Curie lui demande de rentrer à Paris pour vivre avec lui. Le couple se marie à Sceaux, le 26 juillet 1895.
Durant l'année 1895-1896, elle prépare à la faculté le concours d'agrégation pour l'enseignement des jeunes filles section mathématiques, auquel elle est reçue première. Elle ne prend cependant pas de poste d'enseignant, souhaitant préparer une thèse de doctorat. En parallèle, Marie Skłodowska (désormais Curie) suit également les cours de Marcel Brillouin et documente ses premiers travaux de recherche sur les aciers. Le 12 septembre 1897, elle donne naissance à sa première fille, Irène.
Source Wikipédia: Marie Curie
Edwin Powell Hubble 1889-1953
 1889- 1953 .JPG) Edwin Powell Hubble (20 novembre 1889 - 28 septembre 1953) est un astronome américain. Il a permis d'améliorer la compréhension de la nature de l'Univers en démontrant l'existence d'autres galaxies en dehors de notre Voie lactée. En observant un décalage vers le rouge du spectre de plusieurs galaxies, il a montré que celles-ci s'éloignaient les unes des autres à une vitesse proportionnelle à leur distance. Cette relation, connue sous le nom de « loi de Hubble », avait néanmoins été prédite précédemment par Georges Lemaître, un prêtre et astronome belge qui avait publié son travail dans un journal bien moins visible. Cette situation a entraîné une controverse sur la paternité de la loi. Les conditions de la parution en anglais de la version des travaux de Lemaître de 1927 ont été depuis clarifiées. En 2018, l'UAI (Union astronomique internationale) soumet au vote la proposition de changement de nom pour « loi de Hubble-Lemaître ». La loi de Hubble-Lemaître est une des observations clé de l'expansion de l'Univers.
Edwin Powell Hubble (20 novembre 1889 - 28 septembre 1953) est un astronome américain. Il a permis d'améliorer la compréhension de la nature de l'Univers en démontrant l'existence d'autres galaxies en dehors de notre Voie lactée. En observant un décalage vers le rouge du spectre de plusieurs galaxies, il a montré que celles-ci s'éloignaient les unes des autres à une vitesse proportionnelle à leur distance. Cette relation, connue sous le nom de « loi de Hubble », avait néanmoins été prédite précédemment par Georges Lemaître, un prêtre et astronome belge qui avait publié son travail dans un journal bien moins visible. Cette situation a entraîné une controverse sur la paternité de la loi. Les conditions de la parution en anglais de la version des travaux de Lemaître de 1927 ont été depuis clarifiées. En 2018, l'UAI (Union astronomique internationale) soumet au vote la proposition de changement de nom pour « loi de Hubble-Lemaître ». La loi de Hubble-Lemaître est une des observations clé de l'expansion de l'Univers.
Source Wikipédia: Edwin Hubble
Enrico Fermi 1901-1954
 Enrico Fermi (29 septembre 1901 à Rome - 28 novembre 1954 à Chicago) est un physicien italien naturalisé américain. Ses recherches serviront de socle à l'exploitation de l'énergie nucléaire. Il a été excellent, ce qui est rare, à la fois en physique expérimentale et en physique théorique.
Enrico Fermi (29 septembre 1901 à Rome - 28 novembre 1954 à Chicago) est un physicien italien naturalisé américain. Ses recherches serviront de socle à l'exploitation de l'énergie nucléaire. Il a été excellent, ce qui est rare, à la fois en physique expérimentale et en physique théorique.
Il est lauréat du prix Nobel de physique de 1938 « pour sa démonstration de l'existence de nouveaux éléments radioactifs produits par bombardements de neutrons, et pour sa découverte des réactions nucléaires créées par les neutrons lents ». Il est également lauréat de la médaille Hughes en 1942, de la médaille Franklin en 1947 et du prix Rumford en 1953.
Enrico Fermi naît le 29 septembre 1901 à Rome chez Alberto Fermi, inspecteur-chef au ministère des communications, et Ida de Gattis, enseignante d'école élémentaire. Il a une grande sœur, Marie, née en 1899 et un grand frère Giulio, né en 1900. Les deux frères sont envoyés chez une nourrice, dans un milieu rural. Lorsqu'Enrico atteignit l'âge de deux ans et demi, il rejoint sa famille.
Enrico est très proche de son frère Giulio avec qui il partage les mêmes intérêts, ils construisent ensemble des machines électriques et autres objets. En 1915, Giulio meurt au cours d'une opération chirurgicale d'un abcès à la gorge.
Enrico est profondément marqué, son caractère change et cet isolement renforce davantage ses intenses études de la physique et des mathématiques. Sur un marché aux livres, place Campo de' Fiori, il achète Elementorum physicae mathematicae, un traité en latin sur la physique et les mathématiques écrit par le jésuite Andrea Caraffa, et il l'étudie.
L'ingénieur Adolfo Amidei, un ami de son père, prend conscience des qualités hors du commun du jeune Fermi. Il lui prête divers ouvrages concernant la physique et les mathématiques que le jeune Fermi « dévore ». En 1918, Fermi décroche son baccalauréat, maîtrisant la géométrie analytique, la géométrie projective, le calcul infinitésimal, le calcul intégral et la mécanique rationnelle. Amidei demande à ce que Fermi s'implique au sein de l'École normale supérieure de Pise. Après des hésitations , les parents de Fermi acceptent la suggestion d'Amidei. Pour se préparer, Fermi étudie le Traité de Physique d'Orest Chwolson et autres livres.
NDLR : (Allez lire la suite sur Wikipédia, ….c’est trop long pour être écrit ici.
Source Wikipédia: Enrico Fermi
Isaac Newton 1642- 1727
 1642- 1727.jpg) Isaac Newton (25 décembre 1642 J – 20 mars 1727 J, ou 4 janvier 1643 G – 31 mars 1727 G) est un mathématicien, physicien, philosophe, alchimiste, astronome et théologien anglais, puis britannique. Figure emblématique des sciences, il est surtout reconnu pour avoir fondé la mécanique classique, pour sa théorie de la gravitation universelle et la création, en concurrence avec Gottfried Wilhelm Leibniz, du calcul infinitésimal. En optique, il a développé une théorie de la couleur basée sur l'observation selon laquelle un prisme décompose la lumière blanche en un spectre visible. Il a aussi inventé le télescope à réflexion composé d'un miroir primaire concave appelé télescope de Newton.
Isaac Newton (25 décembre 1642 J – 20 mars 1727 J, ou 4 janvier 1643 G – 31 mars 1727 G) est un mathématicien, physicien, philosophe, alchimiste, astronome et théologien anglais, puis britannique. Figure emblématique des sciences, il est surtout reconnu pour avoir fondé la mécanique classique, pour sa théorie de la gravitation universelle et la création, en concurrence avec Gottfried Wilhelm Leibniz, du calcul infinitésimal. En optique, il a développé une théorie de la couleur basée sur l'observation selon laquelle un prisme décompose la lumière blanche en un spectre visible. Il a aussi inventé le télescope à réflexion composé d'un miroir primaire concave appelé télescope de Newton.
En mécanique, il a établi les trois lois universelles du mouvement qui constituent en fait des principes à la base de la grande théorie de Newton concernant le mouvement des corps, théorie que l'on nomme aujourd'hui « mécanique newtonienne » ou encore « mécanique classique ».
Il est aussi connu pour la généralisation du théorème du binôme et l'invention dite de la méthode de Newton permettant de trouver des approximations d'un zéro (ou racine) d'une fonction réelle d'une variable réelle.
Newton a montré que les mouvements des objets sur Terre et des corps célestes sont gouvernés par les mêmes lois naturelles ; en se basant sur les lois de Kepler sur le mouvement des planètes, il développa la loi universelle de la gravitation.
Son ouvrage Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, publié en 1687, est considéré comme une œuvre majeure dans l'histoire des sciences. C'est dans celui-ci qu'il décrit la loi universelle de la gravitation, formule les trois lois universelles du mouvement et jette les bases de la mécanique classique. Il a aussi effectué des recherches dans les domaines de la théologie et de l'alchimie.
Source Wikipédia: Isaac Newton
Johannes Kepler 1571-1630
 Johannes Kepler (ou Keppler), né le 27 décembre 1571 à Weil der Stadt et mort le 15 novembre 1630 à Ratisbonne dans l'électorat de Bavière, est un astronome célèbre pour avoir étudié l’hypothèse héliocentrique de Nicolas Copernic, affirmant que la Terre tourne autour du Soleil et surtout pour avoir découvert que les planètes ne tournent pas autour du Soleil en suivant des trajectoires circulaires parfaites mais des trajectoires elliptiques. « Kepler a découvert les relations mathématiques (dites Lois de Kepler) qui régissent les mouvements des planètes sur leur orbite. Ces relations furent ensuite exploitées par Isaac Newton pour élaborer la théorie de la gravitation universelle. »
Johannes Kepler (ou Keppler), né le 27 décembre 1571 à Weil der Stadt et mort le 15 novembre 1630 à Ratisbonne dans l'électorat de Bavière, est un astronome célèbre pour avoir étudié l’hypothèse héliocentrique de Nicolas Copernic, affirmant que la Terre tourne autour du Soleil et surtout pour avoir découvert que les planètes ne tournent pas autour du Soleil en suivant des trajectoires circulaires parfaites mais des trajectoires elliptiques. « Kepler a découvert les relations mathématiques (dites Lois de Kepler) qui régissent les mouvements des planètes sur leur orbite. Ces relations furent ensuite exploitées par Isaac Newton pour élaborer la théorie de la gravitation universelle. »
Kepler naît au sein d’une famille de religion protestante luthérienne, installée dans la ville de Weil dans le Wurtemberg, ville libre sous l'autorité immédiate de l'Empire. À Weil der Stadt, les Kepler ont joui d'une certaine reconnaissance sociale, son grand-père en a été bourgmestre, mais après avoir été porté aux nues pour avoir combattu sous les ordres de Charles-Quint, il a sombré dans la pauvreté. Toute la famille s'entasse sous le même toit dans la maison des grands-parents, Sebald Kepler et Katharina Müller.
Né prématurément à sept mois et hypocondriaque de nature chétive, Johannes Kepler souffre toute sa vie d’une santé fragile. À l’âge de trois ans, il contracte la variole, ce qui, entre autres séquelles, affaiblit sévèrement sa vue. La famille Kepler est peu ordinaire et son ambiance n’est pas des plus saines. Le père, Heinrich Kepler, est mercenaire dans l’armée du duc de Wurtemberg, et toujours en campagne, étant ainsi rarement présent à son domicile. La mère, Katharina Guldenmann, analphabète, dure et tracassière — que Kepler qualifie lui-même de « petite, maigre, sinistre et querelleuse » —avait été élevée par une tante qui finit sur le bûcher pour sorcellerie. Kepler a trois cadets : sa sœur, Margarette, dont il reste proche, Christopher, qui lui fut toujours antipathique, et Heinrich. La mère de Kepler préfère nettement ses autres enfants, car Johannes est malingre, souvent malade, myope et souffre de polyopie
De 1574 à 1576, il vit avec son petit frère Heinrich — épileptique — chez ses grands-parents maternels, alors que son père est en campagne en Flandre et que sa mère est partie à sa recherche. Le grand-père, Sebald Kepler, l'oblige à travailler, le bat et le persécute.
Au retour de ses parents, Kepler déménage à Leonberg, ville du duché de Wurtemberg, et va suivre les cours de l’école latine de 1577 à 1579 et de 1581 à 1583. Ses parents lui font découvrir l’astronomie. Ainsi, en 1577, sa mère l’emmène en haut d’une colline pour observer le passage d’une comète. De son côté, son père lui montre l’éclipse de Lune du 31 janvier 1580, et comment cette dernière devint toute rouge. Kepler étudiera plus tard ce phénomène et l’expliquera dans l’un de ses ouvrages sur l’optique.
La famille de Johannes Kepler décide qu'il sera ecclésiastique, ce qui n'est pas pour lui déplaire. D'une part, sa force physique est insuffisante pour les travaux agricoles et, de l'autre, il entrevoit sans doute là l'occasion de s'éloigner de sa turbulente famille. Il est profondément croyant et le restera toute sa vie. Ses études de pasteur s'enchaînent sans heurt : en 1584, il entre au Séminaire protestant d’Adelberg, puis, deux années après, au Séminaire supérieur de Maulbronn où il obtient son diplôme de fin d’études et entre, en 1589, à l’université de Tübingen, au séminaire évangélique Tübinger Stift. Là, il étudie d’abord l’éthique, la dialectique, la rhétorique, le grec, l’hébreu, l’astronomie et la physique, puis, pendant trois ans, la théologie et les sciences humaines. Il y poursuit ses études après obtention d’une maîtrise en 1591. Il suit en même temps les cours d'astronomie de Michael Maestlin qui, obligé d'enseigner le système géocentrique de Ptolémée, est un fervent admirateur du nouveau système héliocentrique de Copernic ; Maestlin fait donc de Képler un Copernicien enthousiaste, et est de ceux qui convainquent Galilée d'adopter l'Héliocentrisme.
NDLR : Allez lire la suite sur Wikipédia, c’est trop long pour être écrit ici.
Source Wikipédia: Johannes Kepler
Benz Bertha 1849-1944
Superbe vidéo sur Bertha Benz : Cliquez ici. (Bertha Benz: The Journey That Changed Everything)
 Bertha Benz, née Ringer le 3 mai 1849 à Pforzheim et morte le 5 mai 1944 à Ladenburg, est une inventrice allemande, pionnière de l'automobile. Elle est la femme et l'associée de l'inventeur automobile Carl Benz. En 1888, elle devient la première en Allemagne à conduire une automobile sur une longue distance. Ce faisant, elle attire sur Benz Patent Motorwagen une attention considérable et amène à la société ses premières ventes. Elle est également l'inventrice des plaquettes de frein.
Bertha Benz, née Ringer le 3 mai 1849 à Pforzheim et morte le 5 mai 1944 à Ladenburg, est une inventrice allemande, pionnière de l'automobile. Elle est la femme et l'associée de l'inventeur automobile Carl Benz. En 1888, elle devient la première en Allemagne à conduire une automobile sur une longue distance. Ce faisant, elle attire sur Benz Patent Motorwagen une attention considérable et amène à la société ses premières ventes. Elle est également l'inventrice des plaquettes de frein.
Bertha Ringer naît en 1849 à Pforzheim en Allemagne. En 1871, elle investit dans l'atelier de son fiancé, Carl Benz, ce qui permet à ce dernier de développer sa première automobile brevetée. Elle peut le faire car à l'époque, ils ne sont pas mariés. Par la suite, comme le stipule la loi, Bertha perd le pouvoir juridique d'agir.
Le 20 juillet 1872, Bertha Ringer épouse Carl Benz. Ils ont cinq enfants : Eugen (1873), Richard (1874), Clara (1877), Thilde (1882), et Ellen (1890).
Le 5 août 1888, sans le dire à son mari et sans la permission des autorités, Bertha Benz s'en va avec ses fils Richard et Eugen, qui ont treize et quinze ans, au volant de l'une des toutes nouvelles Patent Motorwagen. Elle conduit de Mannheim à Pforzheim et devient ainsi la première personne à conduire une automobile sur route dans le but de voyager. Auparavant, la conduite motorisée s'était limitée à de très courts essais lors desquels il s'agissait de revenir au point de départ avec des mécaniciens. Cette excursion de pionnière s'étale environ sur 106 kilomètres.
Bien que le motif premier de ce voyage soit de rendre visite à sa mère, Bertha Benz à d'autres idées en tête : prouver à son mari, qui n'a pas suffisamment pris en compte les implications mercatiques de son invention, que l'automobile dans laquelle ils ont tous les deux énormément investi doit devenir un succès commercial une fois que le public aura compris son utilité. Elle veut également que Carl comprenne que sa création a un avenir.
Sur le chemin, elle résout de nombreux problèmes. Elle doit trouver du ligroine qui sert de carburant et que l'on ne trouve que chez l'apothicaire. Elle s'arrête donc à Wiesloch et va à la pharmacie. Un forgeron l'aide à réparer une chaîne. Les freins doivent également être réparés et, s'occupant de ce problème, elle invente les plaquettes de frein. Elle doit par ailleurs utiliser une longue épingle à chapeau pour nettoyer les tuyaux à carburant, qui sont obstrués, et isole un câble avec une jarretière. Elle quitte Mannheim à l'aube et atteint Pforzheim à la tombée du soleil. Elle informe son mari de son succès par télégramme. Elle reprend le volant le lendemain pour rentrer chez elle.
En 1944, lors de son 95e anniversaire, Bertha Benz est faite Honorable Sénatrice par l'Institut de technologie de Karlsruhe, l'alma mater de son mari. Plus tôt, Carl est d'ailleurs nommé docteur honoris causa. Deux jours plus tard, Bertha Benz décède dans sa villa de Ladenburg, là où l'atelier de son mari est construit après leur emménagement en 1906. Il y établit son affaire familiale, Benz & Fils.
En 2008, la Bertha Benz Memorial Route est officiellement approuvée en tant qu'héritage industriel de l'humanité car elle suit le chemin emprunté par Bertha Benz en 1888.
Le 25 janvier 2011, Deutsche Welle diffuse un documentaire sur l'invention de l'automobile par Carl Benz et met en avant le rôle très important de sa femme.
Le documentaire La Voiture est née, produit par Ulli Kampelmann se focalise sur le premier voyage de Bertha Benz.
Source Wikipédia: Bertha Benz
Benz Karl Friedrich Michael 1844-1929
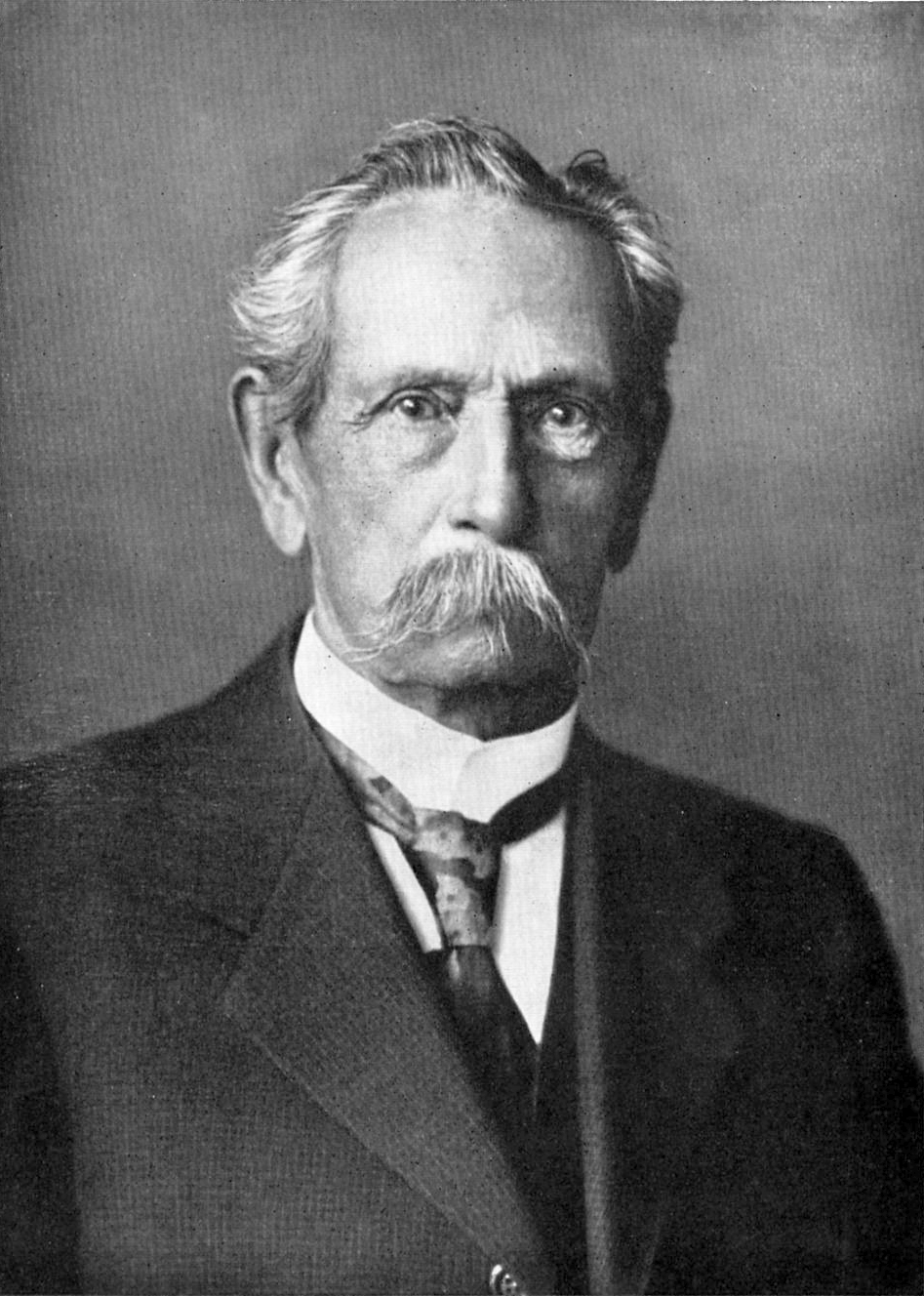 Carl Benz (Karl Friedrich Michael Benz), né le 25 novembre 1844 à Mühlburg, quartier de Karlsruhe et mort le 4 avril 1929 à Ladenburg, est un inventeur allemand, pionnier de l'automobile, et fondateur de Benz & Cie qui devint Mercedes-Benz en 1926, après la fusion avec Daimler-Motoren-Gesellschaft.
Carl Benz (Karl Friedrich Michael Benz), né le 25 novembre 1844 à Mühlburg, quartier de Karlsruhe et mort le 4 avril 1929 à Ladenburg, est un inventeur allemand, pionnier de l'automobile, et fondateur de Benz & Cie qui devint Mercedes-Benz en 1926, après la fusion avec Daimler-Motoren-Gesellschaft.
Carl Benz est né le 25 novembre 1844 à Mühlburg (aujourd'hui un quartier de Karlsruhe), comme un enfant illégitime. Dans le livre de l'église de la communauté protestante de Mühlburg, son nom était Karl Friedrich Michael Vailand. Sa mère était catholique, son père protestant. Johann Georg Benz est venu de Pfaffenrot (municipalité d'aujourd'hui Marxzell). Il a travaillé au Großherzoglich Badische Staatseisenbahnen (en français : « Chemin de fer d'Etat du Grand-duché de Bade »).
Environ un an plus tard, le 16 novembre 1845, ses parents se marient dans l'église de la ville catholique St. Stephan. témoin était à nouveau Michael Kramer. L'enfant est renommé en Karl Friedrich Michael Benz. Carl Benz préfère l'orthographe Carl et publie ses Lebenserinnungen (en français : « mémoires ») sous le nom de Carl Friedrich Benz. Après le mariage de ses parents, ils ont déménagé avec son enfant à Karlsruhe. En 1846, alors que Carl Benz n'avait que seulement deux ans, son père meurt de pneumonie.
Carl Benz étudie le génie mécanique à l'université de Karlsruhe.
Après son lycée et ses études techniques, son amour pour les locomotives l'a conduit à une usine de locomotives - l'entreprise de génie mécanique de Karlsruhe pendant deux ans et demi.
Puis Il a intégré à Mannheim le bureau technique de Johann Schweizer. Il a construit des grues, des wagons, des centrifugeuses, etc.
Afin d'acquérir de l'expérience dans la construction de ponts, il a également rejoint les frères Benckiser à Pforzheim.
En 1871, il fonde sa première société, de fournitures de matériaux de jardinage, et se marie l'année suivante avec Bertha Ringer avec laquelle il aura cinq enfants.
En 1885, Benz développe le Téo (ou « Tricycle Teo ») en installant un monocylindre refroidi par eau, d'un litre de cylindrée et de cinq cent soixante watts, avec allumage électrique, soupape d'admission commandée, boîte de vitesses et différentiel, sur un tricycle dont il fait juste faire le tour du pâté de sa maison. De 1885 à 1887, il crée trois versions du tricycle : le modèle 1, donné en cadeau au musée allemand en 1906, le modèle 2, qui a vraisemblablement été transformé à plusieurs reprises et le modèle 3 avec roues à rayons en bois. Le 29 janvier 1886, il dépose le brevet DRP-37435.
Le 5 août 1888, son épouse Bertha lassée de l'attitude frileuse de son mari qui ne veut pas présenter ses inventions et a largement hypothéqué sa dot, part à son insu au petit matin avec le prototype du Benz Patent Motorwagen (modèle 3) pour parcourir le premier trajet sur longue distance en automobile, soit les 104 kilomètres qui séparent Mannheim de Pforzheim. Cette équipée (nécessité de changer les piles de recharge, difficulté d'approvisionnement de benzine chez les pharmaciens, eau pour refroidir les moteurs, voyage retracé dans la Bertha Benz Memorial Route) avec ses deux fils Richard et Eugen, à la vitesse remarquable pour l'époque, de 15 km/h incitera Carl à apporter divers perfectionnements au véhicule, en lui adjoignant notamment une vitesse supplémentaire pour gravir plus commodément les côtes.
En 1890 il s'associe avec Friedrich von Fischer, qui se charge de l'administration interne, et avec Julius Ganss, responsable des ventes. Carl Benz, lui, se consacre au développement de la partie technique de l'affaire qui progresse sensiblement.
NDLR : Allez lire la suite sur Wikipédia, c’est trop long pour être écrit ici.
Source Wikipédia: Carl Benz
Dmitri Mendeleïev 1834-1907
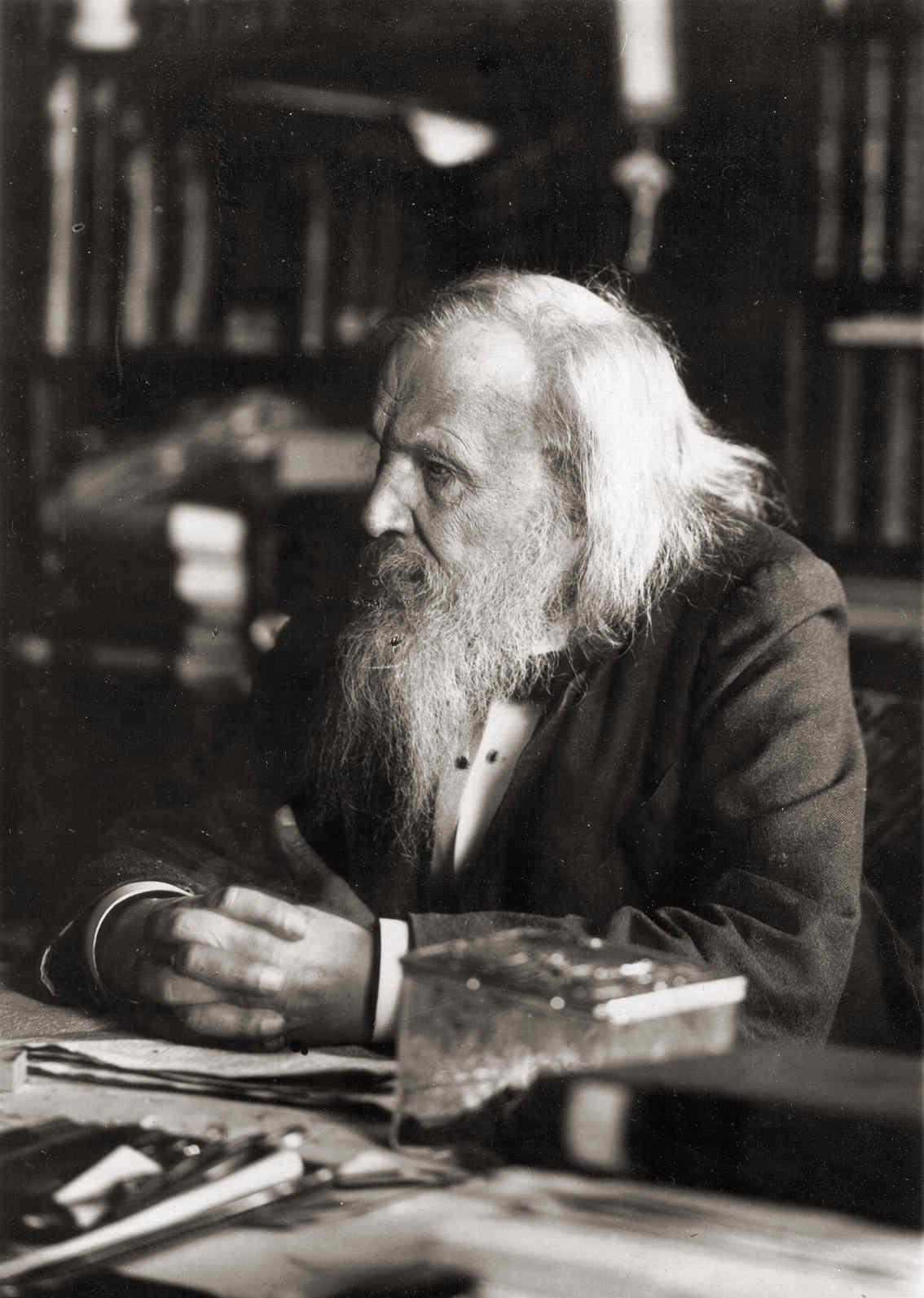 Dmitri Ivanovitch Mendeleïev (parfois écrit Dimitri, en russe d'époque Дмитрій Ивановичъ Менделѣевъ ; en russe moderne Дмитрий Иванович Менделеев, né le 27 janvier 1834 (8 février 1834 dans le calendrier grégorien) à Tobolsk et mort le 20 janvier 1907 (2 février 1907 dans le calendrier grégorien) à Saint-Pétersbourg, est un chimiste russe.
Dmitri Ivanovitch Mendeleïev (parfois écrit Dimitri, en russe d'époque Дмитрій Ивановичъ Менделѣевъ ; en russe moderne Дмитрий Иванович Менделеев, né le 27 janvier 1834 (8 février 1834 dans le calendrier grégorien) à Tobolsk et mort le 20 janvier 1907 (2 février 1907 dans le calendrier grégorien) à Saint-Pétersbourg, est un chimiste russe.
Il est principalement connu pour son travail sur la classification périodique des éléments, publiée en 1869 et également appelée « tableau de Mendeleïev ». Il déclara que les éléments chimiques pouvaient être arrangés selon un modèle qui permettait de prévoir les propriétés des éléments encore non découverts.
Mendeleïev est né à Tobolsk, en Sibérie, en Russie. Il était le cadet des nombreux enfants d'Ivan Pavlovitch Mendeleïev et de son épouse, née Maria Dimitrievna Kornilieva (le douzième selon Michael Gordin, historien des sciences). Il entre à l'âge de quinze ans au lycée de Tobolsk, après la mort de son père. En 1849, la famille devenue pauvre s'installe à Saint-Pétersbourg et Dmitri entre à l'université en 1850. Après avoir reçu son diplôme, il contracte la tuberculose ce qui l'oblige à se déplacer dans la péninsule criméenne près de la mer Noire en 1855, où il devient responsable des sciences du lycée local. Il revient complètement guéri à Saint-Pétersbourg en 1856. C'est dans cette ville qu'il étudie la chimie et est diplômé en 1856. À 25 ans, il vient travailler à Heidelberg avec des savants comme Robert Bunsen et Gustav Kirchhoff.
Entre 1859 et 1861, il travaille sur la densité des gaz à Paris, et au fonctionnement du spectroscope avec Gustav Kirchhoff à Heidelberg.
En 1863, après son retour en Russie, il devient professeur de chimie à l'institut technologique et à l'université de Saint-Pétersbourg. Il épouse cette même année Feozva (dite Fiza) Nikititchna Lechtcheva (1828-1905) (Феозва Никитична Лещева) à l'église de l'Université technique du génie militaire (où il enseignait). Ce mariage se solde par un divorce en 1882, environ un mois après son second mariage à Anna Ivanovna Popova (1860-1942) (Анна Ивановна Попова).
En 1864, il soutient sa thèse de doctorat intitulée Considérations sur la combinaison de l'alcool et de l'eau. En 1867, il est nommé professeur de chimie minérale à l'université de Saint-Pétersbourg.
Source Wikipédia: Dmitri Mendeleïev
Henri Poincaré 1854-1912
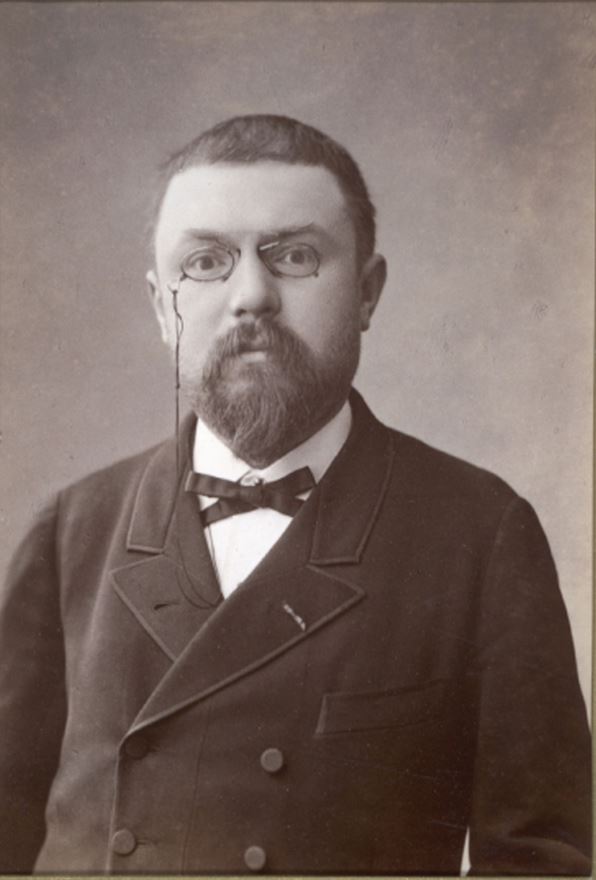 Henri Poincaré est un mathématicien, physicien théoricien et philosophe des sciences français, né le 29 avril 1854 à Nancy et mort le 17 juillet 1912 à Paris.
Henri Poincaré est un mathématicien, physicien théoricien et philosophe des sciences français, né le 29 avril 1854 à Nancy et mort le 17 juillet 1912 à Paris.
Poincaré a réalisé des travaux d'importance majeure en optique et en calcul infinitésimal. Ses avancées sur le problème des trois corps en font un fondateur de l'étude qualitative des systèmes d'équations différentielles et de la théorie du chaos ; il est aussi un précurseur majeur de la théorie de la relativité restreinte et de la théorie des systèmes dynamiques.
Il est considéré comme un des derniers grands savants universels, maîtrisant l'ensemble des branches des mathématiques de son époque et certaines branches de la physique.
Henri Poincaré est le fils d'Émile Léon Poincaré, doyen de la faculté de médecine de Nancy, et de son épouse Marie Pierrette Eugénie Launois. Il est le neveu d'Antoni Poincaré, ce qui en fait le cousin germain des fils de ce dernier : l'homme politique et président de la République française Raymond Poincaré et Lucien Poincaré, directeur de l'Enseignement secondaire au ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. La sœur d’Henri, Aline Poincaré, a épousé le philosophe Émile Boutroux.
À cinq ans, il contracte la diphtérie, le laissant paralysé durant cinq mois, ce qui l'incite à se plonger dans la lecture. Élève d'exception au lycée impérial de Nancy, il obtient le 5 août 1871, le baccalauréat ès lettres, mention « Bien », et le 7 novembre 1871 son baccalauréat ès sciences, où il faillit être refusé à cause d'un zéro en composition de mathématiques. Il semblerait qu’il soit arrivé en retard et ait mal compris le sujet, un problème sur les séries convergentes, domaine dans lequel il apportera des contributions importantes. Mais il se rattrape brillamment à l'oral et est finalement admis avec une mention « Assez Bien ».
Poincaré se relève de ce mauvais pas en classes préparatoires, où il remporte deux fois consécutivement le concours général de mathématiques. Malgré son inaptitude sportive et artistique et une épreuve de géométrie descriptive qu'il aurait ratée, il se classe premier au concours d'entrée à l'École polytechnique le 2 novembre 1873. Son rang lui vaut un grade de sergent-major. À ce titre, il est « missaire » et président de la commission des Cotes. Il sort deuxième de l'École Polytechnique en 1875 et, le 19 octobre de la même année, il entre comme élève-ingénieur à l'École des mines de Paris, étant membre du Corps des mines ; il est licencié ès sciences le 2 août 1876. Il sort de l'École des mines le 11 mars 1879, classé 3e sur les trois élèves du Corps des mines. Nommé ingénieur des mines de 3e classe le 28 mars à Vesoul, il obtient, le 1er août, le doctorat ès sciences mathématiques à la faculté des sciences de Paris, et devient chargé de cours d'analyse à la faculté des sciences de Caen le 1er décembre 1879.
NDLR : Allez lire la suite sur Wikipédia, c’est trop long pour être écrit ici.
Source Wikipédia: Henri Poincaré
Max Planck 1858-1947
 Max Planck, né Max Karl Ernst Ludwig Planck le 23 avril 1858 à Kiel, dans le duché de Schleswig et mort le 4 octobre 1947 à Göttingen, en Allemagne (pendant l'occupation alliée), est un physicien allemand.
Max Planck, né Max Karl Ernst Ludwig Planck le 23 avril 1858 à Kiel, dans le duché de Schleswig et mort le 4 octobre 1947 à Göttingen, en Allemagne (pendant l'occupation alliée), est un physicien allemand.
Max Planck fut l'un des fondateurs de la mécanique quantique. De ses travaux fut conceptualisée l'ère de Planck, période de l'histoire de l'Univers au cours de laquelle les quatre interactions fondamentales étaient unifiées.
Il fut lauréat du prix Nobel de physique de 1918 pour ses travaux en théorie des quanta. Il a reçu la médaille Lorentz en 1927, et le prix Goethe en 1945.
Max Planck naît le 23 avril 1858 au no 17 de la Küterstraße (« rue des Bouchers ») à Kiel, dans le duché de Schleswig. Il est issu d’une famille nombreuse et bourgeoise. Ses arrière-grand-père et grand-père paternels sont professeurs de théologie, son père professeur de droit (il participa à la rédaction du code civil allemand), tandis que sa mère est issue d'une famille de pasteurs.
Max Planck fait ses études secondaires à Munich où son père enseigne.
Il hésite alors entre se consacrer à la science ou à la musique. En 1874, il entame des études de mathématiques et de physique à l’université. Il obtient son baccalauréat à dix-sept ans et, trois ans plus tard, il conclut son cursus universitaire à Berlin avec Hermann von Helmholtz et Gustav Kirchhoff comme professeurs.
En 1878, il soutient sa thèse de doctorat sur « le second principe de la thermodynamique » et la notion d'entropie. Ses professeurs ne sont guère convaincus. Il passe néanmoins son habilitation en 1881 sur « les états d'équilibre des corps isotropes aux différentes températures », aboutissant aux mêmes résultats que ceux obtenus auparavant par l'Américain Josiah Willard Gibbs, dont les travaux étaient restés confidentiels.
Jusqu'en 1885, il recherche un poste d'enseignant en physique théorique, discipline peu à la mode à l'époque. Il obtient enfin un poste de professeur adjoint à l'université de Kiel en 1885.
À la mort de Gustav Kirchhoff, et sur recommandation de Helmholtz, il est appelé à l’université Humboldt de Berlin comme professeur adjoint puis titulaire en 1892. Un poste qu'il garde environ quarante ans.
À Berlin, il poursuit des travaux en thermodynamique, en électromagnétisme et en physique statistique.
Planck rejette, dans un premier temps, le modèle atomiste des gaz de Maxwell et Boltzmann. Pour lui, la théorie atomique s’effondrera à terme en faveur de l’hypothèse de la matière continue. Il se rallie devant l'évidence à l'atomisme à partir des années 1890.
À cette même époque, Lord Kelvin identifie le rayonnement du corps noir comme l'un des problèmes à résoudre. Jožef Stefan, Ludwig Boltzmann, Wilhelm Wien s'y attaquent ainsi que Otto Lummer, Ernst Pringsheim, Heinrich Rubens, Ferdinand Kurlbaum (de), Friedrich Paschen et Lord Rayleigh.
Travaillant à formuler avec exactitude le second principe de la thermodynamique, Planck s’intéresse dès 1894 au rayonnement électromagnétique du corps noir. Il adopte les méthodes statistiques de Boltzmann.
En octobre 1900, il détermine la loi de répartition spectrale du rayonnement thermique du corps noir en introduisant la constante de Planck, sans en maîtriser l'interprétation physique.
C’est à la fin de 1900 qu’il présente sa découverte à la société de physique de Berlin. C’est la naissance de la théorie des quanta, qu'il ne contribue pas beaucoup à approfondir, laissant Albert Einstein l'étayer solidement. Planck a du mal à accepter sa propre hypothèse, rendant la matière « discontinue ».
Planck devient, par la suite, l'un des premiers soutiens d'Einstein, bien que ce dernier fût très critique vis-à-vis des théories de Planck avant de reconnaître ses positions novatrices.
Avec Walther Nernst, Planck organise en novembre 1911 à Bruxelles le premier congrès Solvay qui réunit les sommités de la physique de cette époque. Vers la même époque, il s'oppose au positivisme logique d'Ernst Mach.
Il prend sa retraite universitaire en 1927 mais continue à enseigner par la suite. Il reçoit, cette année-là, la médaille Lorentz, prix décerné par l'Académie royale des arts et des sciences néerlandaise.
Source Wikipédia: Max Planck
Christian Andreas Doppler 1803 - 1853
 Après avoir étudié à l'université de Vienne, Doppler devient assistant-professeur dans cet établissement en 1829.
Après avoir étudié à l'université de Vienne, Doppler devient assistant-professeur dans cet établissement en 1829.
Ce poste n'étant pas renouvelé, il envisage un temps une émigration vers les États-Unis.
Il renonce à quitter son pays après avoir été nommé à Prague en 1837, puis à l'École polytechnique de Vienne en 1849. En 1850, il fonde l'Institut de physique de l'université de Vienne dont il est seul professeur et le premier directeur.
Atteint d'une tuberculose, il quitte ses fonctions en 1852. Son travail scientifique est varié : optique, astronomie, électricité…
Sa publication la plus célèbre a été présentée le 25 mai 1842 à l'Académie royale des sciences de Bohème et a pour titre Sur la lumière colorée des étoiles doubles et d'autres étoiles du ciel, utilisant l'effet Doppler.
Ses calculs étaient erronés, le décalage réel de la fréquence lumineuse étant trop faible pour pouvoir être détecté à l'époque.
En 1846, Doppler publie une correction de son travail initial où il tient compte des vitesses relatives de la source de lumière et de l'observateur.
NDLR : La suite sur Wikipédia, la documentation sur lui n'est pas énorme sur wikipédia.
Source Wikipédia: Christian Doppler
Antoine Lavoisier 1743-1794
 Antoine Laurent Lavoisier, ci-devant de Lavoisier, né le 26 août 1743 à Paris et guillotiné le 8 mai 1794 à Paris, est un chimiste, philosophe et économiste français, souvent présenté comme le père de la chimie moderne, qui se développera à partir des bases et des notions qu'il a établies et d'une nouvelle exigence de précision offerte par les instruments qu'il a mis au point. Il a inauguré la méthode scientifique, à la fois expérimentale et mathématique, dans ce domaine qui, au contraire de la mécanique, semblait devoir y échapper.
Antoine Laurent Lavoisier, ci-devant de Lavoisier, né le 26 août 1743 à Paris et guillotiné le 8 mai 1794 à Paris, est un chimiste, philosophe et économiste français, souvent présenté comme le père de la chimie moderne, qui se développera à partir des bases et des notions qu'il a établies et d'une nouvelle exigence de précision offerte par les instruments qu'il a mis au point. Il a inauguré la méthode scientifique, à la fois expérimentale et mathématique, dans ce domaine qui, au contraire de la mécanique, semblait devoir y échapper.
Au-delà des découvertes de l'oxydation, des composants de l'air et de l'eau, de l'état de la matière, ses contributions à la révolution chimique sont à la fois techniques, expérimentales et épistémologiques. Elles résultent d'un effort conscient d'adapter toutes les expériences dans le cadre d'une théorie simple dans laquelle, pour la première fois, la notion moderne d'élément est présentée de façon systématique. Lavoisier a établi l'utilisation cohérente de l'équilibre chimique, utilisé ses recherches sur l'oxygène, dont il a inventé le nom, l'azote et l'hydrogène pour renverser la théorie phlogistique, développé une nouvelle nomenclature chimique qui soutient, ce qui se révélera inexact, que l'oxygène est un constituant essentiel de tous les acides.
Précurseur de la stœchiométrie, il a surtout traduit des réactions dans les équations chimiques qui respectent la loi de conservation de la matière, donnant à celle-ci une solide assise expérimentale.
Financier de son métier, soucieux d'établir des statistiques précises utiles à ce qu'il nomme à la suite de Condorcet l'arithmétique politique, il a été sollicité par l'administration royale puis révolutionnaire sur de très nombreux sujets depuis l'instruction publique jusqu'à l'hygiène en passant par le système monétaire.
Il a aussi produit dans la lancée de Joseph Black la première théorie expérimentale de la chaleur, à travers l'étude non seulement de la combustion mais aussi de la respiration et de la fermentation des sols. Ses œuvres majeures restent le Traité élémentaire de chimie (1789) et la Méthode de nomenclature chimique (1787).
Source Wikipédia: Antoine_Lavoisier
Ivan Pavlov 1849-1936
 Ivan Petrovitch Pavlov (en russe : Иван Петрович Павлов), né le 14 septembre 1849 (26 septembre 1849 dans le calendrier grégorien) à Riazan, dans l'Empire russe, et mort le 27 février 1936 à Léningrad, en URSS, est un médecin et un physiologiste russe, lauréat du prix Nobel de physiologie ou médecine de 1904, et de la médaille Copley en 1915.
Ivan Petrovitch Pavlov (en russe : Иван Петрович Павлов), né le 14 septembre 1849 (26 septembre 1849 dans le calendrier grégorien) à Riazan, dans l'Empire russe, et mort le 27 février 1936 à Léningrad, en URSS, est un médecin et un physiologiste russe, lauréat du prix Nobel de physiologie ou médecine de 1904, et de la médaille Copley en 1915.
Né dans une famille russe où l'on est pope de père en fils, il est d'abord, dès 11 ans, élève au séminaire de Riazan. Il se passionne déjà pour les sciences naturelles et la lecture d'un petit livre du professeur Ivan Setchenov, Réflexes de l'encéphale, et de la traduction russe du travail de George Henry Lewes, Physiologie de la vie commune, le fit s'inscrire à la Faculté de physique et de mathématiques de Saint-Pétersbourg après un bref passage en Faculté de Droit ; il se spécialise alors en physiologie animale qu'il étudie à l'Académie de chirurgie et de médecine. Des intrigues écartent alors Ivan Setchenov, envoyé en disgrâce à Odessa, mais il bénéficie des cours d'un autre grand maître, son successeur Élie de Cyon, qui fait de lui un virtuose de la technique. Il obtient son diplôme en 1879 et soutient sa thèse de doctorat en 1883.
En 1890, il est nommé titulaire de la chaire de pharmacologie de l'Académie de médecine militaire de Saint-Pétersbourg. Il devient professeur de physiologie puis directeur de l'Institut de médecine expérimentale de Saint-Pétersbourg (puis Léningrad) en 1895 jusqu'à sa mort en 1936.
Pavlov est un expérimentateur habile et méthodique jusque dans ses heures de travail et ses habitudes. C'est ainsi qu'il déjeune à 12 heures exactement, il se couche chaque soir à la même heure, il nourrit toujours ses chiens aux mêmes horaires chaque soir et chaque année il ne manque pas de quitter Saint-Pétersbourg pour l'Estonie où il passe ses vacances aux mêmes dates. Cette conduite change quand son fils Victor est tué au service de l'Armée Blanche ; après ce drame il est notamment victime d'insomnies.
Au cours des années 1890, Pavlov réalisa une expérience sur la fonction gastrique du chien en recueillant grâce à une fistule les sécrétions d'une glande salivaire pour mesurer et analyser la salive produite dans différentes conditions en réponse aux aliments. Ayant remarqué que les chiens avaient tendance à saliver avant d'entrer réellement en contact avec les aliments, il décida d'étudier plus en détail cette « sécrétion psychique ». Il s'avéra que ce phénomène était plus intéressant que la simple chimie de la salive, et ceci le conduisit à modifier ses objectifs : dans une longue série d'expériences, il variait les stimuli survenant avant la présentation des aliments.
C'est ainsi qu'il découvrit les lois fondamentales de l'acquisition et la perte des « réflexes conditionnels » — c'est-à-dire, les réponses réflexes, comme la salivation, qui ne se produisaient que de façon conditionnelle dans des conditions expérimentales spécifiques chez l'animal. Ces expériences, réalisées au cours des années 1890 et 1900, ne furent connues des scientifiques occidentaux que par des traductions isolées et ce n'est qu'en 1927 qu'elles furent toutes traduites en anglais.
En 1904, il est lauréat du prix Nobel de physiologie ou médecine « en reconnaissance de son travail sur la physiologie de la digestion, ce qui a permis de transformer et d'élargir le savoir sur les aspects essentiels du sujet ». Il fut le premier Russe à recevoir le prix Nobel et à exposer en russe ses travaux. L'usage d'une langue peu connue provoqua un fameux contresens ; c'est ainsi qu'on parle encore de « réflexes conditionnés » alors que « réflexes conditionnels » serait plus exact.
Source Wikipédia: Ivan Pavlov
Kip Stephen Thorne 1940 -
 .jpg) Kip Stephen Thorne, né le 1er juin 1940 à Logan (Utah), est un physicien théoricien américain, connu pour ses contributions prolifiques dans le domaine de la gravitation, de la physique et de l'astrophysique.
Kip Stephen Thorne, né le 1er juin 1940 à Logan (Utah), est un physicien théoricien américain, connu pour ses contributions prolifiques dans le domaine de la gravitation, de la physique et de l'astrophysique.
Ses travaux dans le domaine des ondes gravitationnelles lui valent le Prix Nobel de physique en 2017, qu'il partage avec Rainer Weiss et Barry C. Barish. Il est un expert dans le domaine des implications astrophysiques de la théorie de la relativité d'Einstein. Il a été consultant pour le film Interstellar.
Il a occupé la chaire de physique théorique Professeur Feynman à l'université de Caltech jusqu'en 2009.
Thorne est né à Logan dans l'Utah. Il a obtenu son Bachelor of Science à Caltech en 1962, et son doctorat à l'université de Princeton en 1965 sous la direction de John A. Wheeler. Thorne retourna ensuite à Caltech en tant que professeur associé en 1967 et devint professeur en physique théorique en 1970. Il occupa la chaire Professeur William R. Kenan, Jr. en 1981 puis la chaire de physique théorique Professeur Feynman en 1991. Au fil des ans, Thorne a servi de mentor et de directeur de thèse pour de nombreux théoriciens qui travaillent à présent sur divers aspects de la relativité générale.
Les principaux domaines de recherche du professeur Kip S. Thorne sont la théorie de la relativité générale d'Einstein et l'astrophysique. Les contributions scientifiques de Thorne, qui se concentrent sur la nature générale de l'espace, du temps, et de la gravité, couvrent tous les sujets de la relativité générale, incluant la confrontation aux théories de la gravité rivales, les applications de la relativité aux structures stellaires et à leur évolution (par exemple, ses études des structures et de l'évolution des étoiles massives qui ont un trou noir ou une étoile à neutrons comme stade final), les trous noirs, les trous de ver, les gravitons, et les ondes gravitationnelles. Il est peut-être plus connu pour sa théorie controversée selon laquelle les trous de ver pourraient être utilisés pour voyager dans le temps.
Thorne est la première personne à mener des recherches scientifiques dans le but de savoir si les lois de la physique permettent à l'espace et au temps d'être multiplement connectés (les vortex traversables et les machines à remonter le temps peuvent-elles exister?). Thorne a également étudié des sujets tels que l'origine statistique de l'entropie d'un trou noir, et l'entropie du fond cosmologique selon un modèle inflationnel de l'Univers.
Parmi une poignée de physiciens, le professeur Thorne est considéré comme l'une des références mondiales en matière d'ondes gravitationnelles. Son travail portait en partie sur la prédiction de la force de ces ondes et de leurs signatures temporelles observées depuis la Terre. Ces «signatures» sont d'une grande utilité pour LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory), une expérience multi-institutionnelle sur les ondes gravitationnelles dont Thorne a été l'un des principaux partisans - en 1984, il a cofondé le projet LIGO (le plus gros projet jamais financé par la NSF) pour discerner et mesurer des fluctuations entre plusieurs points «statiques» ; de telles fluctuations seraient une preuve de l'existence des ondes gravitationnelles, telles que les calculs les décrivent. Plus important, il a établi les bases d'une théorie des pulsations des étoiles relativistes et de la radiation gravitationnelle qu'elles émettent.
Source Wikipédia: Kip Thorne
Leonhard Euler 1707-1783
 Leonhard Euler, né le 15 avril 1707 à Bâle (Suisse) et mort à 76 ans le 7 septembre 1783 (18 septembre 1783 dans le calendrier grégorien) à Saint-Pétersbourg (Empire russe), est un mathématicien et physicien suisse, qui passa la plus grande partie de sa vie dans l'Empire russe et en Allemagne. Il était notamment membre de l'Académie royale des sciences de Prusse à Berlin.
Leonhard Euler, né le 15 avril 1707 à Bâle (Suisse) et mort à 76 ans le 7 septembre 1783 (18 septembre 1783 dans le calendrier grégorien) à Saint-Pétersbourg (Empire russe), est un mathématicien et physicien suisse, qui passa la plus grande partie de sa vie dans l'Empire russe et en Allemagne. Il était notamment membre de l'Académie royale des sciences de Prusse à Berlin.
Euler fit d'importantes découvertes dans des domaines aussi variés que le calcul infinitésimal et la théorie des graphes. Il introduisit également une grande partie de la terminologie et de la notation des mathématiques modernes, en particulier pour l'analyse mathématique, comme la notion de fonction mathématique. Il est aussi connu pour ses travaux en mécanique, en dynamique des fluides, en optique et en astronomie.
Euler est considéré comme un éminent mathématicien du XVIIIe siècle et l'un des plus grands et des plus prolifiques de tous les temps. Une déclaration attribuée à Pierre-Simon de Laplace exprime l'influence d'Euler sur les mathématiques : « Lisez Euler, lisez Euler, c'est notre maître à tous ». Il était un fervent chrétien, croyant en l'inerrance biblique, et s'opposa avec force aux athées éminents de son temps.
NDLR : la suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Leonhard Euler
Nicolas Copernic 1473-1543
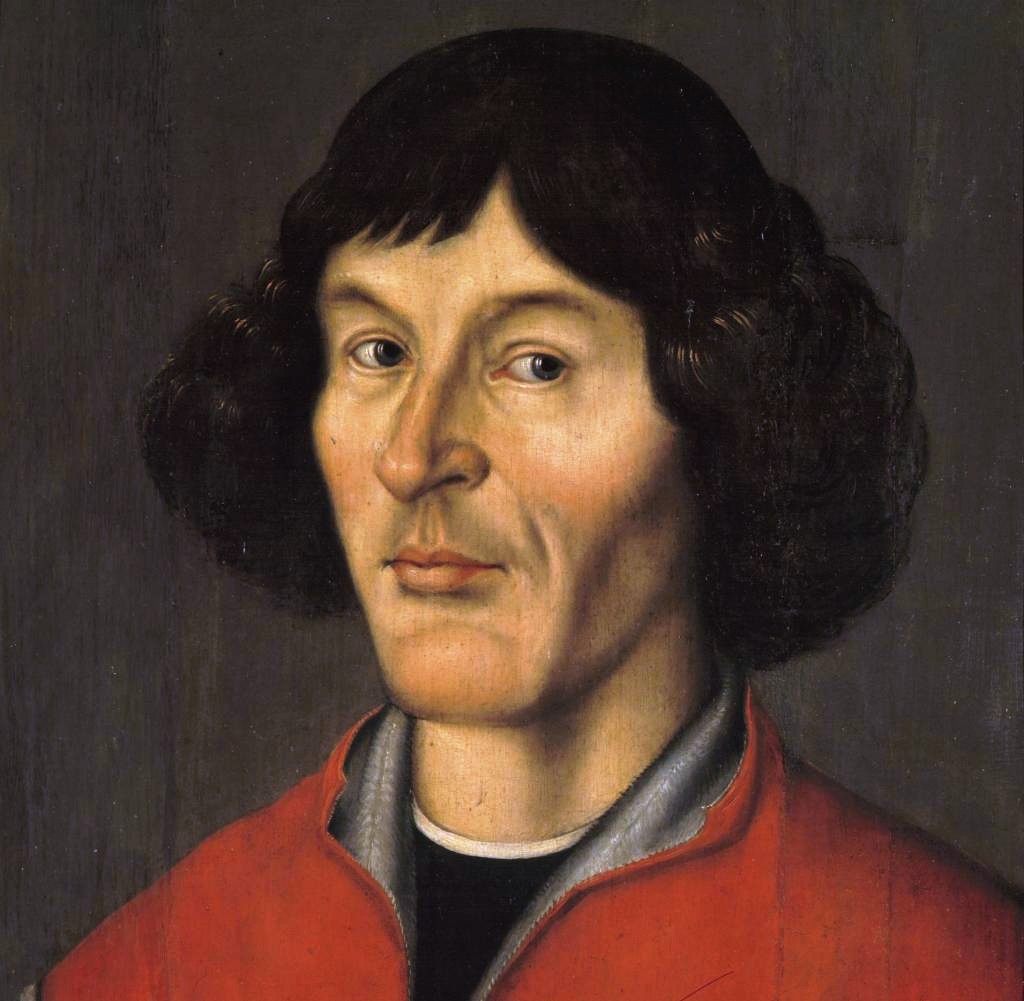 Nicolas Copernic (polonais : Mikołaj Kopernik, allemand : Nikolaus Kopernikus, latin : Nicolaus Copernicus Torinensis/Thorunensis/Torunensis) est un astronome polonais, également chanoine, médecin et mathématicien, né le 19 février 1473 à Thorn (Toruń), Prusse royale (royaume de Pologne) et mort le 24 mai 1543 à Frauenburg (également en Prusse royale, royaume de Pologne, aujourd'hui Frombork).
Nicolas Copernic (polonais : Mikołaj Kopernik, allemand : Nikolaus Kopernikus, latin : Nicolaus Copernicus Torinensis/Thorunensis/Torunensis) est un astronome polonais, également chanoine, médecin et mathématicien, né le 19 février 1473 à Thorn (Toruń), Prusse royale (royaume de Pologne) et mort le 24 mai 1543 à Frauenburg (également en Prusse royale, royaume de Pologne, aujourd'hui Frombork).
Il est célèbre pour avoir développé et défendu la théorie de l'héliocentrisme selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil, supposé au centre de l'Univers, contre l'opinion alors admise, que la Terre était centrale et immobile. Les conséquences de cette théorie dans le changement profond des points de vue scientifique, philosophique et religieux qu'elle impose sont baptisées révolution copernicienne.
NDLR : la suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Nicolas Copernic
Stephen Hawking 1942-2018
Voir le trailer du film sur Stephen Hawking
 Stephen William Hawking), né le 8 janvier 1942 à Oxford et mort le 14 mars 2018 à Cambridge, est un physicien théoricien et cosmologiste britannique. Ses livres et ses apparitions publiques ont fait de ce théoricien de renommée mondiale une célébrité.
Stephen William Hawking), né le 8 janvier 1942 à Oxford et mort le 14 mars 2018 à Cambridge, est un physicien théoricien et cosmologiste britannique. Ses livres et ses apparitions publiques ont fait de ce théoricien de renommée mondiale une célébrité.
Depuis l'âge d'une vingtaine d'années, Hawking souffre d'une forme rare — de début précoce et d'évolution lente — de sclérose latérale amyotrophique (SLA) ; sa maladie progresse au fil des ans au point de le laisser presque complètement paralysé. Pourtant, il est professeur de mathématiques à l'université de Cambridge de 1980 à 2009, membre du Gonville and Caius College et chercheur distingué du Perimeter Institute for Theoretical Physics.
Il est connu pour ses contributions dans les domaines de la cosmologie et la gravité quantique, en particulier dans le cadre des trous noirs. Son succès est également lié à ses ouvrages de vulgarisation scientifique dans lesquels il discute de ses théories et de la cosmologie en général, en particulier Une brève histoire du temps.
La clé des principaux travaux scientifiques de Stephen Hawking est fondée, en collaboration avec Roger Penrose, sur l'élaboration des théorèmes sur les singularités dans le cadre de la relativité générale, et la prédiction théorique que les trous noirs devraient émettre ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de rayonnement de Hawking.
NDLR : la suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Stephen Hawking
Antoni van Leeuwenhoek 1632 - 1723
 Antoni van Leeuwenhoek, né le 24 octobre 1632 à Delft et mort le 26 août 1723 dans la même ville, est un commerçant et savant néerlandais, connu pour ses améliorations du microscope et comme l'un des précurseurs de la biologie cellulaire et de la microbiologie.
Antoni van Leeuwenhoek, né le 24 octobre 1632 à Delft et mort le 26 août 1723 dans la même ville, est un commerçant et savant néerlandais, connu pour ses améliorations du microscope et comme l'un des précurseurs de la biologie cellulaire et de la microbiologie.
Il a de facto poursuivi l'œuvre de Jan Swammerdam, qui vivait à Amsterdam.
Leeuwenhoek développe la technique pour fabriquer des lentilles de microscope d’une qualité et d’une puissance inconnues ailleurs dans le monde scientifique de son époque.
Dès 1674, il en tire de nombreuses et étonnantes observations — découverte des protozoaires, des spermatozoïdes — très en avance sur son temps.
Il affirme aussi l'existence des bactéries.
Il en fait part immédiatement et régulièrement à la Royal Society de Londres, mais la nécessaire traduction de ses lettres (écrites en néerlandais) — il ne maîtrise ni l’anglais ni le latin — en freine la diffusion.
De plus, gardant secrète sa technique de fabrication de lentilles, ses observations ne peuvent être reproduites par ses confrères anglais.
Il leur faudra plus de trois ans et plus de quatre tentatives pour que la réalité de sa découverte des protozoaires — la plus accessible aux autres microscopes de l'époque — soit reconnue, amenant leur confiance sur la fiabilité de ses autres observations et son élection en 1680 comme membre de la Royal Society de Londres et en 1699 comme membre de l’Académie des sciences de Paris.
Antoni van Leeuwenhoek est baptisé à l’église réformée protestante. Son père, fabricant de paniers, meurt lorsqu’il est encore très jeune, et sa mère se remarie en 1637.
En 1648, il devient apprenti chez un drapier d’Amsterdam.
Après son apprentissage, il occupe les fonctions de comptable et de caissier chez son maître. En 1656, il retourne à Delft : il s’y marie et ouvre une boutique de drapier et de mercerie, mais on connaît fort peu ses activités commerciales.
Cinq ans après la mort de sa première femme, il se remarie en 1671.
Sa seconde femme décède en 1694, laissant Leeuwenhoek s’occuper seul de son dernier enfant, sa fille Maria, seule survivante de ses cinq enfants.
En 1660, il obtient la fonction de chambellan auprès des juges de Delft. En 1669, il devient « géomètre ».
En 1679, Leeuwenhoek devient « jaugeur de vin » et, enfin, à partir de 1677, il occupe également la fonction de directeur général du district de Delft.
Ces différents postes indiquent la position prospère de Leeuwenhoek dans la ville.
Il semble qu’il se sépare de son commerce de draperie peu après 1660, car sa correspondance n’en fait nulle mention.
Ses emplois municipaux lui laissent, semble-t-il, un temps considérable pour la microscopie : la fabrication de ses microscopes qui grossissent jusqu'à 200 fois s'inspire probablement des compte-fils, sorte de loupes rudimentaires utilisées pour analyser la texture des étoffes mais qui ne grossissent que de 6 à 15 fois.
Une anecdote veut que, apiculteur amateur, l'idée lui en soit venue après avoir placé l'œil derrière une goutte de miel enfermée dans un trou de plaque de cire.
Ses finances sont bonnes d’autant qu’il hérite d'une maison de la famille de sa première femme.
En 1666, il achète un jardin à l’extérieur de la ville et en 1681, il possède un cheval.
Une indication de sa fortune est donnée par l’héritage que laisse sa fille, Maria, à sa mort, en 1745 et qui représente 90 000 guinées, une somme considérable pour l’époque.
Pourtant, certains auteurs notent que Leeuwenhoek « occupa un emploi municipal modeste jusqu’à sa mort ».
Constantin Huygens (1596-1687) écrit : « Vous voyez comme ce bon Leeuwenhoeck ne se lasse pas de fouiller partout où sa microscopie peut arriver, si beaucoup d’autres plus savants voulaient prendre la même peine, la découverte des belles choses irait bientôt plus loin ».
Si ces observations suscitent l’émerveillement des scientifiques de son temps, on lui reproche plus tard son manque de connaissances scientifiques qu’accentue le fait qu’il ne connaît aucune langue étrangère.
Cette absence de connaissance lui permet de réaliser ses observations d’un œil neuf, sans les préjugés des anatomistes de son époque.
Il laisse une œuvre immense uniquement constituée de lettres, environ 300, toutes rédigées en néerlandais, et la plupart envoyée à la Royal Society.
Il écrit, dans une lettre à Henry Oldenburg datée du 30 octobre 1676, qu’il espère recevoir de ses correspondants des objections à ses observations, et qu’il s’engage à corriger ses erreurs.
Il répond d’ailleurs aux premières marques de scepticisme marquant la parution de ses observations par une évidente confiance en lui-même.
Ses observations seront suffisamment fameuses pour lui attirer de nombreux visiteurs de marque comme la reine
Marie II d'Angleterre,
Pierre le Grand,
Frédéric Ier de Prusse,
mais aussi des philosophes et des savants, des médecins et des hommes d’église, etc.
Leeuwenhoek réalise devant eux de nombreuses démonstrations.
Il fait observer à Pierre le Grand la circulation sanguine dans la queue d’une anguille.
Il est inhumé dans la vieille église de Delft.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Antoni van Leeuwenhoek
Alexandre Stepanovitch Popov 1859-1906
 Alexandre Stepanovitch Popov (en russe : Александр Степанович Попов ; 16 mars 1859 - 13 janvier 1906), est un physicien et ingénieur russe, précurseur de la radio.
Alexandre Stepanovitch Popov (en russe : Александр Степанович Попов ; 16 mars 1859 - 13 janvier 1906), est un physicien et ingénieur russe, précurseur de la radio.
Formation universitaire
Né dans une petite ville de l’Oural, Krasnotourinsk (Oblast de Sverdlovsk), ce fils de prêtre s’intéressa très jeune aux sciences naturelles. Son père voulait qu’Alexandre fasse sa prêtrise et l'envoya au Séminaire d’Ekaterinbourg1. Mais le jeune homme continua d'y cultiver l'étude des sciences et des mathématiques : au lieu de s'inscrire à l’école de Théologie, il s'inscrivit en 1877 à l’Université de Saint-Pétersbourg où il étudia la physique1,2. Diplômé avec félicitations en 1882, l'université lui offrit un poste de préparateur ; mais sa rémunération ne lui permettant pas de subvenir à l'entretien de sa famille, il postula en 1883 pour l'emploi de chargé de cours et chef de laboratoire à l’École des torpilleurs de Kronstadt, dans l’île fortifiée de Kotline.
Le premier récepteur radio
La bibliothèque fournie de l'école militaire et l'excellent équipement de son laboratoire donnaient toute latitude à Popov pour se consacrer à sa passion, le domaine nouveau des ondes hertziennes. Quelques années plus tôt, en 1888, le physicien allemand Heinrich Hertz avait montré comment créer ces perturbations électromagnétiques, et comment les détecter. En ce début des années 1890, Popov, comme bien d'autres chercheurs en Europe, se propose de poursuivre ce travail.
Le 1er juin 1894, un électricien britannique, Oliver Lodge, parvint, à l'aide du « cohéreur » de Branly, à détecter des ondes radio jusqu'à 50 mètres de leur source d'émission. Ce cohéreur était un tube de verre contenant de la grenaille déposée entre deux électrodes2. Lorsque Lodge appliquait une antenne réceptrice contre les électrodes, le cohéreur devenait conducteur : le courant d'une pile circulait, car on pouvait enregistrer son intensité aux bornes du circuit avec un galvanomètre.
Pour recommencer une réception, il fallait réinitialiser le cohéreur en tapotant dessus pour couper le circuit. Ainsi l'appareil de Lodge était-il équipé d'un bras tournant motorisé qui venait périodiquement secouer le cohéreur. Mais bien que son émetteur à étincelles fût équipé d'un manipulateur, rien ne prouve que Lodge ait jamais détecté autre chose que des grésillements sur son récepteur ; c'est pourquoi on ne peut créditer véritablement l'Anglais Lodge de la première communication radio.
NDLR : la suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Alexandre Popov (physicien )
Gustav Robert Kirchhoff 1824 - 1887
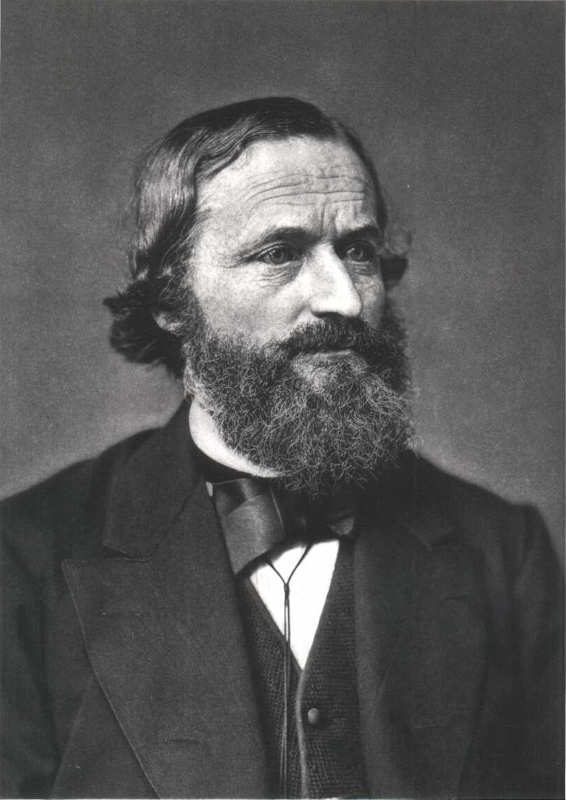 Gustav Robert Kirchhoff (né le 12 mars 1824 à Königsberg, en province de Prusse-Orientale et décédé à Berlin le 17 octobre 1887) est l’un des plus grands physiciens du XIXe siècle, avec des contributions essentielles à l’électrodynamique, la physique du rayonnement et la théorie mathématique de l'élasticité.
Gustav Robert Kirchhoff (né le 12 mars 1824 à Königsberg, en province de Prusse-Orientale et décédé à Berlin le 17 octobre 1887) est l’un des plus grands physiciens du XIXe siècle, avec des contributions essentielles à l’électrodynamique, la physique du rayonnement et la théorie mathématique de l'élasticité.
Gustav Kirchhoff est le fils benjamin de l'avocat Friedrich Kirchhoff de Kœnigsberg (Prusse orientale), et de Johanna Henriette Wittke, épouse Clara Richelot.
Elle était la fille de Friedrich Julius Richelot, professeur de mathématiques.
Après un doctorat de physique obtenu en 1847 à l'université de Königsberg où il a suivi les cours de Franz Ernst Neumann, Gustav Kirchhoff est recruté comme professeur surnuméraire à l'université de Breslau.
C'est là qu'il fait la connaissance de Robert Bunsen, avant d'accepter en 1854 un poste de professeur à l'université de Heidelberg.
En 1862, la médaille Rumford lui est décernée pour avoir démontré l'existence de raies lumineuses fixes dans le spectre du rayonnement solaire (spectre de la « lumière naturelle »), et pour avoir mis en évidence une inversion des raies lumineuses dans la lumière artificielle.
Il obtient la chaire de physique de l'université Humboldt de Berlin en 1875 et deux ans plus tard, il est lauréat de la médaille Davy ;
mais une blessure au pied consécutive à une chute le condamne pour longtemps au fauteuil roulant ;
elle commençait à guérir lorsque Kirchhoff subit les atteintes d'une hémorragie cérébrale, l'obligeant à espacer ses leçons à l'université et même à prendre sa retraite en 1886.
Il mourut l'année suivante, à seulement 63 ans, sans avoir pu superviser en totalité son cours de physique mathématique :
il n'aura pu en réviser lui-même que la première partie („Die Mechanik“).
Source Wikipédia: Gustav Kirchhoff
Andrussow Leonid 1896-1988
 Leonid Andrussow (28 novembre 1896 à Riga dans le gouvernement de Livonie de l'Empire russe (actuelle Lettonie) - 15 décembre 1988 près de Paris) était un ingénieur chimiste allemand. Il a mis au point le procédé Andrussow qui permet de synthétiser l'acide cyanhydrique (HCN) à partir de méthane et d'ammoniaque.
Leonid Andrussow (28 novembre 1896 à Riga dans le gouvernement de Livonie de l'Empire russe (actuelle Lettonie) - 15 décembre 1988 près de Paris) était un ingénieur chimiste allemand. Il a mis au point le procédé Andrussow qui permet de synthétiser l'acide cyanhydrique (HCN) à partir de méthane et d'ammoniaque.
Leonid Androussov est né à Riga, capitale de la Lettonie. Son père Woldemar était avocat, et sa femme Caroline Ulmann lui avait donné 9 enfants. « Androussov » est sans doute la forme russifiée du nom suédois « Anderson ».
Leonid Androussov accomplit ses études de génie chimique à l'Université de Lettonie. Ennemi des bolcheviks lors de la révolution d'Octobre, il fut capturé et jeté dans les geôles de la Tchéka à Moscou. C'est sans doute grâce à l'aide de parents émigrés en Allemagne qu'il obtint sa libération. Il s'inscrivit à l'université de Berlin-Charlottenbourg et soutint sa thèse de chimie en 1925 sous la direction de Walther Nernst.
Recruté par I.G. Farben à Ludwigshafen-Oppau en 1927, il travailla sur la synthèse de l'ammoniac ; il résidait alors à Mannheim. Sa théorie de la catalyse, développée depuis 1927, le mena dès 1930 à la synthèse de l’acide prussique par oxydation d'un mélange d’ammoniac et de méthane, et à sa réalisation industrielle.
Le procédé Andrussow constitue l'une des voies essentielles pour la fabrication à grande échelle de cet acide, qui est un précurseur du nylon, ainsi que pour la synthèse de cyanhydrine d'acétone, qui est un précurseur du plexiglas.
En 1932, les recherches d’Androussov sur l'alkylation catalytique à base d'éther débouchent sur un procédé de synthèse industrielle de diméthylaniline extrêmement pure. Il fait connaître la réaction de substitution du tétrachloréthane pour la synthèse de chlorométhane et de trichloréthylène.
Au cours de la seconde guerre mondiale, il se consacre aux recherches sur l’ignition des propergols, entre autres l’injection d'un mélange d’acide nitrique et d’amine. Il collabore au développement des missiles V2 à Stromberg, et préconise l’ajout de protoxyde d'azote aux propergols pour obtenir une accélération continue à haute altitude.
Après la guerre, il opte en 1946 pour une activité d'ingénieur conseil en catalyse chimique en France : établi désormais à Grenoble, il contribue à améliorer la synthèse de l’anhydride sulfurique, du formaldéhyde et de l’ammoniac ; puis il déménage à Paris, tout en travaillant pour la société Zimmer de Francfort-sur-le-Main. Il entreprend une étude systématique des propriétés de transport des gaz et des liquides, y compris ceux formés de macromolécules. De 1975 à 1981 il habitait à Mannheim-Feudenheim, mais déménagea ensuite à Paris, où il s'éteignit, âgé de 92 ans.
Œuvres :
Androussov est l'auteur de l'un des volumes des tables Landolt-Börnstein.
Source Wikipédia: Leonid Andrussow
Avicenne, ou Ibn Sīnā 980-1037
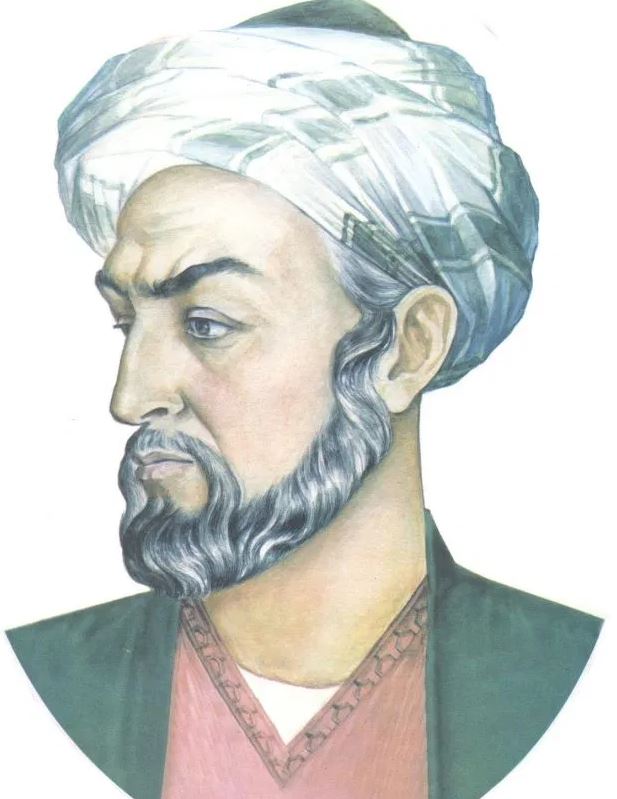 Avicenne (du latin médiéval Avicenna ; en persan : ابن سینا (Ebn-e Sinâ), venant tous deux de l'arabe ابن سينا (Ibn Sīnā), « fils de Sina » ; nom arabe complet : أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا (Abū ʿAlī al-Ḥusayn ibn ʿAbdillāh ibn al-Ḥasan ibn ʿAlī ibn Sīnā) ; aussi appelé پور سینا (Pur-e Sinâ) en persan), né le 7 août 980 à Afshéna, près de Boukhara, dans la province de Transoxiane (actuel Ouzbékistan) et mort en juin 1037 à Hamadan (Iran), est un philosophe et médecin médiéval persan. Rédigeant principalement en arabe classique, il s'intéressa à de nombreuses sciences, comme l'astronomie, l'alchimie, et la psychologie.
Avicenne (du latin médiéval Avicenna ; en persan : ابن سینا (Ebn-e Sinâ), venant tous deux de l'arabe ابن سينا (Ibn Sīnā), « fils de Sina » ; nom arabe complet : أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا (Abū ʿAlī al-Ḥusayn ibn ʿAbdillāh ibn al-Ḥasan ibn ʿAlī ibn Sīnā) ; aussi appelé پور سینا (Pur-e Sinâ) en persan), né le 7 août 980 à Afshéna, près de Boukhara, dans la province de Transoxiane (actuel Ouzbékistan) et mort en juin 1037 à Hamadan (Iran), est un philosophe et médecin médiéval persan. Rédigeant principalement en arabe classique, il s'intéressa à de nombreuses sciences, comme l'astronomie, l'alchimie, et la psychologie.
Ses disciples l'appelaient cheikh el-raïs, c'est-à-dire le « prince des savants », le plus grand des médecins, le Maître par excellence, ou encore le troisième Maître (après Aristote et Al-Fārābī).
Ses œuvres principales sont l'encyclopédie médicale Qanûn (« Canon de la médecine ») et ses deux encyclopédies scientifiques le Livre de la guérison (de l'âme) et Danesh-e Nâma (« Livre de science »). Dans son Qanûn, il opère une vaste synthèse médico-philosophique avec la logique d'Aristote, combinée avec le néo-platonisme, élevant la dignité de la médecine comme discipline intellectuelle, compatible avec le monothéisme. Son influence sera prédominante dans l'Occident médiéval latin jusqu'au XVIe siècle.
Si son œuvre médicale n'a plus qu'un intérêt historique, son œuvre philosophique se situe au carrefour de la pensée orientale et de la pensée occidentale. Elle reste encore vivante au début du XXIe siècle dans le cadre de l'islam. Elle continue d'être étudiée en Occident du point de vue de la philosophie, de l'épistémologie et des sciences cognitives.
Contexte historique:
Aux VIIe et VIIIe siècles, premiers siècles de l'hégire pour le monde musulman, les conquérants arabes se trouvent en présence de communautés appartenant surtout au christianisme oriental en Égypte, Palestine, Syrie et Mésopotamie. Ces communautés avaient déjà produit des traductions des œuvres, du grec au syriaque3,4. Ce travail se poursuit jusqu'au XIIIe siècle.
Statue d'Avicenne à Vienne, Pavillon des érudits.
De 750 à 850, période des califes Abbassides, la science arabo-musulmane est en plein essor. Les traducteurs des califes utilisent d'abord les versions syriaques, puis les textes grecs, pour les traduire en arabe. Le philosophe al-Fārābī (mort en 950), « le second maître » (en référence au premier maître, Aristote), tient une place prépondérante dans cette dynamique.
Dans le monde iranien, alors sous domination arabe, la culture arabe se confronte avec la culture persane. Les textes et traditions des dogmes islamiques se fixèrent à cette époque :
- le sunnisme, avec al-Ash‘ari (en 935) ;
- le chiisme duodécimain, avec Shaykh Saduq Ibn Babuyeh (en 991) et Shaykh Mufid (en 1022) ;
- l'ismaélisme, ou chiisme ismaélien, branche du chiisme, en langue arabe et en langue persane.
À la même époque, à la périphérie du monde iranien, les Turcs en provenance de Mongolie entrent en contact avec l'Islam, et s'islamisent, constituant des dynasties d'origine turque, comme les Seldjoukides.
Dans le monde chrétien des Xe et XIe siècles, sont à peu près contemporains d'Avicenne des savants et philosophes comme Michel Psellos en Orient chrétien (Byzance). En Occident latin, c'est une période d'attente et de transition (fin du Haut Moyen Âge, début du Moyen Âge central) où l'on peut signaler Gerbert, Fulbert, Lanfranc et saint Anselme.
NDLR : Et la suite sur Wikipédia (et la suite est longue…).
Source Wikipédia: Avicenne
Carl Bosch 1874-1940
 Carl Bosch, né le 27 août 1874 à Cologne, Empire allemand et mort le 26 avril 1940 à Heidelberg, Allemagne, est un ingénieur et chimiste allemand. Il est surtout connu pour avoir supervisé la première industrialisation du procédé Haber et dirigé IG Farben.
Carl Bosch, né le 27 août 1874 à Cologne, Empire allemand et mort le 26 avril 1940 à Heidelberg, Allemagne, est un ingénieur et chimiste allemand. Il est surtout connu pour avoir supervisé la première industrialisation du procédé Haber et dirigé IG Farben.
Carl Bosch fait ses études à l'université technique de Charlottenburg (aujourd'hui université technique de Berlin), puis à l'université de Leipzig de 1892 à 1898.
En 1899, il commence à travailler au sein de BASF. De 1908 à 1913, il industrialise le procédé Haber en collaboration avec Fritz Haber. À cause de son apport déterminant, le procédé industriel est aussi appelé « procédé Haber-Bosch ».
Après la Première Guerre mondiale, il travaille sur le pétrole et la synthèse de méthanol par chimie à haute pression.
En 1919, il obtient la médaille Liebig.
En 1921, il donne un montant substantiel pour l'érection d'un institut de recherche à Potsdam pour étudier les raies spectrales de la lumière. Le bâtiment, de facture moderne pour l'époque, sera appelé « Tour Einstien ».
En 1925, Bosch est l'un des fondateurs d'IG Farben, dont il deviendra président du conseil de direction à partir de 1935.
En 1931, il est co-lauréat avec Friedrich Bergius du prix Nobel de chimie « en reconnaissance de leurs contributions à l'invention et au développement de méthodes chimiques à haute pression ».
Il dirige le Kaiser Wilhelm Institut de physique de 1936 à 1940.
Il est le neveu de Robert Bosch, fondateur de Robert Bosch GmbH.
NDLR : Ce qu’il faut retenir ici :
- Il ne faut pas le confondre avec son oncle Robert Bosch, le Fondateur de la marque bosch :
Cliquez ici .
Source Wikipédia: Carl Bosch
Fritz Haber 1868-1934
Voir la vidéo de Bruce sur la chaine Youtube e-penser : Cliquez ici .
 Fritz Haber (né le 9 décembre 1868 à Breslau, Royaume de Prusse - mort le 29 janvier 1934 à Bâle, Suisse) est un chimiste allemand qui a reçu le prix Nobel de chimie de 1918 pour ses travaux sur la synthèse de l'ammoniac, importante pour la fabrication d'engrais et d'explosifs. Il est également considéré comme le « père de l'arme chimique » pour ses travaux sur le dichlore et d'autres gaz toxiques largement utilisés pendant la Première Guerre mondiale. D'origine juive, il fut contraint à l'exil en 1933 et mourut sur le chemin de Bâle en Suisse.
Fritz Haber (né le 9 décembre 1868 à Breslau, Royaume de Prusse - mort le 29 janvier 1934 à Bâle, Suisse) est un chimiste allemand qui a reçu le prix Nobel de chimie de 1918 pour ses travaux sur la synthèse de l'ammoniac, importante pour la fabrication d'engrais et d'explosifs. Il est également considéré comme le « père de l'arme chimique » pour ses travaux sur le dichlore et d'autres gaz toxiques largement utilisés pendant la Première Guerre mondiale. D'origine juive, il fut contraint à l'exil en 1933 et mourut sur le chemin de Bâle en Suisse.
NDLR :
- Allez voir la vidéo de Bruce sur la chaine Youtube e-penser : Cliquez ici .
- Procédé Haber-Bosch:
Cliquez ici .
- Liban en 2020 :
Cliquez ici .
- Zyklon B (venant du Zyklon A) , il faut bien lire la partie "Histoire" de la page Wikipédia:
Cliquez ici .
NDLR : pour l’explosion du Liban, si vous constatez une erreur, signalez là par mail, merci.
Source Wikipédia: Fritz Haber
Carl Friedrich Gauss 1777-1855
 Johann Carl Friedrich Gauß , traditionnellement transcrit Gauss en français ; Carolus Fridericus Gauss en latin), né le 30 avril 1777 à Brunswick et mort le 23 février 1855 à Göttingen, est un mathématicien, astronome et physicien allemand. Il a apporté de très importantes contributions à ces trois domaines. Surnommé « le prince des mathématiciens », il est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps.
Johann Carl Friedrich Gauß , traditionnellement transcrit Gauss en français ; Carolus Fridericus Gauss en latin), né le 30 avril 1777 à Brunswick et mort le 23 février 1855 à Göttingen, est un mathématicien, astronome et physicien allemand. Il a apporté de très importantes contributions à ces trois domaines. Surnommé « le prince des mathématiciens », il est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps.
La qualité extraordinaire de ses travaux scientifiques était déjà reconnue par ses contemporains. Dès 1856, le roi de Hanovre fit graver des pièces commémoratives avec l'image de Gauss et l'inscription Mathematicorum Principi (« au prince des mathématiciens » en latin). Gauss n'ayant publié qu'une partie de ses découvertes, la postérité découvrit surtout l'étendue de ses travaux lors de la publication de ses Œuvres, de son journal et d'une partie de ses archives, à la fin du xixe siècle.
Gauss dirigea l'Observatoire de Göttingen et ne travailla pas comme professeur de mathématiques — d'ailleurs il n'aimait guère enseigner — mais il encouragea plusieurs de ses étudiants, qui devinrent d'importants mathématiciens, notamment Gotthold Eisenstein et Bernhard Riemann.
NDLR : Il y a trop à écrire ici, donc... "La suite sur Wikipédia".
Source Wikipédia: Carl Friedrich Gauss
Djalāl ad-Dīn Muḥammad Balkhi1 ou Rûmî 1207-1273
Voir le poème des Atomes de Rumi : Cliquez ici !
 Djalāl ad-Dīn Muḥammad Balkhi (persan : جلالالدین محمد بلخی) ou Rûmî, né à Balkh (actuel Afghanistan) dans le Khorasan (grande région de culture perse), le 30 septembre 1207 et mort à Konya (dans l'actuelle Turquie) le 17 décembre 1273, est un poète mystique persan qui a profondément influencé le soufisme.
Djalāl ad-Dīn Muḥammad Balkhi (persan : جلالالدین محمد بلخی) ou Rûmî, né à Balkh (actuel Afghanistan) dans le Khorasan (grande région de culture perse), le 30 septembre 1207 et mort à Konya (dans l'actuelle Turquie) le 17 décembre 1273, est un poète mystique persan qui a profondément influencé le soufisme.
Son prénom, Djalal-el-din, signifie « majesté de la religion » (de djalâl, majesté, et dîn, religion, mémoire, culte). Quant à sa nisba (l'indication de son origine), elle renvoie soit à Balkh (le « balkhien ») ou à Byzance (RûmÎ: le « byzantin »). Il reçut très tôt le titre de Mawlānā, « notre maître », souvent écrit Mevlana, qui est devenu intimement lié à l'ordre des « derviches tourneurs » ou mevlevis, une des principales confréries soufies, qu'il fonda dans la ville de Konya. Il a écrit la majorité de ses œuvres en persan (farsi).
Son œuvre est profondément marquée par sa rencontre avec celui qui deviendra son maître spirituel, Shams ed Dîn Tabrîzî, dont le prénom signifie « soleil de la religion ». Il en fera même l'auteur de l'un de ses ouvrages, le Dîvân-e Shams-e Tabrîzî (Divân de Shams de Tabriz).
Rûmî aurait également repris à son compte certaines fables d'Ésope (via le célèbre Kalila et Dimna d'Ibn al-Muqaffa) dans son principal ouvrage le Masnavi (ou « Mathnawî », « Mesnevi »). Les Turcs, Iraniens, Afghans et autres populations de la région font montre de respect pour ses poèmes. Reconnu de son vivant comme un grand spirituel et comme un saint, il fréquentait les chrétiens et les juifs tout autant que les musulmans.
L'UNESCO a proclamé l'année 2007 année en son honneur, pour célébrer le huitième centenaire de sa naissance. Ainsi, le 30 septembre de la même année, des festivités ont été organisées à Konya, auxquelles ont pris part des derviches tourneurs et des ensembles de musique traditionnelle d'Iran.
Source Wikipédia: Djalâl ad-Dîn Rûmî
Nicolas de Myre 270-345
 Nicolas de Myre ou Nicolas de Bari, communément connu sous le nom de « saint Nicolas », est né à Patare, en Lycie (actuelle Turquie), vers 270 et mort à Myre en 345. Évêque de Myre en Lycie, il a probablement participé au premier Concile de Nicée au cours duquel il a probablement combattu l'arianisme.
Son culte est attesté depuis le VIe siècle en Orient et s'est répandu en Occident depuis l'Italie à partir du XIe siècle. Canonisé, il a été proclamé protecteur de nombreuses nations et de nombreux corps de métiers ; il est un personnage populaire de l'hagiographie chrétienne et il est l'un des saints les plus vénérés de l'église orthodoxe.
Le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas, est fêté traditionnellement dans plusieurs pays européens du Nord et de l'Est de l'Europe (notamment la Belgique, le Luxembourg, le Nord-Est de la France (surtout en Lorraine et en Alsace), les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse) « où il distribue des cadeaux à tous les enfants sages ». Il est également fêté en Aquitaine, en Espagne et en Italie.
Nicolas de Myre ou Nicolas de Bari, communément connu sous le nom de « saint Nicolas », est né à Patare, en Lycie (actuelle Turquie), vers 270 et mort à Myre en 345. Évêque de Myre en Lycie, il a probablement participé au premier Concile de Nicée au cours duquel il a probablement combattu l'arianisme.
Son culte est attesté depuis le VIe siècle en Orient et s'est répandu en Occident depuis l'Italie à partir du XIe siècle. Canonisé, il a été proclamé protecteur de nombreuses nations et de nombreux corps de métiers ; il est un personnage populaire de l'hagiographie chrétienne et il est l'un des saints les plus vénérés de l'église orthodoxe.
Le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas, est fêté traditionnellement dans plusieurs pays européens du Nord et de l'Est de l'Europe (notamment la Belgique, le Luxembourg, le Nord-Est de la France (surtout en Lorraine et en Alsace), les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse) « où il distribue des cadeaux à tous les enfants sages ». Il est également fêté en Aquitaine, en Espagne et en Italie.
Source Wikipédia: Nicolas de Myre
Ernest Rutherford 1871-1937
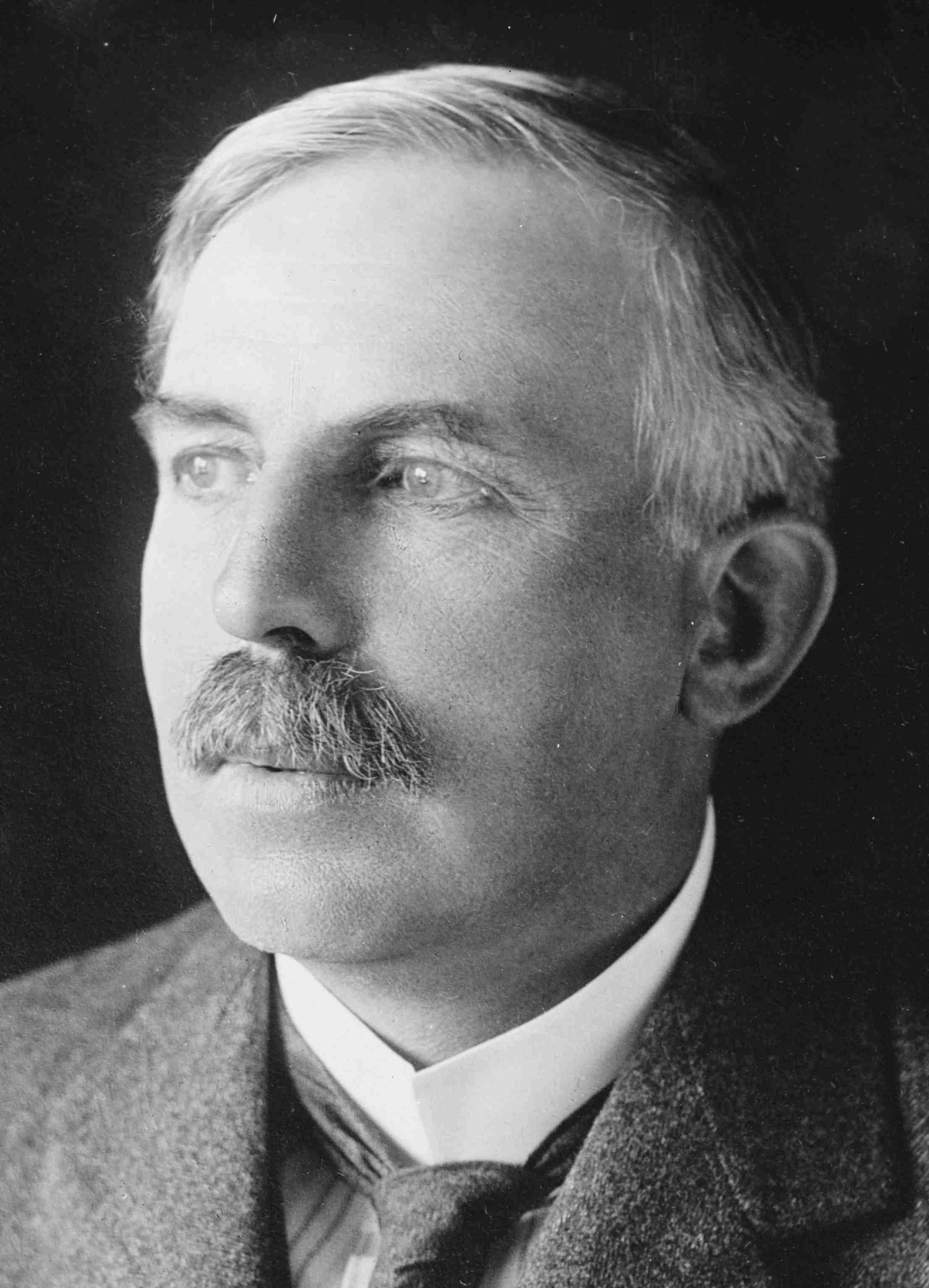 Ernest Rutherford (30 août 1871 à Brightwater, Nouvelle-Zélande - 19 octobre 1937 à Cambridge, Angleterre) est un physicien et chimiste néo-zélando-britannique, considéré comme le père de la physique nucléaire. Il découvrit les rayonnements alpha, les rayonnements bêta ; il découvrit aussi que la radioactivité s'accompagnait d'une désintégration des éléments chimiques, ce qui lui valut le prix Nobel de chimie en 19082. C'est encore lui qui mit en évidence l'existence d'un noyau atomique dans lequel étaient réunies toute la charge positive et presque toute la masse de l'atome.
Si, pendant la première partie de sa vie, il se consacra exclusivement à sa recherche, il passa la deuxième moitié de sa vie à enseigner et à diriger le laboratoire Cavendish à Cambridge, où fut découvert le neutron et où vinrent se former les physiciens Niels Bohr et Robert Oppenheimer. Son influence dans ce domaine de la physique qu'il a découvert fut donc particulièrement importante.
Il interpréta en 1911 la vision du modèle de Thomson ainsi que son expérience de la feuille d'or ce qui le conduisit à proposer son propre modèle.
Ernest Rutherford (30 août 1871 à Brightwater, Nouvelle-Zélande - 19 octobre 1937 à Cambridge, Angleterre) est un physicien et chimiste néo-zélando-britannique, considéré comme le père de la physique nucléaire. Il découvrit les rayonnements alpha, les rayonnements bêta ; il découvrit aussi que la radioactivité s'accompagnait d'une désintégration des éléments chimiques, ce qui lui valut le prix Nobel de chimie en 19082. C'est encore lui qui mit en évidence l'existence d'un noyau atomique dans lequel étaient réunies toute la charge positive et presque toute la masse de l'atome.
Si, pendant la première partie de sa vie, il se consacra exclusivement à sa recherche, il passa la deuxième moitié de sa vie à enseigner et à diriger le laboratoire Cavendish à Cambridge, où fut découvert le neutron et où vinrent se former les physiciens Niels Bohr et Robert Oppenheimer. Son influence dans ce domaine de la physique qu'il a découvert fut donc particulièrement importante.
Il interpréta en 1911 la vision du modèle de Thomson ainsi que son expérience de la feuille d'or ce qui le conduisit à proposer son propre modèle.
NDLR : La suite sur Wikipédia
Source Wikipédia: Ernest Rutherford
Félix Bloch 1905-1983
 Felix Bloch (23 octobre 1905 – 10 septembre 1983) est un physicien suisse qui a surtout travaillé aux États-Unis. Edward Mills Purcell et lui sont colauréats du prix Nobel de physique de 1952 « pour leur développement de nouvelles méthodes de mesures magnétiques nucléaires fines et les découvertes qui en ont découlé », notamment la résonance magnétique nucléaire (RMN).
Felix Bloch (23 octobre 1905 – 10 septembre 1983) est un physicien suisse qui a surtout travaillé aux États-Unis. Edward Mills Purcell et lui sont colauréats du prix Nobel de physique de 1952 « pour leur développement de nouvelles méthodes de mesures magnétiques nucléaires fines et les découvertes qui en ont découlé », notamment la résonance magnétique nucléaire (RMN).
Né à Zurich en Suisse, il y a fait ses études, notamment à l'École polytechnique fédérale de Zurich. D'abord inscrit en ingénierie, il changea rapidement pour la physique. Après 1927, il poursuivit ses études de physique à l'Université de Leipzig, soutenant son doctorat en 1928. Sa thèse doctorale établit la théorie quantique de l'état solide, à l'aide des ondes de Bloch pour décrire les électrons.
Il est resté ensuite en Allemagne, étudiant avec Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Niels Bohr et Enrico Fermi. En 1933, il quitta l'Allemagne, pour travailler à l'université Stanford en 1934. Il a été naturalisé américain en 1939. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a travaillé sur l'énergie nucléaire au Laboratoire national de Los Alamos, avant de démissionner pour rejoindre le projet du radar à Harvard.
Après la guerre, il s'est concentré sur des recherches sur l'induction nucléaire et la résonance magnétique nucléaire. En 1946 il a proposé les équations de Bloch qui déterminent l'évolution dans le temps de la magnétisation nucléaire.
Ces recherches sont à la base de la spectroscopie RMN qui sert à l'identification des composés chimiques, et aussi de l'imagerie par résonance magnétique développée pendant les années 1970. Il a reçu conjointement avec Edward Mills Purcell le prix Nobel de physique en 1952 « pour leur développement de nouvelles méthodes de mesures magnétiques nucléaires fines et les découvertes qui en ont découlé ».
En 1954-1955, il a été le premier directeur du CERN. En 1961, il est devenu professeur de physique Max Stein à l'Université Stanford. Son épouse est décédée en 1996 à 85 ans.
Source Wikipédia: Felix Bloch
Ferdinand Braun 1850-1918
 Karl Ferdinand Braun (né le 6 juin 1850 à Fulda, Allemagne et mort le 20 avril 1918 à New York) est un physicien allemand. Il fut, avec Guglielmo Marconi, colauréat du prix Nobel de physique de 1909 « en reconnaissance de leurs contributions au développement de la télégraphie sans fil ». Il soutient une thèse sous la direction de Hermann Ludwig von Helmholtz en 1872 à Berlin. Il vient une première fois à l'université de Strasbourg, pour deux ans en 1880 comme professeur invité (extraordinarius) ; il revient définitivement, en 1895, comme professeur (ordinarius) directeur de l'Institut de physique. Il se rend à New York en 1915 pour témoigner dans un procès en reconnaissance de brevet en radio-électricité. Il est arrêté et retenu pour sa nationalité allemande par les autorités américaines et meurt avant la fin de la guerre, en 1918.
Physicien intéressé surtout par la physique fondamentale, plusieurs de ses travaux furent à l'origine d'applications intéressantes.
Dès l'âge de 25 ans, en 1874, il établit que la galène (sulfure de plomb) ne respecte pas la loi d'Ohm : dans certaines conditions elle ne conduit pas l'électricité de la même manière suivant qu'on applique une tension dans un sens ou dans un autre.
Professeur à l'université de Strasbourg (il eut Jonathan Zenneck comme élève), il s'intéressa aux phénomènes électriques rapides et pour pouvoir les étudier, il développa en 1897 un tube cathodique particulier, dit « tube de Braun ». Son invention mena rapidement au développement de l'oscilloscope, qui plus tard allait permettre de réaliser les tubes cathodiques des téléviseurs, puis des premiers écrans d'ordinateurs. Braun exploita son invention dans la société « Professor Braun Telegrafen GmbH » qui deviendra plus tard « Telefunken AG ».
Il se lance en 1898 dans la transmission sans fil (TSF). À cette époque, les dispositifs radio de Guglielmo Marconi ont une portée limitée à 15 km, insuffisante pour des applications pratiques. Dans ces radios, sans amplificateur, l'antenne est une partie intégrante du circuit d'accord. Utilisant ses connaissances en physique, Braun sépare l'antenne du circuit d'accord en utilisant entre eux un couplage inductif. Il supprime ainsi l'étincelle des circuits limitant les pertes d'énergie et augmentant la sensibilité. Il brevette, en 1899, son système qui permet de couvrir à Cuxhaven une distance de 62 km.
En 1906, il utilisa sa connaissance des propriétés de conduction de la galène pour imaginer un redresseur, que l'on peut considérer comme l'ancêtre de la diode moderne, qui permit l'essor du poste à galène.
Le prix Nobel de physique de 1909 lui a été attribué, avec Guglielmo Marconi, pour ses travaux sur la télégraphie sans fil.
Karl Ferdinand Braun (né le 6 juin 1850 à Fulda, Allemagne et mort le 20 avril 1918 à New York) est un physicien allemand. Il fut, avec Guglielmo Marconi, colauréat du prix Nobel de physique de 1909 « en reconnaissance de leurs contributions au développement de la télégraphie sans fil ». Il soutient une thèse sous la direction de Hermann Ludwig von Helmholtz en 1872 à Berlin. Il vient une première fois à l'université de Strasbourg, pour deux ans en 1880 comme professeur invité (extraordinarius) ; il revient définitivement, en 1895, comme professeur (ordinarius) directeur de l'Institut de physique. Il se rend à New York en 1915 pour témoigner dans un procès en reconnaissance de brevet en radio-électricité. Il est arrêté et retenu pour sa nationalité allemande par les autorités américaines et meurt avant la fin de la guerre, en 1918.
Physicien intéressé surtout par la physique fondamentale, plusieurs de ses travaux furent à l'origine d'applications intéressantes.
Dès l'âge de 25 ans, en 1874, il établit que la galène (sulfure de plomb) ne respecte pas la loi d'Ohm : dans certaines conditions elle ne conduit pas l'électricité de la même manière suivant qu'on applique une tension dans un sens ou dans un autre.
Professeur à l'université de Strasbourg (il eut Jonathan Zenneck comme élève), il s'intéressa aux phénomènes électriques rapides et pour pouvoir les étudier, il développa en 1897 un tube cathodique particulier, dit « tube de Braun ». Son invention mena rapidement au développement de l'oscilloscope, qui plus tard allait permettre de réaliser les tubes cathodiques des téléviseurs, puis des premiers écrans d'ordinateurs. Braun exploita son invention dans la société « Professor Braun Telegrafen GmbH » qui deviendra plus tard « Telefunken AG ».
Il se lance en 1898 dans la transmission sans fil (TSF). À cette époque, les dispositifs radio de Guglielmo Marconi ont une portée limitée à 15 km, insuffisante pour des applications pratiques. Dans ces radios, sans amplificateur, l'antenne est une partie intégrante du circuit d'accord. Utilisant ses connaissances en physique, Braun sépare l'antenne du circuit d'accord en utilisant entre eux un couplage inductif. Il supprime ainsi l'étincelle des circuits limitant les pertes d'énergie et augmentant la sensibilité. Il brevette, en 1899, son système qui permet de couvrir à Cuxhaven une distance de 62 km.
En 1906, il utilisa sa connaissance des propriétés de conduction de la galène pour imaginer un redresseur, que l'on peut considérer comme l'ancêtre de la diode moderne, qui permit l'essor du poste à galène.
Le prix Nobel de physique de 1909 lui a été attribué, avec Guglielmo Marconi, pour ses travaux sur la télégraphie sans fil.
Source Wikipédia: Ferdinand_Braun
Frederik Zernike 1888-1966
 Frederik « Frits » Zernike (16 juillet 1888 à Amsterdam – 10 mars 1966) était un physicien néerlandais. Il est lauréat du prix Nobel de physique de 1953 « pour la démonstration de la méthode de contraste de phase, particulièrement pour son invention du microscope à contraste de phase », un instrument qui permet d'étudier la structure interne des cellules sans coloration, pratique qui tue les cellules.
Frederik « Frits » Zernike (16 juillet 1888 à Amsterdam – 10 mars 1966) était un physicien néerlandais. Il est lauréat du prix Nobel de physique de 1953 « pour la démonstration de la méthode de contraste de phase, particulièrement pour son invention du microscope à contraste de phase », un instrument qui permet d'étudier la structure interne des cellules sans coloration, pratique qui tue les cellules.
Parmi d'autres contributions, il travailla sur les polynômes de Zernike, une technique mathématique utilisée depuis dans les systèmes optiques avancés pour supprimer l'aberration.
Zernike était le fils de Carl Frederick August Zernike et de Antje Dieperink, tous deux professeurs de mathématiques ; Zernike partageait sa passion de la physique avec son père. Il étudia la chimie (sa matière principale), les mathématiques et la physique à l'université d'Amsterdam.
En 1912, il reçut un prix pour ses travaux sur l'opalescence des gaz.
En 1913, il devint assistant de Jacobus Kapteyn au laboratoire d'astronomie de l'université de Groningue.
En 1914, il contribua avec Ornstein à l'établissement de l'équation d'Ornstein-Zernike dans la théorie du point critique.
En 1915, il obtint un poste en physique théorique dans la même université et en 1920 il fut nommé professeur titulaire en physique théorique.
En 1930, alors qu'il menait des recherches sur les raies spectrales, il découvrit que les raies fantômes qui se trouvent de part et d'autre de chaque raie primaire des spectres produits par un réseau de diffraction, ont leur phase décalée de 90 degrés par rapport à celles des raies primaires. Ce fut au congrès de physique et de médecine de Wageningen en 1933 que Zernike décrivit pour la première fois sa technique de contraste de phase en microscopie. Il étendit sa méthode pour tester la qualité des miroirs concaves. Sa découverte est à la base du premier microscope à contraste de phase, construit durant la Seconde Guerre mondiale.
Le complexe universitaire situé au nord de la ville de Groningue porte son nom (parc Zernike), tout comme le cratère Zernike (en) sur la Lune. L'astéroïde (11779) Zernike a été nommé en son honneur. Il est élu membre étranger de la Royal Society le 26 avril 1956. Son épouse Lena est décédée en 1975.
Source Wikipédia: Frederik Zernike
George Gabriel Stokes 1819-1903
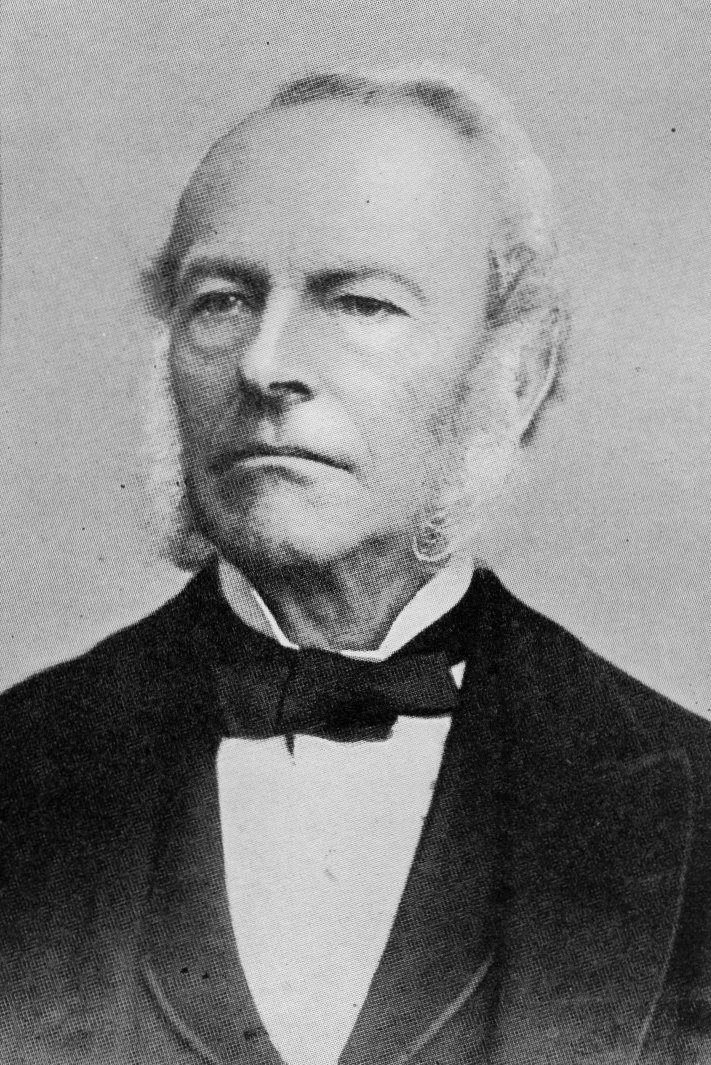 George Gabriel Stokes (13 août 1819 – 1er février 1903), 1er baronnet, est un mathématicien et physicien britannique né en Irlande.
George Gabriel Stokes (13 août 1819 – 1er février 1903), 1er baronnet, est un mathématicien et physicien britannique né en Irlande.
Ses contributions majeures concernent la mécanique des fluides, l'optique et la géodésie.
En 1841, il reçoit son diplôme avec mention d'honneur de l'université de Cambridge et entame une carrière de chercheur. Influencé par son ancien professeur William Hopkins, il se consacre à l'étude des fluides visqueux. Il publie, en 1845, le résultat de ses travaux sur les mouvements des fluides dans sa thèse On the theories of the internal friction of fluids in motion.
Son approche mathématique décrivant l'écoulement d'un fluide newtonien incompressible dans un espace tridimensionnel, en ajoutant une force de viscosité à partir des équations d'Euler (Principes généraux du mouvement des fluides, 1755), est à l'origine des équations de Navier-Stokes. L'ensemble de ses recherches est synthétisé par son traité Report on recent research in Hydrodynamics, paru en 1846, texte fondateur de l'hydrodynamique.
Il exploite ses expériences sur le mouvement d'un pendule dans un fluide pour étudier les variations de la gravitation à la surface de la terre et publie On the variation of gravity at the surface of the earth en 1849, ce qui fait de lui « l'un des initiateurs de la géodésie ».
Il devient dès 1849 professeur à la chaire de mathématiques de cette même université. Élu en 1851 à la Royal Society, il en sera secrétaire pendant trente ans et président de 1885 à 1890. Seul Isaac Newton avant lui avait cumulé ces trois postes.
En 1852, dans On the change of refrangibility of ligh, il explique le phénomène de la fluorescence en constatant que certains matériaux, tels que le fluorine (CaF2) et l'ouraline, émettent la lumière visible lorsqu'ils sont exposés au rayonnement ultraviolet, qui possède une longueur d'onde inférieure.
L'augmentation de la longueur d'onde est dite le déplacement de Stokes.
Il est lauréat du prix Smith en 1841, de la médaille Rumford en 1852 et de la médaille Copley en 1893.
En 1857, il épouse Mary Robinson, fille de l'astronome Thomas Romney Robinson, avec qui il a cinq enfants.
Source Wikipédia: George Gabriel Stokes
Guglielmo Marconi 1874-1937
 Guglielmo Marconi, né le 25 avril 1874 à Bologne et mort le 20 juillet 1937 à Rome, est un physicien, inventeur et homme d'affaires italien. Il est considéré comme l’un des inventeurs de la radio et de la télégraphie sans fil.
Guglielmo Marconi, né le 25 avril 1874 à Bologne et mort le 20 juillet 1937 à Rome, est un physicien, inventeur et homme d'affaires italien. Il est considéré comme l’un des inventeurs de la radio et de la télégraphie sans fil.
Avec Ferdinand Braun, il est colauréat du prix Nobel de physique de 1909 « en reconnaissance de ses contributions au développement de la télégraphie sans fil ». Il est le fondateur de la première compagnie internationale de radiodiffusion. La Cour suprême des États-Unis décida en 1943, qu'un des brevets qui avait permis à Marconi d’obtenir le prix Nobel était invalidé par un brevet antérieur qui était l’œuvre de Nikola Tesla.
Guglielmo Giovanni Maria Marconi naît près de Bologne dans une famille aisée, second fils de Giuseppe Marconi, un propriétaire italien, et d'Annie Jameson, Irlandaise, petite-fille du fondateur de la Distillerie Jameson Whiskey. Il fait ses études à Bologne dans le laboratoire d'Augusto Righi à Florence, à l'Institut Cavallero et plus tard, à Livourne. Enfant, il ne travaille pas bien à l'école. Baptisé selon le rite de l'Église catholique romaine, il est aussi membre de l'Église anglicane, au sein de laquelle il se marie, bien qu'il ait obtenu une annulation catholique de son mariage.
En 1895, il fait des expériences sur les ondes découvertes par Heinrich Rudolf Hertz sept ans auparavant. Il reproduit le matériel utilisé par Hertz en l'améliorant avec un cohéreur de Branly pour augmenter la sensibilité et l'antenne d'Alexandre Popov. Après ses toutes premières expériences en Italie, il réalise dans les Alpes suisses à Salvan une liaison télégraphique de 2,4 km (1,5 mille) durant l'été 1895. Cette expérimentation avait toutefois été remise en doute du côté italien avant d'être officiellement reconnue par l'Union internationale des télécommunications (« Patrimoine des télécommunications » UIT) en septembre 2008.
À l'automne 1895, Marconi vient proposer ses services à l'État italien, le ministre italien des Postes et Télégraphes, Salvatore Sineo refuse, aussi c'est en Grande-Bretagne que l'inventeur trouve les soutiens qui vont lui permettre de mener à bien ses expériences et de fonder la compagnie Marconi.
En 1896, faute d'être suivi par ses compatriotes, il part pour l'Angleterre, poursuit ses expériences et dépose un premier brevet.
À partir de 1897, l'Office américain des brevets lui délivre une trentaine de brevets sur la télégraphie sans fil (wireless telegraphy) et la radio. Nikola Tesla entreprend une action en justice envers lui, lui reprochant d'avoir illégalement utilisé 17 de ses brevets.
Le 12 décembre 1901, Guglielmo Marconi réalise la première transmission radio transatlantique entre Signal Hill à Saint-Jean de Terre-Neuve (Canada) et Poldhu dans le sud du comté des Cornouailles (Angleterre), ce qui lui valut le prix Nobel en 1909, partagé avec Karl Ferdinand Braun. Outre son caractère spectaculaire, cette expérience d'émission radio a permis de mettre en évidence les phénomènes de propagation à longue distance en basse et en moyenne fréquences par réflexion sur l’ionosphère.
En 1930, il est nommé à la tête de l'Académie royale d'Italie par Mussolini, dont, membre du Grand Conseil du fascisme, il est un fidèle soutien. Il déclara par ailleurs : « Je revendique l'honneur d'avoir été le premier fasciste en radiotélégraphie, le premier à reconnaître l'utilité de réunir en faisceau les rayons électriques, comme Mussolini a reconnu le premier dans le domaine politique la nécessité de réunir en faisceau les énergies saines du pays pour la grandeur de l'Italie ».
Marconi réalisa en 1931 la première transmission radiophonique d'un pape, Pie XI, annonçant personnellement au microphone : « Avec l'aide de Dieu, qui met à disposition de l'humanité tant de forces mystérieuses, j'ai réussi à préparer cet instrument qui donnera aux fidèles du monde entier la consolation d'entendre la voix du Saint-Père. »
Le 20 juillet 1937 Marconi meurt à Rome d'une attaque cardiaque.
Le 21 juin 1943, la Cour suprême des États-Unis invalide l'un des brevets sur la radio de Guglielmo Marconi.
Elle annule le brevet US 763772 accordé le 28 juin 1904 à Marconi pour « des améliorations apportées à une structure quadruple de récepteurs à haute-fréquence auto-accordables » pour des raisons d’antériorité de travaux ou de brevets de Tesla, Lodge et de Stone, notamment le brevet no 645.576 de Nikola Tesla (déposé en 1897 et homologué le 20 mars 1900) et indique que le brevet de 1904 n’apportait aucune invention par rapport aux brevets précédents sur ce sujet.
Source Wikipédia: Guglielmo Marconi
John William Strutt Rayleigh 1842-1919
 John William Strutt, troisième baron Rayleigh, plus connu sous son titre lord Rayleigh (12 novembre 1842 à Landford Grove, Essex, Angleterre - 30 juin 1919 à Witham, Essex, Angleterre) était un physicien anglais.
John William Strutt, troisième baron Rayleigh, plus connu sous son titre lord Rayleigh (12 novembre 1842 à Landford Grove, Essex, Angleterre - 30 juin 1919 à Witham, Essex, Angleterre) était un physicien anglais.
Il est lauréat du prix Nobel de physique de 1904.
John William Strutt est né le 12 novembre 1842 près de Maldon dans l'Essex.
Il fait des études de mathématiques à Trinity College (Cambridge), dont il sort diplômé en 1865, obtenant le titre de Senior Wrangler au Mathematical Tripos de 1868.
Après quelques voyages en Europe et aux États-Unis, il occupe un poste de chercheur au Trinity College de 1866 à 1871.
Ses travaux sont momentanément suspendus durant le conflit franco-prussien de 1870, par son impact sur la famille de John William, pourtant peu impliquée.
En 1871, il se marie avec Evelyne Georgiana Mary Balfour, fille de James Maitland Balfour et de sa femme Blanche, fille du second marquis de Salisbury. De ses trois fils, l'aîné devient professeur de physique à l'Imperial College of Science and Technology de Londres.
À la mort de son père en 1872, il prend sa succession et devient baron Rayleigh, troisième du titre, et consacre une partie importante de son temps à la gestion du domaine. Afin de pouvoir se consacrer à la science, il abandonne cette responsabilité à son jeune frère en 1875.
En 1879, il accepte la place laissée vacante au laboratoire Cavendish de Cambridge par la disparition de Maxwell.
À partir de 1884, il poursuit ses recherches en grande partie dans son domaine de Terling où il installe un laboratoire.
Il est « President of the Government Committee on Explosives » puis « Scientific Advisor to Trinity House » jusqu'à sa mort le 30 juin 1919.
Aux dires de ses compatriotes, c'est l'un des très rares nobles de haut rang à être devenu célèbre par des découvertes scientifiques.
Les premiers travaux de Lord Rayleigh consistent en l'approche mathématique de l'optique et des systèmes vibratoires, puis s'étendent à pratiquement toute la physique de l'époque : le son, les vibrations, la vision des couleurs, l'électrodynamique, l'électromagnétisme, la diffraction de la lumière, la mécanique des fluides, la viscosité, la capillarité, l'élasticité et la photographie.
Parmi ses premiers travaux, on note une théorie de la résonance qui fit de lui une autorité en acoustique.
Son traité sur le son, écrit lors d'une croisière sur le Nil et enrichi de mises à jour, a longtemps eu valeur de référence.
En 1871, il fournit une explication de la couleur du ciel en la reliant à la diffusion de la lumière par les molécules d'air.
Dans les années 1880, il contribue à la définition des unités fondamentales de l'électricité : l'ampère, l'ohm et le volt.
En 1892, il détermine la masse volumique de l'azote. En 1894, il découvre l'argon avec sir William Ramsay.
Source Wikipédia: John William Strutt Rayleigh
Joseph John Thomson 1856-1940
 Joseph John Thomson, né le 18 décembre 1856 et mort le 30 août 1940, est un physicien britannique.
Joseph John Thomson, né le 18 décembre 1856 et mort le 30 août 1940, est un physicien britannique.
Il a découvert l'électron ainsi que les isotopes et a inventé la spectrométrie de masse ; il a analysé la propagation d'ondes guidées.
Il a reçu le prix Nobel de physique de 1906 pour « ses recherches théoriques et expérimentales sur la conductivité électrique dans les gaz ». Ces recherches ont fourni les preuves de l'existence de l'électron.
Joseph John Thomson est né de parents écossais à Cheetham Hill dans la banlieue de Manchester le 18 décembre 1856. En 1870, il commence ses études en génie à l'université de Manchester, alors connue sous le nom de Owens College, puis en 1876, il entre au Trinity College à Cambridge. Le 22 janvier 1890, il se marie avec Rose Elizabeth Pagetnote 1 qui était chercheuse au laboratoire Cavendish. Ils eurent deux enfants, Joan Paget Thomson et George Paget Thomson, futur lauréat du prix Nobel de physique de 1937. En 1884, il succède à Lord Rayleigh à la chaire Cavendish de physique expérimentale2. La même année, Thomson devient membre de la Royal Society.
En 1902, il reçoit la médaille Hughes, en 1906, le prix Nobel de physique pour son travail sur la conductivité électrique des gaz, et en 1914, la médaille Copley. En 1908, il devient membre de l'ordre du Mérite et est anobli, ce qui lui donne droit au titre de Sir.
Il est président de la Royal Society de 1916 à 1920. En 1919, un de ses étudiants, Ernest Rutherford, lui succède à la chaire Cavendish de physique expérimentale. Il meurt le 30 août 1940 à Cambridge, et est enterré dans l'abbaye de Westminster.
En 1897, Thomson prouve expérimentalement l'existence des électrons, qui avait été prédite par George Johnstone Stoney en 1874.
Cette découverte est le résultat d'une série d'expériences sur les rayons cathodiques.
La même année, il énonce son modèle de l'atome, le modèle de plum pudding.
NDLR : la suite sur Wikipédia
Source Wikipédia: Joseph John Thomson
konrad zuse 1910-1995
 Konrad Zuse (22 juin 1910 – 18 décembre 1995) est un ingénieur allemand qui fut l'un des pionniers du calcul programmable qui préfigure l'informatique. Considéré comme le créateur du premier ordinateur programmable en calcul binaire et à virgule flottante qui a vraiment fonctionné : le Z3 en 1941.
Konrad Zuse (22 juin 1910 – 18 décembre 1995) est un ingénieur allemand qui fut l'un des pionniers du calcul programmable qui préfigure l'informatique. Considéré comme le créateur du premier ordinateur programmable en calcul binaire et à virgule flottante qui a vraiment fonctionné : le Z3 en 1941.
Il développa entre 1936 et 1938 le Z1, un premier calculateur mécanique utilisant un moteur électrique qui ne fonctionna jamais correctement.
Sa grande réussite fut la création du premier calculateur électromécanique programmable binaire à virgule flottante, le Z3. Commencé en 1937, il fut achevé en 1941.
Si l'on assimile le mot « ordinateur » à son équivalent anglais « computer » qui signifie à la fois « calculateur » et « ordinateur », le titre de « premier ordinateur » peut être revendiqué par un grand nombre de machines dont le Z3. Mais le mot « ordinateur » a été créé par IBM en 1953 pour justement différencier les « calculateurs » et ses machines couplant une unité de calcul sur des données à une unité de contrôle pilotant les calculs en fonction des données, architecture dite de Von Neumann toujours en gros utilisée sur les ordinateurs en 2020. Trois étapes séparent le Z3 d'un ordinateur.
Le Z3 servit principalement à effectuer des calculs pour l'amélioration des profils aérodynamiques, en parallèle avec d'autres calculateurs de Konrad Zuse. Il fut détruit en 1944 par des bombardements alliés.
Konrad Zuse le conçut sur la base du système binaire inventé par Gottfried Wilhelm Leibniz. Il est probable que Zuse connaissait les travaux de George Boole sur l'algèbre binaire (« booléenne ») et de Claude Shannon, qui proposait d'appliquer cette algèbre aux relais téléphoniques, afin d'obtenir des machines logiques. Zuse eut des résultats semblables aux travaux de Charles Babbage, alors qu'il ne connut (voir discussion) ses travaux qu'après la fin de la guerre.
Konrad Zuse aurait pu être un artisan de l'évolution du calculateur vers l'ordinateur, mais cela n'a pas été le cas. Il n'était pas un scientifique recherchant les progrès pour tous, mais un ingénieur dans une logique de production et de profits. La publication dans des revues scientifiques ou les communications dans des congrès ne l'intéressaient pas et il travailla dans un total isolement intellectuel entre 1936 et 1945. Même durant la guerre, la communauté scientifique allemande ignorait ses travaux. Sa logique commerciale est confirmée par l'ensemble de sa carrière. Konrad Zuse était dans une démarche à l'opposé de celle des fondateurs de l'ordinateur comme Alan Turing ou John von Neumann, qui conceptualisaient et publiaient avant de passer aux applications.
Conséquence de ce manque de visibilité dans la communauté scientifique et du succès confidentiel de ses productions, Konrad Zuse ne fut pas, contrairement à la plupart des scientifiques allemands de qualité, « vivement invité » par les Russes ou les Américains à la fin de la guerre en 1945.
Son apport à la machine de guerre allemande fut surtout ses calculateurs spécialisés S1 et S2 développés pour l'Aerodynamische Versuchsanstalt (Institut de recherche aérodynamique). Il s'agissait de calculateurs spécialisés dans la correction aérodynamique des ailes des bombes à guidage Henschel Werke Hs 293 et Hs 294, développées par l'armée allemande entre 1941 et 1945. Ces bombes étaient les précurseurs des missiles V1.
Il conçut aussi le premier langage de haut niveau nommé Plankalkül, qu'il ne put utiliser faute de spécifications précises et d'une machine capable de le supporter. Ce langage resta ignoré de tous jusqu'à sa publication en 1972, plus de vingt ans après la sortie du Fortran (1950), beaucoup plus puissant et surtout effectivement implémentable. Ce langage ne fut opérationnel qu'en 2000, lorsqu'une équipe de l'université libre de Berlin en développa une implémentation à titre historique.
Selon ses dires, ses calculateurs S1 et S2 furent peut être récupérés par l'URSS en 1945. Il est donc possible que son travail ait profité aux premiers missiles russes.
Source Wikipédia: Konrad Zuse
Nelson Rolihlahla Mandela 1918-2013
 Nelson Rolihlahla Mandela, dont le nom du clan tribal est « Madiba », né le 18 juillet 1918 à Mvezo (province du Cap) et mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg (Gauteng), est un homme d'État sud-africain ; il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale (apartheid) avant de devenir président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des premières élections nationales non ségrégationnistes de l'histoire du pays.
Nelson Rolihlahla Mandela, dont le nom du clan tribal est « Madiba », né le 18 juillet 1918 à Mvezo (province du Cap) et mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg (Gauteng), est un homme d'État sud-africain ; il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale (apartheid) avant de devenir président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des premières élections nationales non ségrégationnistes de l'histoire du pays.
Nelson Mandela entre au Congrès national africain (ANC) en 1943, afin de lutter contre la domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale imposée par celle-ci. Devenu avocat, il participe à la lutte non-violente contre les lois de l'Apartheid, mises en place par le gouvernement du Parti national à partir de 1948. L'ANC est interdit en 1960 et, comme la lutte pacifique ne donne pas de résultats tangibles, Mandela fonde et dirige la branche militaire de l'ANC, Umkhonto we Sizwe, en 1961, qui mène une campagne de sabotage contre des installations publiques et militaires. Le 5 août 1962, il est arrêté par la police sud-africaine sur indication de la CIA, puis est condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité lors du procès de Rivonia. Dès lors, il devient un symbole de la lutte pour l'égalité raciale et bénéficie d'un soutien international croissant.
Après vingt-sept années d'emprisonnement dans des conditions souvent difficiles et après avoir refusé d'être libéré pour rester en cohérence avec ses convictions, Mandela est relâché le 11 février 1990. S'inspirant alors de la pensée ubuntu dans laquelle il a été élevé, il soutient la réconciliation et la négociation avec le gouvernement du président Frederik de Klerk. En 1993, il reçoit avec ce dernier le prix Nobel de la paix pour avoir conjointement et pacifiquement mis fin au régime de l'apartheid et jeté les bases d'une nouvelle Afrique du Sud démocratique.
Après une transition difficile où de Klerk et lui évitent une guerre civile entre les partisans de l'apartheid, ceux de l'ANC et ceux de l'Inkhata à dominante zoulou, Nelson Mandela devient le premier président noir d'Afrique du Sud en 1994. Il mène une politique de réconciliation nationale entre Noirs et Blancs ; il lutte contre les inégalités économiques, mais néglige le combat contre le sida, en pleine expansion en Afrique du Sud. Après un unique mandat, il se retire de la vie politique active, mais continue à soutenir publiquement le Congrès national africain tout en condamnant ses dérives.
Impliqué par la suite dans plusieurs associations de lutte contre la pauvreté ou contre le sida, il demeure une personnalité mondialement reconnue en faveur de la défense des droits de l'Homme. Il est salué comme le père d'une Afrique du Sud multiethnique et pleinement démocratique, qualifiée de « nation arc-en-ciel », même si le pays souffre d'inégalités économiques, de tensions sociales et de replis communautaires.
NDLR: La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Nelson Mandela
Perelman Grigori 1966-
 Grigori Iakovlevitch Perelman ( Григорий Яковлевич Перельман) est un mathématicien russe né le 13 juin 1966 à Léningrad. Il a travaillé sur le flot de Ricci, ce qui l'a conduit à établir en 2002 une démonstration de la conjecture de Poincaré du programme de Hamilton, un des problèmes fondamentaux des mathématiques contemporaines.
Grigori Iakovlevitch Perelman ( Григорий Яковлевич Перельман) est un mathématicien russe né le 13 juin 1966 à Léningrad. Il a travaillé sur le flot de Ricci, ce qui l'a conduit à établir en 2002 une démonstration de la conjecture de Poincaré du programme de Hamilton, un des problèmes fondamentaux des mathématiques contemporaines.
Son approche lui permit également de résoudre en 2003 la conjecture de géométrisation de Thurston, formulée en 1976, et plus générale que la conjecture de Poincaré.
Ancien chercheur à l'Institut de mathématiques Steklov de Saint-Pétersbourg, Grigori Perelman, par sa personnalité particulièrement discrète, a contribué à alimenter les débats sur ses travaux, qu'il a présentés à l'occasion d'une série de conférences données aux États-Unis en 2003.
Sa démonstration de la conjecture de Poincaré a été officiellement reconnue par la communauté mathématique, qui lui a décerné la médaille Fields le 22 août 2006 lors du congrès international des mathématiciens, et par l'Institut de mathématiques Clay, qui lui a décerné le prix du millénaire le 18 mars 2010.
Perelman a refusé la médaille Fields et le prix Clay.
Il avait déjà refusé le prix de la Société mathématique européenne en 1996.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Grigori Perelman
Rodolphe Chrétien Charles Diesel 1858-1913
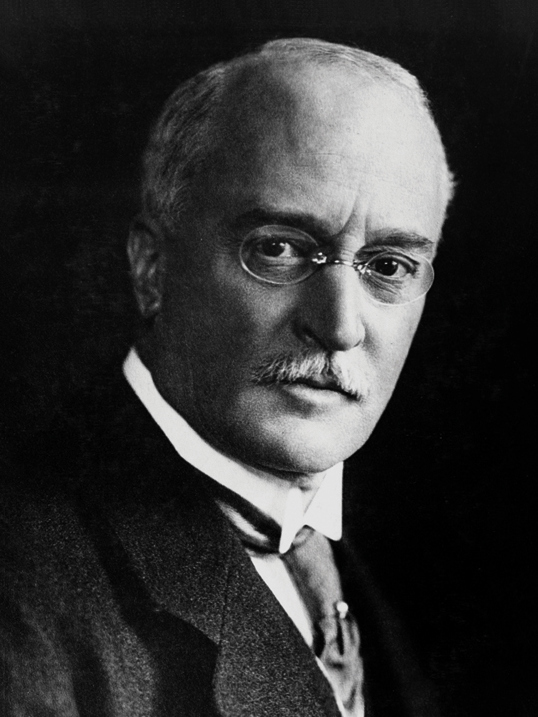 Rudolf Diesel (de son vrai nom Rodolphe Chrétien Charles Diesel, est un ingénieur allemand, né le 18 mars 1858 à Paris et disparu dans la nuit du 29 au 30 septembre 1913 lors d'une traversée de la mer du Nord.
Rudolf Diesel (de son vrai nom Rodolphe Chrétien Charles Diesel, est un ingénieur allemand, né le 18 mars 1858 à Paris et disparu dans la nuit du 29 au 30 septembre 1913 lors d'une traversée de la mer du Nord.
Rudolf Diesel est l'inventeur du moteur à combustion interne portant son nom, conçu pour fonctionner avec de l'huile végétale et non avec du gazole. Diesel nomma initialement ce moteur, le « moteur à l'huile ».
Rudolf Diesel est également un grand ingénieur thermicien, un connaisseur des arts, un linguiste et un théoricien social.
Les inventions de Diesel ont trois points communs : elles portent sur le transfert de chaleur par des procédés physiques naturels ou des lois, sont empreintes d'une forte marque créatrice de conception mécanique, et elles ont d'abord été motivées par l'inventeur du concept sociologique de besoin.
Le moteur Diesel fut conçu à l'origine comme une installation facilement adaptable aux coûts d'utilisation des combustibles disponibles localement, afin de permettre aux artisans indépendants de mieux supporter la concurrence des grandes industries, à cette époque pratiquement monopolisées par la principale source d'énergie : le charbon, le carburant du moteur à vapeur.
Rudolf Diesel disparaît mystérieusement en mer alors qu'il traverse la mer du Nord à bord du paquebot Dresden, entre Anvers et Harwich, quelques mois avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Rudolf Diesel
Victor Schœlcher 1843-1893
 Victor Schœlcher est un journaliste et homme politique français, né à Paris le 22 juillet 1804 et mort à Houilles le 25 décembre 1893. Il est connu pour avoir agi en faveur de l'abolition définitive de l'esclavage en France, via le décret d'abolition, signé par le gouvernement provisoire de la deuxième République le 27 avril 1848. Il est également député de la Martinique puis de la Guadeloupe.
Victor Schœlcher est un journaliste et homme politique français, né à Paris le 22 juillet 1804 et mort à Houilles le 25 décembre 1893. Il est connu pour avoir agi en faveur de l'abolition définitive de l'esclavage en France, via le décret d'abolition, signé par le gouvernement provisoire de la deuxième République le 27 avril 1848. Il est également député de la Martinique puis de la Guadeloupe.
Victor Schœlcher naît le 22 juillet 1804 à Paris (5e arrondissement ancien, aujourd'hui 10e arrondissement) au 60 rue du Faubourg-Saint-Denis, dans une famille catholique bourgeoise. Son père, Marc Schœlcher (1766-1832), originaire de Fessenheim (Haut-Rhin) en Alsace, est propriétaire d'une usine de fabrication de porcelaine. Sa mère, Victoire Jacob (1767-1839), originaire de Meaux (Seine-et-Marne), est marchande lingère à Paris au moment de son mariage.
Victor Schœlcher est baptisé à l'église Saint-Laurent de Paris le 9 septembre 1804.
Il fait de courtes études au lycée Condorcet, côtoyant les milieux littéraires et artistiques parisiens, faisant connaissance avec George Sand, Hector Berlioz et Franz Liszt.
Son père l'envoie au Mexique en 1828, aux États-Unis et à Cuba en 1828-1830 en tant que représentant commercial de l'entreprise familiale. Lorsqu'il est à Cuba, il est révolté par l'esclavage.
De retour en France, il devient journaliste et critique artistique, publiant des articles, des ouvrages, multipliant ses déplacements d'information.
Il adhère à la franc-maçonnerie, étant initié dans la loge parisienne « Les Amis de la Vérité » (Grand Orient de France), qui est à l'époque un atelier très fortement politisé, pour ne pas dire ouvertement révolutionnaire.
Il passe ensuite à une autre loge parisienne, « La Clémente Amitié ».
Il cesse toute activité maçonnique en 1844, lorsqu'il est radié par la chambre symbolique du Grand Orient de France, en compagnie de dix-sept autres frères de la loge « La Clémente Amitié », pour s'être opposé à la révision des statuts généraux de l'obédience et avoir soutenu le vénérable Bègue-Clavel.
Il revend rapidement la manufacture dont il hérite de son père en 1832 pour se consacrer à son métier de journaliste et ses activités philanthropiques.
NDLR : La suite sur Wikipédia. (Et ici, la suite est très importante. ;-)
Source Wikipédia: Victor Schœlcher
Wilhelm Conrad Röntgen 1845-1923
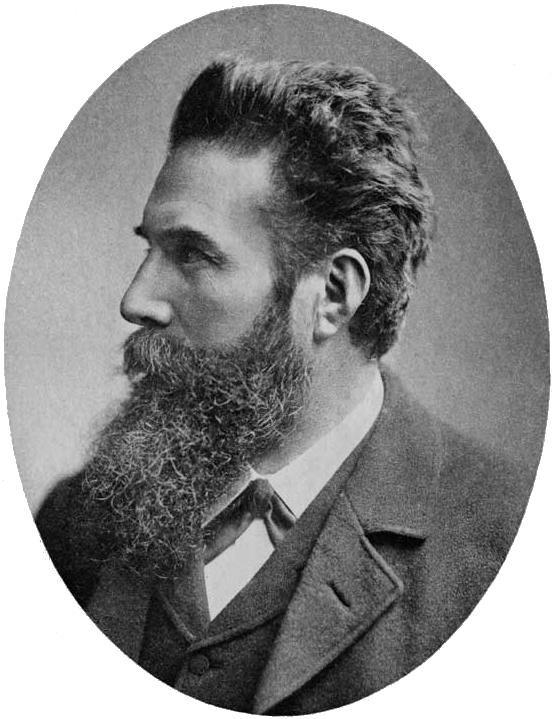 Wilhelm Conrad Röntgen est un physicien allemand, né le 27 mars 1845 à Lennep en Allemagne, et mort le 10 février 1923 à Munich.
Wilhelm Conrad Röntgen est un physicien allemand, né le 27 mars 1845 à Lennep en Allemagne, et mort le 10 février 1923 à Munich.
Il fait une grande partie de sa scolarité aux Pays-Bas avant d'entrer à l'École polytechnique fédérale de Zurich.
Il est successivement professeur de physique à Strasbourg (1876-1879), à Gießen (1879-1888), à Wurtzbourg (1888-1900) et à Munich (1900-1920).
Il découvre les rayons X en 1895, ce qui lui vaut de recevoir la médaille Rumford en 1896 et le premier prix Nobel de physique en 1901.
Fils unique de Friedrich Röntgen, manufacturier de textile et de Charlotte Constanze Frowein, il naît le 27 mars 1845 à Lennep, dans la commune actuelle de Remscheid (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne).
À 3 ans, sa famille déménage à Apeldoorn aux Pays-Bas, pays natal de sa mère, pour des raisons financières. Il entre à l'institut de Martinus Herman van Doorn, un pensionnat.
Bien qu'il ne semble posséder aucune aptitude particulière, il aime la nature et les promenades en forêts, il semble très doué pour fabriquer des mécanismes, prédisposition qu'il gardera toute sa vie.
En 1862, admis à l'école technique d'Utrecht, il en est expulsé : il est accusé d'être l'auteur d'une caricature d'un de ses professeurs. En 1865, il étudie la physique à l'université d'Utrecht.
Il n'a pas le niveau pour être étudiant régulier : il passe alors les examens d'entrée à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich pour étudier en ingénierie mécanique. L'enseignement de ses professeurs Kundt et Clausius va le marquer. En 1869, il soutient sa thèse de physique et devient l'assistant de Kundt. Il le suit à Wurtzbourg et trois ans plus tard à Strasbourg.
Le 19 janvier 1872 à Apeldoorn, il épouse Anna Bertha Ludwig (1839-1919), fille d'un cabaretier de Zürich qu'il avait rencontrée dans l'établissement tenu par son père.
Ils n’ont pas d'enfants mais adoptent en 1887 Josephine Bertha Ludwig, la fille âgée de 6 ans du frère d'Anna.
En 1874, il est maître de conférences à l'université de Strasbourg et en 1875, il est promu professeur à l'académie d'agriculture de Hohenheim dans le Bade-Wurtemberg. En 1876, il retourne à Strasbourg comme professeur de physique et trois ans plus tard il accepte la chaire de physique de l'université de Gießen.
En 1888, il est nommé professeur à l'Université de Wurtzbourg où il découvre les rayons X en 1895.
Le 1er avril 1900, sur proposition du gouvernement bavarois, il est nommé à la chaire de physique de l’université Louis-et-Maximilien de Munich, qu'il ne quittera plus.
En 1914, il fut un des signataires du Manifeste des 93 soutenant le militarisme de l'Empire allemand.
Quatre ans après le décès d'Anna, Röntgen meurt à son tour, le 10 février 1923, à Munich, d'un cancer de l'intestin, qui ne semble toutefois avoir aucun rapport avec ses activités scientifiques, Röntgen ayant été un des premiers à utiliser systématiquement des boucliers en plomb afin de se protéger de ces rayons.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Wilhelm Conrad Röntgen
William Brouncker 1620-1684
 William Brouncker, né à Castle Lyons (Irlande) en 1620 et décédé à Westminster en 1684, était un linguiste et mathématicien anglais.
William Brouncker, né à Castle Lyons (Irlande) en 1620 et décédé à Westminster en 1684, était un linguiste et mathématicien anglais.
Le vicomte William Brouncker, plus connu de nos jours sous le nom de Lord Brouncker, obtient un doctorat de philosophie à l'université d'Oxford en 1647. Il est l'un des fondateurs et le premier président de la Royal Society, en 1660.
En 1662, il devient chancelier de la reine Catherine, puis maître de l'hôpital Sainte-Catherine. Ses travaux mathématiques portent en particulier sur la rectification (mesure des longueurs) de la parabole et de la cycloïde ainsi que sur la quadrature (mesure des aires) de l'hyperbole. Il est le premier, en Angleterre, à s'intéresser aux fractions continues généralisées.
Source Wikipédia: William Brouncker
William Thomson (Lord Kelvin) 1824-1907
 1824 - 1907.jpg) William Thomson, mieux connu sous le nom de Lord Kelvin (Belfast, 26 juin 1824 - Largs, 17 décembre 1907), 1er baron Kelvin, est un physicien britannique d'origine irlandaise reconnu pour ses travaux en thermodynamique.
William Thomson, mieux connu sous le nom de Lord Kelvin (Belfast, 26 juin 1824 - Largs, 17 décembre 1907), 1er baron Kelvin, est un physicien britannique d'origine irlandaise reconnu pour ses travaux en thermodynamique.
Une des innovations de Kelvin est l'introduction d'un « zéro absolu » correspondant à l'absence absolue d'agitation thermique et de pression d'un gaz, dont il avait remarqué les variations liées selon un rapport linéaire.
Il a laissé son nom à l'échelle de température, dite absolue, ou température « thermodynamique », mesurée en kelvins.
Son titre de Lord Kelvin fait référence à la rivière du même nom, qui coule à proximité de son laboratoire à l'université de Glasgow.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: William_Thomson_(Lord_Kelvin)
Euclide - 300
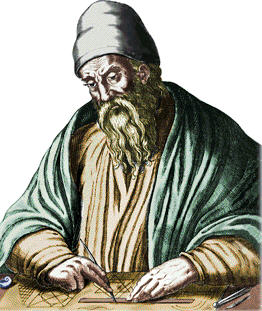 Euclide , dit parfois Euclide d'Alexandrie, est un mathématicien de la Grèce antique, auteur d’un traité de mathématiques, qui constitue l'un des textes fondateurs de cette discipline en Occident. Aucune information fiable n'est parvenue sur la vie ou la mort d'Euclide ; il est possible qu'il ait vécu vers 300 avant notre ère.
Euclide , dit parfois Euclide d'Alexandrie, est un mathématicien de la Grèce antique, auteur d’un traité de mathématiques, qui constitue l'un des textes fondateurs de cette discipline en Occident. Aucune information fiable n'est parvenue sur la vie ou la mort d'Euclide ; il est possible qu'il ait vécu vers 300 avant notre ère.
Son ouvrage le plus célèbre, les Éléments, est un des plus anciens traités connus présentant de manière systématique, à partir d'axiomes et de postulats, un large ensemble de théorèmes accompagnés de leurs démonstrations. Il porte sur la géométrie, tant plane que solide, et l’arithmétique théorique. L'ouvrage a connu des centaines d’éditions en toutes langues et ses thèmes restent à la base de l’enseignement des mathématiques au niveau secondaire dans de nombreux pays.
Du nom d’Euclide dérivent en particulier l’algorithme d'Euclide, la géométrie euclidienne, la géométrie non euclidienne et la division euclidienne.
Il n’existe aucune source directe sur la vie d’Euclide : nous ne disposons d’aucune lettre, d’aucune indication autobiographique (même sous la forme d’une préface à un ouvrage), d’aucun document officiel, et même d’aucune allusion par un de ses contemporains. Comme le résume l’historien des mathématiques Peter Schreiber, « sur la vie d’Euclide, pas un seul fait sûr n’est connu ».
L’écrit le plus ancien connu concernant la vie d’Euclide apparaît dans un résumé sur l’histoire de la géométrie écrit au ve siècle de notre ère par le philosophe néo-platonicien Proclus, commentateur du premier livre des Éléments. Proclus ne donne lui-même aucune source pour ses indications.
Il dit seulement qu'« en rassemblant ses Éléments, [Euclide] en a coordonné beaucoup […] et a évoqué dans d’irréfutables démonstrations ceux que ses prédécesseurs avaient montrés d’une manière relâchée. Cet homme a d’ailleurs vécu sous le premier Ptolémée, car Archimède […] mentionne Euclide. Euclide est donc plus récent que les disciples de Platon, mais plus ancien qu’Archimède et Ératosthène ». Si l'on admet la chronologie donnée par Proclus, Euclide, vivant entre Platon et Archimède et contemporain de Ptolémée Ier, a donc vécu vers 300 av. J.-C.
Aucun document ne vient contredire ces quelques phrases, ni les confirmer vraiment. La mention directe d’Euclide dans les œuvres d’Archimède vient d’un passage considéré comme douteux. Archimède fait bien appel à certains résultats des Éléments et un ostrakon, trouvé sur l’île Éléphantine et daté du IIIe siècle avant notre ère, traite de figures étudiées dans le livre XIII des Éléments, comme le décagone et l’icosaèdre, mais sans reproduire exactement les énoncés euclidiens ; ils pourraient donc provenir de sources antérieures à Euclide. La date approximative de 300 av. J.-C. est toutefois jugée compatible avec l’analyse du contenu de l’œuvre euclidienne et est adoptée par les historiens des mathématiques.
Par ailleurs, une allusion du mathématicien du IVe siècle de notre ère, Pappus d'Alexandrie, suggère que des élèves d’Euclide auraient enseigné à Alexandrie. Certains auteurs ont, sur cette base, associé Euclide au Mouseîon d'Alexandrie, mais, là encore, il ne figure sur aucun document officiel correspondant. Le qualificatif souvent associé à Euclide dans l’Antiquité est simplement stoichéiôtês (en grec ancien : στοιχειωτής), c’est-à-dire « auteur d’Éléments ».
Plusieurs anecdotes circulent à propos d’Euclide, mais comme elles apparaissent aussi pour d’autres mathématiciens, elles ne sont pas considérées comme réalistes : il en est ainsi de celle, célèbre, rapportée par Proclus, selon laquelle Euclide aurait répondu à Ptolémée — qui souhaitait une voie plus facile que celles des Éléments — qu’il n’y avait pas de voie royale en géométrie ;
une variante de la même anecdote est en effet attribuée à Ménechme et Alexandre le Grand.
De même, depuis l’Antiquité tardive, divers détails sont ajoutés aux récits de la vie d’Euclide, sans sources nouvelles, et souvent de manière contradictoire.
Certains auteurs font ainsi naître Euclide à Tyr, d’autres à Gela, on lui attribue diverses généalogies, des maîtres particuliers, différentes dates de naissance et de mort, que ce soit pour respecter les règles du genre, ou pour favoriser certaines interprétations.
Au Moyen Âge et au début de la Renaissance, le mathématicien Euclide est ainsi souvent confondu avec un philosophe contemporain de Platon, Euclide de Mégare.
Confronté à ces contradictions et au manque de sources fiables, l’historien des mathématiques Jean Itard a même suggéré en 1961 qu’Euclide en tant qu’individu n’existait peut-être pas et que le nom pouvait désigner « le titre collectif d’une école mathématique », soit celle d’un maître réel entouré d’élèves, soit même un nom purement fictif. Mais cette hypothèse ne semble pas retenue.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Euclide
Gabriel Lippmann 1845-1921
 Jonas Ferdinand Gabriel Lippmann, né le 16 août 1845 à Bonnevoie (Luxembourg) et mort le 12 juillet 1921 à bord du paquebot France, est un physicien franco-luxembourgeois. Il est lauréat du prix Nobel de physique de 1908 « pour sa méthode de reproduction des couleurs en photographie, basée sur le phénomène d'interférence ».
Jonas Ferdinand Gabriel Lippmann, né le 16 août 1845 à Bonnevoie (Luxembourg) et mort le 12 juillet 1921 à bord du paquebot France, est un physicien franco-luxembourgeois. Il est lauréat du prix Nobel de physique de 1908 « pour sa méthode de reproduction des couleurs en photographie, basée sur le phénomène d'interférence ».
Sa découverte permet la reconstitution intégrale de l’ensemble des longueurs d’onde réfléchies par un objet. Issu d'une famille française (père lorrain et mère alsacienne, tous deux juifs), Gabriel Lippmann naît à Bonnevoie (commune de Hollerich) au Luxembourg.
Il fait ses études à Paris, au lycée Napoléon (actuellement lycée Henri-IV), où Charles d'Alméida, son professeur de sciences physiques, lui donne le goût des sciences, puis à l'École normale supérieure, où il entre en 1868.
Élève brillant mais indiscipliné, il échoue au concours d'agrégation. Son parcours scolaire ne fut pas très réussi, parce qu'il s'est concentré seulement sur les disciplines qui l'intéressaient et a négligé les autres.
Il part alors en Allemagne, en 1872, pour une mission scientifique officielle et travaille avec Kühne (en) et Kirchhoff à Heidelberg et avec Helmholtz à Berlin.
Il commence alors ses recherches sur les phénomènes électrocapillaires.
Lippmann rentre à Paris au début de 1875, et, le 24 juillet, soutient devant la Faculté des sciences de Paris sa thèse pour le doctorat ès sciences intitulée Relations entre les phénomènes électriques et capillaires.
Sa thèse fit sensation et il rejoint alors en tant qu'attaché le laboratoire de recherches physiques de la faculté des sciences de Paris dirigé par Jules Jamin, jusqu'à sa nomination comme maître de conférences à la faculté des sciences de Paris en 1878.
En 1881, il prédit l'effet piézoélectrique inverse, un champ électrique appliqué à certaines faces de corps cristallisés produit une déformation de ce corps, un an après que les frères Curie eurent fait connaître l'effet direct.
En 1883, il est nommé professeur titulaire de la chaire de calcul des probabilités et de physique mathématique à la Faculté des sciences de Paris, succédant à Charles Briot, puis en 1886 professeur de physique générale et directeur du laboratoire des recherches physiques, à la mort de Jules Jamin.
La même année, il est élu à l’Académie des sciences, en remplacement de Paul Desains (G. Lippmann 31 voix, Henri Becquerel 20 voix), académie qu'il présida en 1912. Lippmann s'occupe du transfert du laboratoire des recherches physiques dans les nouveaux bâtiments de la Sorbonne. En 1893, on compte 25 chercheurs au sein du laboratoire, dont Émile Amagat, Anatole Leduc et Marie Curie.
Il est président d'honneur de la Société française de photographie de 1897 à 1899, succédant à Étienne-Jules Marey, et participe à la création de l'Institut d'optique théorique et appliquée (SupOptique).
Lippmann a travaillé dans de nombreux domaines comme l'électricité, la thermodynamique, l'optique et la photochimie. À Heidelberg, il a étudié le rapport entre les phénomènes électriques et les phénomènes capillaires.
Il est à l'origine de l'invention de l’électromètre capillaire, utilisé dans les premiers électrocardiographes, et du coelostat, instrument compensant la rotation de la Terre et permettant de photographier une région du ciel rendue apparemment fixe.
NDLR : La suite sur Wikipédia
Source Wikipédia: Gabriel Lippmann
George Paget Thomson 1892-1975
 George Paget Thomson (3 mai 1892 – 10 septembre 1975), est un physicien britannique.
George Paget Thomson (3 mai 1892 – 10 septembre 1975), est un physicien britannique.
Lui et Clinton Joseph Davisson sont colauréats du prix Nobel de physique de 1937 « pour leur découverte de la diffraction des électrons par les cristaux ». Il est aussi le fils du lauréat d'un prix Nobel de physique, J. J. Thomson.
Durant ses études, George Paget Thomson a pour ami et condisciple David Pinsent qu'il considère comme l' « esprit le plus brillant de ses années d'études ». Thomson étudia les mathématiques et la physique au Trinity College, jusqu'au début de la Première Guerre mondiale en 1914. Il rejoignit alors l'infanterie dans le Queen's Regiment of Infantry (en). Après un bref service en France, il travailla sur l'aérodynamique à Farnborough et ailleurs.
Après la guerre, Thomson suivit les pas de son père en travaillant à Cambridge puis à Aberdeen. Il obtint lui aussi le prix Nobel de physique, en 1937 avec Clinton Joseph Davisson, pour sa participation à la confirmation expérimentale des propriétés ondulatoires des électrons.
Là où son père avait vu l'électron comme une particule (et reçu le prix pour ses recherches), Thomson démontra que l'électron est sujet à la diffraction, comme une onde. Cette découverte confirme le principe de dualité onde-corpuscule proposé par Louis de Broglie en 1924.
À la fin des années 1930 et pendant la Seconde Guerre mondiale, Thomson se spécialisa en physique nucléaire, se concentrant sur les applications militaires pratiques. Pendant la guerre, travaillant à l'Imperial College de Londres, il fut ainsi le responsable anglais du projet Manhattan, c’est-à-dire le président de la commission des scientifiques anglais ayant participé à la mise au point la bombe atomique.
Dans son laboratoire pendant la guerre, il y fut réalisé la séparation, par la méthode de diffusion thermique, de l'isotope 235 de l'uranium.
Thomson sera aussi le président de la Commission technique de l'énergie atomique de l'ONU.
Par la suite, il continua son travail en physique nucléaire, mais fit aussi des recherches en aérodynamique et écrivit des textes sur la valeur de la science pour la société.
Il reçut la médaille Hughes en 1939 et la médaille royale en 1949.
Il a été professeur à Imperial College London jusqu'en 1952.
En 1952, Thomson devint directeur du Corpus Christi College à Cambridge. En 1964, le College donna son nom au bâtiment George Thomson Building.
Il a été fait chevalier le 2 juin 1943.
En 1924, Thomson épousa Kathleen Buchanan Smith, fille de George Adam Smith. Ils eurent quatre enfants, deux fils et deux filles. Kathleen mourut en 1941.
Source Wikipédia: George Paget Thomson
Heinrich Hertz 1857-1894
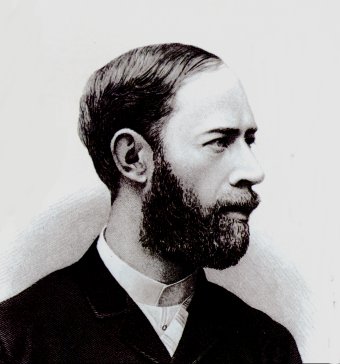 Heinrich Hertz, né le 22 février 1857 à Hambourg et mort le 1er janvier 1894 à Bonn, est un ingénieur et physicien allemand renommé pour avoir découvert les ondes hertziennes auxquelles il a donné son nom.
Heinrich Hertz, né le 22 février 1857 à Hambourg et mort le 1er janvier 1894 à Bonn, est un ingénieur et physicien allemand renommé pour avoir découvert les ondes hertziennes auxquelles il a donné son nom.
C'est en son honneur que l'unité internationale de fréquence (s−1) a été appelée hertz (Hz).
Fils de David Gustav Hertz, écrivain et sénateur, et d'Anntz, il étudie à l'école du docteur Richard Lange de 1863 à 1872. Ayant étudié auprès de précepteurs, il est bachelier en mars 1875. Il se rend alors à Francfort pour y travailler un an au service des Travaux publics.
En 1877, il est étudiant à l'Institut polytechnique de Dresde avant de s'inscrire en 1878 à l'université de Munich. Entretemps il effectue son service militaire à Berlin.
En 1879, il est l'élève de Gustav Kirchhoff et Hermann von Helmholtz à l'Institut de physique de Berlin. Il devient maître de conférence à l'université de Kiel en 1883 où il effectue des recherches sur l'électromagnétisme.
En 1885, il est professeur à l'École polytechnique de Karlsruhe et se marie l'année suivante avec Elisabeth Doll.
Il travaille par la suite sur les théories de Maxwell, Weber et Helmholtz.
En 1887, il réalise un oscillateur. Le 15 mars 1888, il découvre les ondes électromagnétiques dans l'air.
À la suite de sa découverte sur les ondes hertziennes, Hertz la présente devant une assemblée d'étudiants. À la question de l'un d'entre eux qui lui demande s'il y a des applications de ces ondes, Hertz répond qu'il n'y en a aucune.
À partir de 1889, il est professeur et chercheur à Bonn et, en 1890, il est lauréat de la médaille Rumford.
Atteint de la maladie de Wegener (granulomatose avec polyangéite), il meurt le 1er janvier 1894 à Bonn et est enterré au cimetière juif de Hambourg.
Le 1er juin 1894, le physicien Oliver Lodge prononce une conférence rendant hommage aux découvertes de Hertz : à cette occasion, il présente une expérience montrant la nature quasi-optique des ondes « hertziennes » (qui sont les ondes radio), et montre qu'on peut les capter à plus de 50 mètres.
Le physicien italien Guglielmo Marconi reprend les travaux de Hertz en 1895 à la Villa Griffone près de Bologne puis à Salvan dans les Alpes suisses, améliore le télégraphe en fabriquant le premier émetteur sans fil.
Ce procédé est constamment amélioré jusqu'à la téléphonie mobile d'aujourd'hui, ainsi que la majorité des télétransmissions sans fil actuelles.
Hertz fait sa thèse de doctorat de physique sous la direction de Hermann von Helmholtz. C'est en tentant de relier les interférences formées entre deux lentilles de verre qu'il recherche les déformations de deux corps sphériques mis en contact avec une force donnée, en supposant leur comportement linéaire élastique.
Il résout analytiquement cette question pendant les vacances4 de Noël 1880, et publie ses résultats en 1881.
Le problème du contact élastique de deux sphères (« contact de Hertz ») reste à ce jour un résultat classique de tribologie. Il trouve de nombreuses applications, particulièrement dans les tests de dureté par indentation.
Mais sa contribution essentielle à la physique demeure la vérification expérimentale en 1887 de la théorie de James Clerk Maxwell de 1864, selon laquelle la lumière est une onde électromagnétique.
C'est à Karlsruhe qu'à l'aide d'un oscillateur (dit oscillateur de Hertz, composé d'un éclateur agissant entre deux sphères creuses en laiton) il met en évidence l'existence d'autres ondes électromagnétiques, celles-là non visibles.
Il démontre que ces nouvelles ondes, susceptibles elles aussi de se diffracter, de se réfracter et de se polariser, se propagent à la même vitesse que la lumière.
Le 13 novembre 1886, il effectue la première liaison par faisceau hertzien entre un émetteur et un récepteur. Ces résultats ouvrent la voie à la télégraphie sans fil et à la radiodiffusion.
Pour cette raison, les ondes radio sont dites « ondes hertziennes », et l'unité S.I. de mesure des fréquences est le hertz (nom en minuscule car il s'agit d'une unité de mesure, en revanche le symbole est « Hz »).
Hertz découvre en 1886 la photoélectricité : une plaque de métal étant soumise à une lumière émet des électrons, dont la quantité dépend entre autres de l'intensité lumineuse.
Son assistant Wilhelm Hallwachs poursuit les recherches dans ce domaine, découvrant en 1887 « l'effet Hallwachs », qui doit jouer un rôle central dans l'hypothèse des quantas de lumière formulée par Albert Einstein en 1905.
Source Wikipédia: Heinrich Hertz
Hermann von Helmholtz 1821-1894
 Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz est un scientifique (physiologiste et physicien) prussien, né le 31 août 1821 à Potsdam et mort à Berlin-Charlottenburg en 1894. Il a notamment apporté d'importantes contributions à l'étude de la perception des sons et des couleurs ainsi qu'à la thermodynamique.
Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz est un scientifique (physiologiste et physicien) prussien, né le 31 août 1821 à Potsdam et mort à Berlin-Charlottenburg en 1894. Il a notamment apporté d'importantes contributions à l'étude de la perception des sons et des couleurs ainsi qu'à la thermodynamique.
Après ses études à l’École de médecine militaire Frédéric-Guillaume sous la direction de Johannes Müller, il commença sa carrière comme médecin militaire et devint ensuite professeur d'anatomie et de physiologie, puis professeur de physique à Berlin en 1871.
« Son enseignement l'ennuyait autant que nous », écrira un ancien élève, le physicien Max Planck, qui devint son collègue, en prenant la chaire de physique théorique à Berlin, appréciant essentiellement l'homme et le savant.
Helmholtz a vécu à une époque propice à développer l’expérimentation grâce à un arsenal d’instruments de plus en plus performants, qui prolongent, démultiplient, amplifient, accélèrent le regard des scientifiques sur la nature des phénomènes (et dans ce cas précis, des phénomènes sonores) pour mettre en évidence les explications de certaines observations : la technique a permis de transcrire sous une forme objective des phénomènes inexpliqués ; ainsi, l’acoustique progresse considérablement et Helmholtz fonde l'optique physiologique et la psychophysique.
En Physique il définit l'énergie potentielle, formulation du principe de conservation de l'énergie, il propose l'équation de Helmholtz en mécanique des fluides, et en optique géométrique la « Loi de Lagrange-Helmholtz » …
En Chimie : théorème de Gibbs-Helmholtz (thermochimie).
Source Wikipédia: Hermann_von_Helmholtz
James Clerk Maxwell 1831-1879
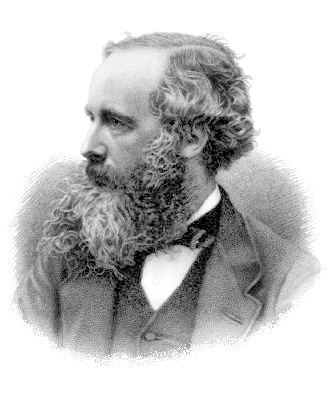 James Clerk Maxwell (13 juin 1831 à Édimbourg en Écosse - 5 novembre 1879 à Cambridge en Angleterre) est un physicien et mathématicien écossais.
James Clerk Maxwell (13 juin 1831 à Édimbourg en Écosse - 5 novembre 1879 à Cambridge en Angleterre) est un physicien et mathématicien écossais.
Il est principalement connu pour avoir unifié en un seul ensemble d'équations, les équations de Maxwell, l'électricité, le magnétisme et l'induction, en incluant une importante modification du théorème d'Ampère. Ce fut à l'époque le modèle le plus unifié de l'électromagnétisme. Il est également célèbre pour avoir interprété, dans un article en quatre parties publié dans Philosophical Magazine intitulé On Physical Lines of Force, la lumière comme étant un phénomène électromagnétique en s'appuyant sur les travaux de Michael Faraday.
Il a notamment démontré que les champs électriques et magnétiques se propagent dans l'espace sous la forme d'une onde et à la vitesse de la lumière.
Ces deux découvertes permirent d'importants travaux ultérieurs notamment en relativité restreinte et en mécanique quantique.
Il a également développé la distribution de Maxwell, une méthode statistique de description de la théorie cinétique des gaz.
Maxwell est considéré par de nombreux physiciens comme le scientifique du XIXe siècle ayant eu le plus d'influence au XXe siècle.
Ses contributions à la science sont considérées par certains comme aussi importantes que celles d'Isaac Newton ou d'Albert Einstein. En 1931, pour le centenaire de la naissance de Maxwell, Einstein lui-même décrivait les travaux de Maxwell comme les « plus profonds et fructueux que la physique ait connus depuis le temps de Newton ».
Il est également connu pour avoir réalisé le 17 mai 1861 la première photographie en vraie couleur devant les membres de la Royal Institution de Londres.
James Clerk Maxwell est né le 13 juin 1831 au 14 India Street à Édimbourg, de John Clerk Maxwell, avocat et de Frances Maxwell (née Cay).
Le père de Maxwell était un homme aisé apparenté à la famille Clerk de Penicuik (Midlothian), détenteurs de la baronnie Clerk (en) ; son frère en était le sixième baronnet.
Il est né John Clerk, ajoutant lui-même le surnom Maxwell après avoir hérité d'une propriété de campagne à Middlebie (en) (Kirkcudbrightshire) par une connexion avec la famille Maxwell, elle-même membre de la pairie.
Les parents de Maxwell ne se sont pas rencontrés ni mariés avant d'être entrés dans la trentaine, ce qui était rare à l'époque, et sa mère avait près de quarante ans quand il est né.
Ils avaient précédemment eu une fille morte en bas âge. Ses parents appellent leur unique enfant survivant James, un prénom non seulement porté par son grand-père mais aussi par beaucoup de ses aïeux.
L'enfant est élevé dans la religion protestante.
Quand Maxwell est encore jeune, sa famille déménage à Glenlair, une maison de ses parents construite sur la propriété de 1 500 acres (6,1 km2) de Middlebie.
Toutes les indications concordent pour dire que Maxwell avait une curiosité inextinguible dès le plus jeune âge.
À trois ans, tout ce qui bougeait, brillait ou faisait du bruit amenait la question : « À quoi ça sert ? ». Dans une lettre à sa belle-sœur Jane Cay en 1834, son père décrivait sa curiosité intellectuelle innée : « C'est un garçon heureux et il se porte beaucoup mieux depuis que le temps est meilleur ; il est très occupé avec les portes, serrures, clés etc. et « montre moi comment ça marche » ne quitte jamais sa bouche ».
NDLR : La suite sur Wikipédia…et la suite est très longue…bonne lecture.
Source Wikipédia: James Clerk Maxwell
Léonard de Vinci 1452-1519
 Léonard de Vinci, dit Leonardo da Vinci, né le 15 avril 1452 à Vinci (Toscane) et mort le 2 mai 1519 à Amboise (Touraine), est un peintre italien et un homme d'esprit universel, à la fois artiste, organisateur de spectacles et de fêtes, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, peintre, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain.
Léonard de Vinci, dit Leonardo da Vinci, né le 15 avril 1452 à Vinci (Toscane) et mort le 2 mai 1519 à Amboise (Touraine), est un peintre italien et un homme d'esprit universel, à la fois artiste, organisateur de spectacles et de fêtes, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, peintre, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain.
Après son enfance à Vinci, Léonard est élève auprès du célèbre peintre et sculpteur florentin Andrea del Verrocchio. Ses premiers travaux importants sont réalisés au service du duc Ludovic Sforza à Milan. Il œuvre ensuite à Rome, Bologne et Venise et passe les trois dernières années de sa vie en France, à l'invitation du roi François Ier.
Léonard de Vinci est souvent décrit comme l’archétype et le symbole de l’homme de la Renaissance, un génie universel, un philosophe humaniste, observateur et expérimentateur, avec un « rare don de l’intuition de l’espace », et dont la curiosité infinie est seulement égalée par la force d’invention.
C'est d'abord comme peintre que Léonard de Vinci est reconnu. Deux de ses œuvres, La Joconde et La Cène, sont des peintures mondialement célèbres, souvent copiées et parodiées, et son dessin de l’Homme de Vitruve est également repris dans de nombreux travaux dérivés. Seule une quinzaine de tableaux sont parvenus jusqu'à nous.
Ce petit nombre est notamment dû à ses expérimentations constantes et parfois désastreuses de nouvelles techniques. Néanmoins, ces quelques œuvres, jointes à ses carnets contenant plus de 6 000 pages de notes, dessins, documents scientifiques et réflexions sur la nature de la peinture (rassemblés en dix Codex pour la plupart publiés au XIXe siècle), sont un legs aux générations d'artistes qui lui ont succédé.
Comme ingénieur et inventeur, Léonard développe des idées très en avance sur son temps, des prototypes d'avion, d'hélicoptère, de sous-marin et même d'automobile.
Très peu de ses projets sont réalisés ou même seulement réalisables de son vivant, mais certaines de ses plus petites inventions comme une machine pour mesurer la limite élastique d'un câble entrent dans le monde de la manufacture.
En tant que scientifique, Léonard de Vinci a consacré une grande partie de sa vie à l'étude de l'anatomie, du génie civil, de l'optique et de l'hydrodynamique, mais sans véritablement partager ses connaissances.
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Léonard de Vinci
Martin Luther King Jr 1929-1968
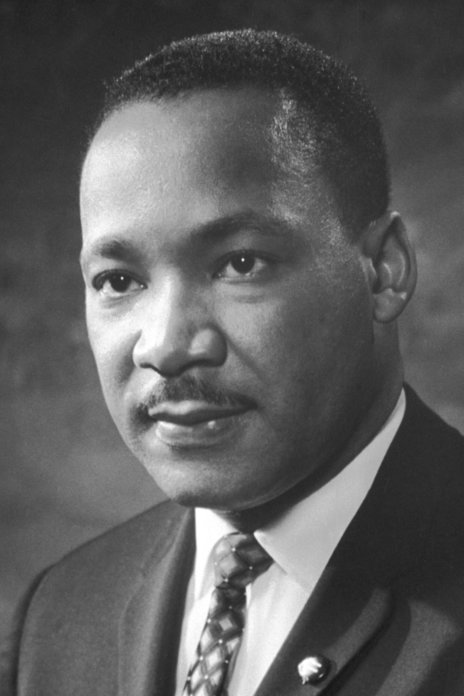 Martin Luther King Jr., plus couramment appelé Martin Luther King, né à Atlanta, en Géorgie, le 15 janvier 1929, et mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, dans le Tennessee, est un pasteur, baptiste et militant non-violent afro-américain pour le mouvement des droits civiques des noirs américains aux États-Unis, fervent militant pour la paix et contre la pauvreté.
Martin Luther King Jr., plus couramment appelé Martin Luther King, né à Atlanta, en Géorgie, le 15 janvier 1929, et mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, dans le Tennessee, est un pasteur, baptiste et militant non-violent afro-américain pour le mouvement des droits civiques des noirs américains aux États-Unis, fervent militant pour la paix et contre la pauvreté.
Il organise et dirige des actions telles que le boycott des bus de Montgomery pour défendre le droit de vote, la déségrégation et l'emploi des minorités ethniques.
Il prononce un discours célèbre le 28 août 1963 devant le Lincoln Memorial à Washington, D.C. durant la marche pour l'emploi et la liberté : il s'intitule « I have a dream ».
Ce discours est soutenu par John Fitzgerald Kennedy dans la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis ; le président Lyndon B. Johnson par une plaidoirie infatigable auprès des membres du Congrès arrivera à faire voter différentes lois fédérales comme le Civil Rights Act de 1964, le Voting Rights Act de 1965 et le Civil Rights Act de 1968 mettant juridiquement fin à toutes les formes de ségrégation raciale sur l'ensemble des États-Unis.
Martin Luther King devient le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix en 1964 pour sa lutte non-violente contre la ségrégation raciale et pour la paix.
Il commence alors une campagne contre la guerre du Viêt Nam et la pauvreté, qui prend fin en 1968 avec son assassinat officiellement attribué à James Earl Ray, dont la culpabilité et la participation à un complot sont toujours débattues.
Il se voit décerner à titre posthume la médaille présidentielle de la Liberté par Jimmy Carter en 1977, le prix des droits de l'homme des Nations unies en 1978, la médaille d'or du Congrès en 2004, et est considéré comme l'un des plus grands orateurs américains.
Depuis 1986, le Martin Luther King Day est un jour férié aux États-Unis. Deux centres Martin Luther King pour l'action non-violente existent, l'un en Suisse à Lausanne et l'autre à Atlanta.
De nombreux autres monuments (musées, écoles) sont répertoriés sous le nom de Martin Luther King partout dans le monde.
NDLR :
- La suite sur Wikipédia.
- Attention de ne pas confondre avec Martin Luther 1483 - 1546
Source Wikipédia: Martin Luther King
Max Born 1882-1970
 Max Born (11 décembre 1882 à Breslau, Empire allemand - 5 janvier 1970 à Göttingen, Allemagne de l'Ouest) est un physicien allemand.
Max Born (11 décembre 1882 à Breslau, Empire allemand - 5 janvier 1970 à Göttingen, Allemagne de l'Ouest) est un physicien allemand.
Physicien théoricien remarquable, il est principalement connu pour son importante contribution à la physique quantique. Il a été le premier à donner au carré du module de la fonction d'onde la signification d'une densité de probabilité de présence.
Il a partagé le prix Nobel de physique de 1954, avec Walther Bothe, pour ses travaux sur la théorie des quanta.
Fils d'un professeur de médecine et orphelin de mère depuis l'âge de 4 ans, Max Born entame des études de sciences en 1901 à Breslau, qu'il poursuit ensuite à Zurich et Heidelberg, avant d'arriver à Göttingen où il prépare une thèse sur la Stabilité des lignes élastiques dans le plan et dans l'espace, soutenue en 1906.
Il participe aux travaux sur la nouvelle théorie de la relativité restreinte, avec Hermann Minkowski ; puis sur la dynamique des atomes dans les cristaux, sur laquelle il publie un livre en 1915. Il est réformé pour cause d'asthme pendant la Première Guerre mondiale, qu'il passe en partie à Berlin ; il y travaille notamment avec Max Planck et Albert Einstein.
En 1921, il est nommé professeur de physique théorique à Göttingen. Il concentre surtout ses travaux sur la physique quantique et développe, avec Pascual Jordan, la mécanique matricielle introduite par Werner Heisenberg. Il est également un pionnier de la théorie quantique des solides (conditions de Born-Von Karman) et dans l'électrodynamique non linéaire de Born-Infeld.
D'origine juive, il doit émigrer en Grande-Bretagne à l'avènement du Troisième Reich, d'abord à Cambridge en 1933, puis à Édimbourg où il devient professeur en 1936. Il fera néanmoins son retour en Allemagne, pour s'établir à Göttingen, en 1953.
La Royal Society lui décerne la Médaille Hughes en 1950. Il est lauréat de la moitié du prix Nobel de physique de 1954 (l'autre moitié a été remise à Walther Bothe) « pour ses recherches fondamentales en mécanique quantique, particulièrement pour son interprétation statistique de la fonction d'onde ».
Il est l'un des onze signataires du manifeste Russell-Einstein qui met en lumière les dangers créés par les armes nucléaires et appelle les principaux dirigeants du monde à rechercher des solutions pacifiques aux conflits internationaux. Il fait partie des 18 de Göttingen.
Il est le grand-père maternel de Olivia Newton-John. Son épouse est décédée en 1972.
Source Wikipédia: Max_Born
Michael Faraday 1791-1867
 Michael Faraday (Newington, 22 septembre 1791 - Hampton Court, 25 août 1867) est un physicien et un chimiste britannique, connu pour ses travaux fondamentaux dans le domaine de l'électromagnétisme, l'électrochimie, le diamagnétisme, et l'électrolyse.
Michael Faraday (Newington, 22 septembre 1791 - Hampton Court, 25 août 1867) est un physicien et un chimiste britannique, connu pour ses travaux fondamentaux dans le domaine de l'électromagnétisme, l'électrochimie, le diamagnétisme, et l'électrolyse.
Il donne son nom à de multiples lois et phénomènes dans ces domaines, notamment la loi de Faraday (ou Lenz-Faraday) en induction électromagnétique, les lois de Faraday en électrochimie, l'effet Faraday, ou encore à des dispositifs expérimentaux comme la cage de Faraday et la cavité de Faraday. Le farad, unité de capacité électrique, est également nommée en son honneur.
Michael Faraday naît le 22 septembre 1791, à Newington Butts, une bourgade du Surrey (Angleterre), aujourd'hui intégrée dans le grand Londres. Sa famille, pauvre, appartient à une secte, les sandemaniens, issus de l'Église d'Écosse.
Son père, James Faraday, a été le forgeron du village de Outhgill dans le Westmorland, d’où il a émigré vers 1790. Le jeune Michael, issu d’une fratrie de quatre enfants, ne reçoit qu’une éducation primaire, principalement du fait que ses capacités n'étaient pas conformes au système scolaire, très rigide, de cette époque (il ne parvenait pas à répéter simplement des choses comme on lui demandait, il n'en comprenait pas l'intérêt).
Dès l'âge de 14 ans, il est apprenti auprès de George Riebau, un libraire-relieur et fait preuve de grands talents manuels et de curiosité : « apprenti, j'adorais lire les livres scientifiques qui me tombaient sous la main ».
Parmi ceux-ci, mentionnons le livre d'Isaac Watts, L’amélioration de l’esprit, dont il tirera les « six principes de Faraday » et les livres de vulgarisation scientifiques de Jane Marcet, dont Conversations sur la chimie.
En 1812, un des clients de la librairie lui offre des places pour assister à des conférences de chimie du chimiste Sir Humphry Davy, membre de la Royal Institution et de la Royal Society. Faraday est très vite impressionné et fasciné par les travaux que mène Davy auquel il écrit, joignant à sa lettre un livre de 300 pages basé sur les notes prises lors des conférences. À la suite d'un accident de laboratoire, Davy est blessé à l’œil gauche et fait appel au jeune Faraday, fin 1812, pour lui servir de secrétaire.
Le 22 février 1813, à la suite d'une violente dispute avec un collègue, William Payne, assistant de laboratoire de la Royal Institution, est licencié. Faraday est embauché pour le remplacer à compter du 1er mars 1813.
Le 2 juin 1821, Michael Faraday se marie avec Sarah Barnard (1800-1879), rencontrée à l'église glasite, mariage resté sans enfant.
Il est élu à la Royal Society en 1824, et nommé directeur du laboratoire de cette institution en 1825. En juin 1832, l'université d'Oxford le nomme docteur honoris causa en droit civil. S'il accepte ce titre honoraire et universitaire, Faraday rejettera son anoblissement au titre de chevalier et refusera par deux fois l'honneur de devenir président de la Royal Society.
En 1833, il est le premier titulaire de la chaire fullerienne de chimie (Fullerian professorship) à la Royal Institution, sans obligation d'enseigner.
Ses problèmes de mémoire de plus en plus nombreux ne l'empêchent pas de continuer son travail, de tout noter et de faire de remarquables découvertes.
En 1848, sur proposition du prince-consort, Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, Michael Faraday se voit attribuer une maison dans Hampton Court, libre de toute servitude.
Cette maison, connue comme étant celle du maître-maçon, est plus tard appelée Faraday House, et se trouve au numéro 37, dans Hampton Court Road.
En 1858, Faraday prend sa retraite et l'habite définitivement.
C'est là qu'il meurt, le 25 août 1867. Fondamentalement modeste, il avait refusé d'être enterré dans l'abbaye de Westminster (où une plaque, non loin de la tombe d'Isaac Newton, célèbre néanmoins sa mémoire) et sa tombe se trouve au cimetière de Highgate à Londres.
Source Wikipédia: Michael Faraday
Philipp Lenard 1862-1947
 Philipp Eduard Anton von Lenard (7 juin 1862 à Presbourg - 20 mai 1947 à Messelhausen, Allemagne) est un physicien allemand d'origine austro-hongroise. Il a obtenu le prix Nobel de physique de 1905. Il a aussi été un des promoteurs de la Deutsche Physik (en) pendant le régime nazi, idéologie à laquelle il avait adhéré.
Philipp Eduard Anton von Lenard (7 juin 1862 à Presbourg - 20 mai 1947 à Messelhausen, Allemagne) est un physicien allemand d'origine austro-hongroise. Il a obtenu le prix Nobel de physique de 1905. Il a aussi été un des promoteurs de la Deutsche Physik (en) pendant le régime nazi, idéologie à laquelle il avait adhéré.
Philipp Lenard est né le 7 juin 1862 à Preßburg, en Autriche-Hongrie (aujourd'hui Bratislava), d'une famille venant du Tyrol.
Lenard a étudié à Budapest, Vienne, Berlin et Heidelberg, notamment sous la direction de Bunsen et Helmholtz. Il a obtenu son doctorat en 1886 à l'université de Heidelberg.
Il est nommé privat-docent et assistant de Heinrich Hertz à l'université de Bonn de 1892 à 1894. Il est d'abord professeur non titulaire dans divers établissements : université de Breslau (1894-95), puis professeur de physique à l’université d'Aix-la-Chapelle (1895-1896). Il est ensuite nommé professeur de physique théorique à l'université de Heidelberg de 1896 à 1898, et enfin professeur titulaire de l'université de Kiel en 1898. Il y reste jusqu'en 1907, avant de revenir à l'université de Heidelberg.
• Les rayons cathodiques : Lenard est un expérimentateur connu pour ses contributions à l'étude des rayons cathodiques. Avant lui ces rayons étaient produits dans des tubes de Crookes en simple verre, sous vide partiel et munis d'électrodes métalliques, auxquelles on appliquait une forte tension. Les rayons ne pouvant pas sortir de ces tubes, ils étaient difficiles à étudier. Lenard réussit à ajouter aux tubes des plaques de métal laissant ressortir ces rayons, ce qui lui a permis de les étudier.
En 1896, Il reçoit la Médaille Rumford de la Royal Society, et en 1905 le prix Nobel de physique « pour ses recherches sur les rayons cathodiques ». Il est lauréat de la médaille Franklin en 1932 pour ses travaux sur la photoélectricité.
• L'effet Lenard : Lenard a montré que si une goutte d'eau pure tombe sur une surface et éclabousse, un phénomène de séparation de l'électricité portée par l'eau a lieu, l'eau conservant une charge positive alors que l'air acquiert une charge négative. Cet effet, s'il n'est pas pris en compte peut induire un biais dans certaines mesures.
Selon George C Simpson, dans le journal de la Royal Society (1909) réétudie de manière plus moderne (mesures automatisées), la charge positive sur l'eau peut être mesurée. Si l'éclaboussures ne se produit pas sur une surface dure, mais sur de l'eau, ou au fond d'un pluviomètre profond en forme de cuve plutôt que d'entonnoir (et non ventilée artificiellement), cette séparation n'a pas lieu.
Lenard accuse publiquement Wilhelm Röntgen, prix Nobel de physique en 1901 pour sa découverte des rayons X, et Joseph Thomson, prix Nobel de physique en 1906 pour sa découverte de l'électron, de s'être appropriés une partie de son travail.
Ses relations avec Albert Einstein sont d'abord mutuellement respectueuses : celui-ci estime Lenard comme un expérimentateur de talent, et Lenard considère Einstein comme un grand théoricien, qualifiant dans une lettre de 1909 la théorie de l'effet photoélectrique comme « remarquable parmi ses théories ».
Mais ces relations prennent une autre tournure avec la Première Guerre mondiale. Einstein est pacifiste et pro-européen, alors que Lenard est nationaliste. Selon la fondation Nobel, Lenard ne pardonne pas à Einstein « d'avoir découvert et associé son propre nom à l'effet photoélectrique ». Enfin, Einstein est Juif et Lenard antisémite.
Lenard deviendra un fervent détracteur d'Einstein, « représentant le plus marquant » de la « physique juive », qui « voulait révolutionner et dominer l'ensemble de la physique ».
Nationaliste, il fut un des signataires du Manifeste des 93 en 1914. Dans les années 1930, il rejoint le NSDAP, et devient un idéologue de la physique « aryenne » ou « allemande ».
À ce titre, il a, entre autres, vilipendé Albert Einstein, attribuant à Friedrich Hasenöhrl la formule E=mc2 pour en faire une création aryenne. Selon une citation de Johannes Stark, il a notamment déclaré, s'exprimant sur « la puissante influence juive sur les affaires, l'économie, la politique, la presse et l'Université », C'est exactement pour cette raison que les Juifs doivent être engloutis au plus profond de la terre.
Il a été démis de ses fonctions à l'université de Heidelberg lors du processus de dénazification en 1945. Il est mort deux ans après.
Source Wikipédia: Philipp Lenard
Polykarp Kusch 1911-1993
 Polykarp Kusch (26 janvier 1911 - 20 mars 1993) est un physicien germano-américain.
Polykarp Kusch (26 janvier 1911 - 20 mars 1993) est un physicien germano-américain.
Il a reçu une moitié du prix Nobel de physique de 1955 « pour sa détermination précise du moment magnétique de l'électron ».
Licencié en physique à l'Institut de technologie Case en 1931 (aujourd'hui université Case Western Reserve), il a obtenu son master of Science en 1933 et son doctorat en 1936, à l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign.
Il a été longtemps professeur à l'université Columbia, à New York, puis à l'université du Texas à Dallas.
En 1955, il a obtenu la moitié du prix Nobel de physique (l'autre moitié a été remise à Willis Eugene Lamb) pour avoir déterminé le moment magnétique de l'électron, une découverte à l'origine de nombreux progrès en électrodynamique quantique.
Source Wikipédia: Polykarp Kusch
Pythagore de - 580 à - 495
 Pythagore est un réformateur religieux et philosophe présocratique qui serait né aux environs de 580 av. J.-C. à Samos, une île de la mer Égée au sud-est de la ville d'Athènes ; on établit sa mort vers 495 av. J.-C., à l'âge de 85 ans. Il aurait été également mathématicien et scientifique selon une tradition tardive.
Pythagore est un réformateur religieux et philosophe présocratique qui serait né aux environs de 580 av. J.-C. à Samos, une île de la mer Égée au sud-est de la ville d'Athènes ; on établit sa mort vers 495 av. J.-C., à l'âge de 85 ans. Il aurait été également mathématicien et scientifique selon une tradition tardive.
Le nom de Pythagore (étymologiquement, Pyth-agoras : « celui qui a été annoncé par la Pythie »), découle de l'annonce de sa naissance faite à son père lors d'un voyage à Delphes.
La vie énigmatique de Pythagore permet difficilement d'éclaircir l'histoire de ce réformateur religieux, mathématicien, philosophe et thaumaturge.
Il n’a jamais rien écrit, et les soixante et onze lignes des Vers d’Or qu'on lui attribue sont apocryphes et sont le signe de l'immense développement de la légende formée autour de son nom.
Le néopythagorisme est néanmoins empreint d'une mystique des nombres, déjà présente dans la pensée de Pythagore. Hérodote le mentionne comme « l'un des plus grands esprits de la Grèce, le sage Pythagore ». Il conserve un grand prestige ; Hegel disait qu'il était « le premier maître universel ».
NDLR : La suite sur Wikipédia.
Source Wikipédia: Pythagore
Rosalind Franklin 1920-1958
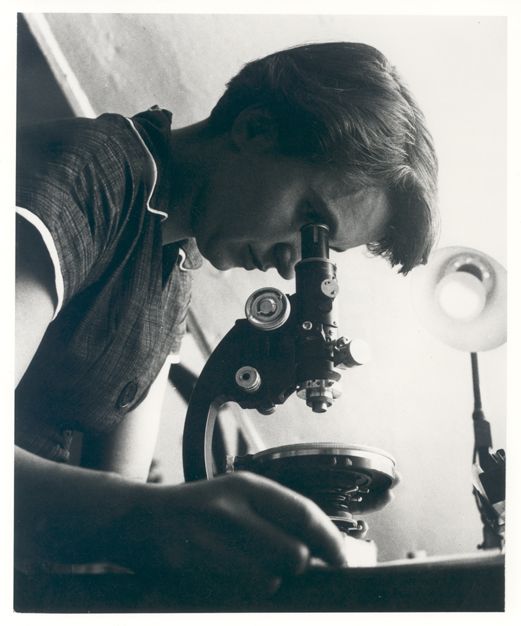 Rosalind Franklin est une physico-chimiste britannique, née le 25 juillet 1920 à Notting Hill et morte le 16 avril 1958 à Chelsea. Pionnière de la biologie moléculaire, elle formule la première dans un rapport non publié la structure hélicoïdale de l'acide désoxyribonucléique (ADN), découverte spoliée par Watson et Crick qui accèdent à son travail. Elle a également joué un rôle majeur dans la découverte du virus de la mosaïque du tabac.
Rosalind Franklin est une physico-chimiste britannique, née le 25 juillet 1920 à Notting Hill et morte le 16 avril 1958 à Chelsea. Pionnière de la biologie moléculaire, elle formule la première dans un rapport non publié la structure hélicoïdale de l'acide désoxyribonucléique (ADN), découverte spoliée par Watson et Crick qui accèdent à son travail. Elle a également joué un rôle majeur dans la découverte du virus de la mosaïque du tabac.
Rosalind Elsie Franklin est née dans une famille juive britannique très influente. Son père est Arthur Ellis Franklin, un marchand londonien et sa mère Muriel Frances Waley. Rosalind est la fille aînée et le deuxième enfant d'une fratrie de cinq enfants.
Après l'obtention d'un doctorat en physique-chimie à Cambridge au Royaume-Uni en 1945 obtenu en étudiant la porosité de structures de carbones, elle poursuit ses recherches à Paris de 1947 à 1950 au Laboratoire central des services chimiques de l'État, où elle utilise les techniques de diffractométrie de rayons X pour déterminer les structures amorphes du carbone.
De retour au Royaume-Uni en 1951, elle obtient une bourse pour étudier des fibres d'ADN par diffraction des rayons X au King's College de Londres dans le département dirigé par John Randall. En contrôlant précisément l'humidité des échantillons, elle parvient à distinguer la forme B de la forme A de l'ADN, plus rare mais souvent présente dans les échantillons déshydratés les plus souvent observés. L'évolution de la structure de l'ADN avec l'humidité lui a permis de réfuter les premiers modèles d'ADN établis par Maurice Wilkins à James Dewey Watson et par Linus Pauling de manière indépendante, qui considéraient que les groupements phosphates devaient se trouver au cœur de la molécule.
Source Wikipédia: Rosalind Franklin.
Wilhelm Wien 1864-1928
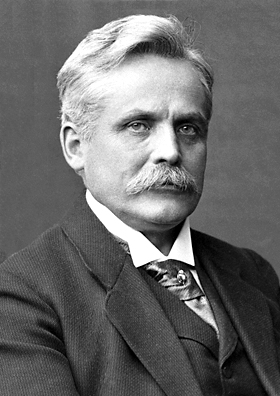 Wilhelm Carl Werner Otto Fritz Franz Wien (13 janvier 1864 à Fischhausen, Prusse-Orientale - 30 août 1928 à Munich) était un physicien allemand. Il a reçu le prix Nobel de physique de 1911 « pour ses découvertes sur les lois du rayonnement de la chaleur ».
Wilhelm Carl Werner Otto Fritz Franz Wien (13 janvier 1864 à Fischhausen, Prusse-Orientale - 30 août 1928 à Munich) était un physicien allemand. Il a reçu le prix Nobel de physique de 1911 « pour ses découvertes sur les lois du rayonnement de la chaleur ».
Il fit ses études au lycée d'Heidelberg et, à partir de 1882, à l'université de Göttingen puis de Berlin. À partir de 1883, il prépare sa thèse sous la direction d'Hermann von Helmholtz et obtient son doctorat en 1886.
Il publia en 1896 la loi de Wien, qui précise la répartition spectrale du rayonnement du corps noir pour les courtes longueurs d'onde. Lord Rayleigh déterminera avec James Jeans une formule complémentaire — la loi de Rayleigh-Jeans — ouvrant l'une et l'autre la voie à Max Planck.
En 1914, il fut un des signataires du Manifeste des 93.
Source Wikipédia: Wilhelm Wien.
Sean Connery 1930-2020
 Sir Sean Connery est un acteur et producteur britannique, né le 25 août 1930 à Édimbourg en Écosse et mort le 31 octobre 2020 à Nassau aux Bahamas.
Révélé en devenant le premier acteur incarnant James Bond au cinéma, il tient ce rôle, qui lui confère une célébrité mondiale, dans six films d'EON Productions — James Bond 007 contre Dr No (1962), Bons baisers de Russie (1963), Goldfinger (1964), Opération Tonnerre (1965), On ne vit que deux fois (1967) et Les diamants sont éternels (1971) — et revient dans le non officiel Jamais plus jamais (1983). En parallèle de James Bond, ses autres films notables de l'époque sont Pas de printemps pour Marnie (1964), Le Crime de l'Orient-Express (1974), L'Homme qui voulut être roi (1975) et Un pont trop loin (1977).
Après plusieurs années incertaines, il se renouvelle avec des rôles de mentors à partir des années 1980 dans de grands succès commerciaux comme Le Nom de la rose (1986), Highlander (1986), Les Incorruptibles (1987) et Indiana Jones et la Dernière Croisade (1989). Sa notoriété consolidée, il remporte de nombreux prix, dont l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle et le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour Les Incorruptibles, le BAFTA du meilleur acteur pour son interprétation du moine Guillaume de Baskerville dans Le Nom de la rose et un Cecil B. DeMille Award en 1996 pour l'ensemble de sa carrière. Il prend sa retraite après son rôle dans La Ligue des gentlemen extraordinaires (2003).
Icône du cinéma britannique, Sean Connery a été anobli par la reine Élisabeth II en 2000, pour services rendus au cinéma britannique. Il est également membre de l'ordre de l'Empire britannique. Fier de ses origines écossaises, il affiche publiquement son soutien à l'indépendantisme écossais.
Sir Sean Connery est un acteur et producteur britannique, né le 25 août 1930 à Édimbourg en Écosse et mort le 31 octobre 2020 à Nassau aux Bahamas.
Révélé en devenant le premier acteur incarnant James Bond au cinéma, il tient ce rôle, qui lui confère une célébrité mondiale, dans six films d'EON Productions — James Bond 007 contre Dr No (1962), Bons baisers de Russie (1963), Goldfinger (1964), Opération Tonnerre (1965), On ne vit que deux fois (1967) et Les diamants sont éternels (1971) — et revient dans le non officiel Jamais plus jamais (1983). En parallèle de James Bond, ses autres films notables de l'époque sont Pas de printemps pour Marnie (1964), Le Crime de l'Orient-Express (1974), L'Homme qui voulut être roi (1975) et Un pont trop loin (1977).
Après plusieurs années incertaines, il se renouvelle avec des rôles de mentors à partir des années 1980 dans de grands succès commerciaux comme Le Nom de la rose (1986), Highlander (1986), Les Incorruptibles (1987) et Indiana Jones et la Dernière Croisade (1989). Sa notoriété consolidée, il remporte de nombreux prix, dont l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle et le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour Les Incorruptibles, le BAFTA du meilleur acteur pour son interprétation du moine Guillaume de Baskerville dans Le Nom de la rose et un Cecil B. DeMille Award en 1996 pour l'ensemble de sa carrière. Il prend sa retraite après son rôle dans La Ligue des gentlemen extraordinaires (2003).
Icône du cinéma britannique, Sean Connery a été anobli par la reine Élisabeth II en 2000, pour services rendus au cinéma britannique. Il est également membre de l'ordre de l'Empire britannique. Fier de ses origines écossaises, il affiche publiquement son soutien à l'indépendantisme écossais.
Source Wikipédia: Sean Connery
Ernesto Guevara 1928 - 1967
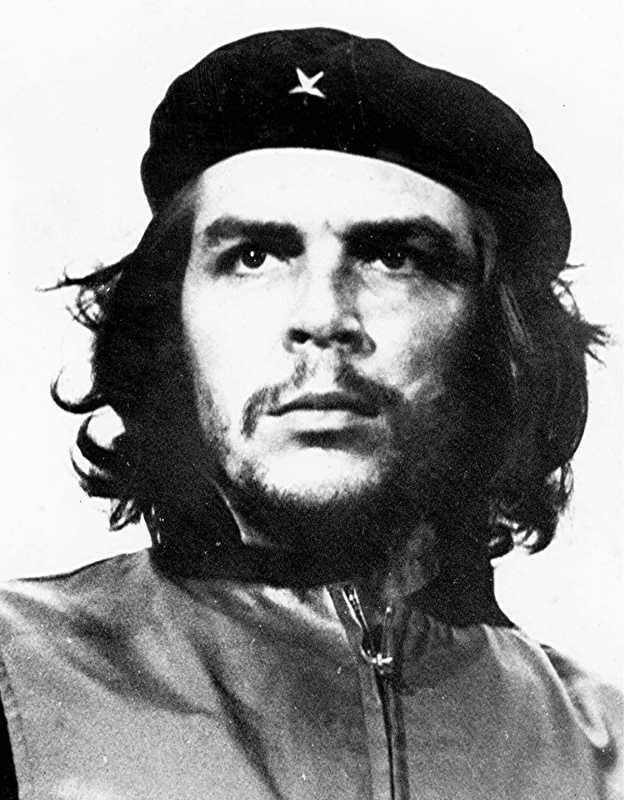 Ernesto Guevara, plus connu comme « Che Guevara » ou « le Che », né le 14 juin 1928 à Rosario en Argentine et mort exécuté le 9 octobre 1967 à La Higuera en Bolivie, à l'âge de 39 ans, est un révolutionnaire marxiste-léniniste et internationaliste argentin ainsi qu'un homme politique d'Amérique latine.
Ernesto Guevara, plus connu comme « Che Guevara » ou « le Che », né le 14 juin 1928 à Rosario en Argentine et mort exécuté le 9 octobre 1967 à La Higuera en Bolivie, à l'âge de 39 ans, est un révolutionnaire marxiste-léniniste et internationaliste argentin ainsi qu'un homme politique d'Amérique latine.
Il a notamment été un dirigeant de la révolution cubaine, qu'il a théorisée et tenté d'exporter, sans succès, vers le Congo puis la Bolivie où il trouve la mort.
Alors qu'il est jeune étudiant en médecine, Guevara voyage à travers l'Amérique latine, ce qui le met en contact direct avec la pauvreté dans laquelle vit une grande partie de la population. Son expérience et ses observations l'amènent à la conclusion que les inégalités socioéconomiques ne peuvent être abolies que par la révolution.
Il décide alors d'intensifier son étude du marxisme et de voyager au Guatemala afin d'apprendre des réformes entreprises par le président Jacobo Arbenz Guzmán, renversé quelques mois plus tard par un coup d'État appuyé par la CIA.
Peu après, Guevara rejoint le mouvement du 26 juillet, un groupe révolutionnaire dirigé par Fidel Castro. Après plus de deux ans de guérilla durant laquelle Guevara devient commandant, ce groupe prend le pouvoir à Cuba en renversant le dictateur Fulgencio Batista en 1959.
Dans les mois qui suivent, Guevara est commandant en chef de la prison de La Cabaña. Il est désigné procureur d'un tribunal révolutionnaire qui exécute les opposants. Puis il crée des camps de « travail et de rééducation ».
Il occupe ensuite plusieurs postes importants dans le gouvernement cubain qui écarte les démocrates, réussissant à influencer le passage de Cuba à une économie du même type que celle de l'URSS, et à un rapprochement politique avec le Bloc de l'Est, mais échouant dans l'industrialisation du pays en tant que ministre. Guevara écrit pendant ce temps plusieurs ouvrages théoriques sur la révolution et la guérilla.
En 1965, après avoir dénoncé l'exploitation du tiers monde par les deux blocs de la guerre froide, il disparaît de la vie politique et quitte Cuba avec l'intention d'étendre la révolution et de propager ses convictions marxistes communistes.
Il se rend d'abord au Congo-Léopoldville, sans succès, puis en Bolivie où il est capturé et exécuté sommairement par l'armée bolivienne entraînée et guidée par la CIA. Il existe des doutes et de nombreuses versions sur le degré d'influence de la CIA et des États-Unis dans cette décision.
Après sa mort, Che Guevara devient une icône pour des mouvements révolutionnaires et fait l’objet d’un culte de la personnalité, mais demeure toujours l'objet de controverses entre historiens, à cause de témoignages sur des exécutions d'innocents avancées par certains de ses biographes.
Un portrait de Che Guevara réalisé par Alberto Korda est considéré comme l'une des photographies les plus célèbres au monde.
Source Wikipédia: Che Guevara
Galileo Galilei 1564- 1642
 Galilée (en italien : Galileo Galilei), né à Pise en 1564 et mort à Arcetri près de Florence le 8 janvier 1642 (77 ans), est un mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien du XVIIe siècle.
Parmi ses réalisations techniques, il a perfectionné et exploité la lunette astronomique, perfectionnement de la découverte hollandaise d'une lunette d'approche, pour procéder à des observations rapides et précoces qui ont bouleversé les fondements de l'astronomie.
Galilée (en italien : Galileo Galilei), né à Pise en 1564 et mort à Arcetri près de Florence le 8 janvier 1642 (77 ans), est un mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien du XVIIe siècle.
Parmi ses réalisations techniques, il a perfectionné et exploité la lunette astronomique, perfectionnement de la découverte hollandaise d'une lunette d'approche, pour procéder à des observations rapides et précoces qui ont bouleversé les fondements de l'astronomie.
Cet homme de sciences s'est ainsi posé en défenseur de l'approche modélisatrice copernicienne de l'Univers, proposant d'adopter l'héliocentrisme et les mouvements satellitaires.
Ses observations et généralisations se sont alors heurtées aux critiques des philosophes partisans d'Aristote (proposant un géocentrisme stable, une classification des corps et des êtres, un ordre immuable des éléments et une évolution réglée des substances) et des scientifiques attachés au modèle de Ptolémée, ainsi qu'à une partie des théologiens de l'Église catholique romaine. Galilée, qui ne disposait pas de preuves directes du mouvement terrestre, a parfois oublié la prudence qui lui était prônée par ses protecteurs religieux.
Dans son opus sur les comètes de 1623, il se fait le partisan de « l'écriture mathématique du livre de l'Univers ». Si Galilée n'a pas contribué à faire progresser l'algèbre, il a tout de même produit des travaux inédits et remarquables sur les suites, sur certaines courbes géométriques et sur la prise en compte des infiniment petits.
Par ses études et ses nombreuses expériences, parfois uniquement de pensée, sur l'équilibre et le mouvement des corps solides, notamment leur chute, leur translation rectiligne, leur inertie, ainsi que par la généralisation des mesures, en particulier du temps par l'isochronisme du pendule, et la résistance des matériaux, ce chercheur toscan a posé les bases de la mécanique avec la cinématique et la dynamique.
Il est considéré depuis 1680 comme le fondateur de la physique, qui s'est imposée comme la première des sciences exactes modernes.
Source Wikipédia: Galilée
Gengis Khan (Temujin) 1162 - 1227
Ici, une vidéo ( en deux parties très intéressante sur Les mongoles :
Partie 1 : Comment les tribus mongoles furent-elles unifiées ?
Partie 2 :
Quels furent les ressorts de l'expansion mongole ?
 1162 - 1227.jpg) Gengis Khan, cyrillique : Чингис Хаан, Tchinguis Khaan, MNS : Chingis Khaan, littéralement : « souverain universel »), d'abord nommé Temüjin, né vers 1155/1162 pendant le Khamag Mongol, dans ce qui correspond à l'actuelle province de Khentii en Mongolie, mort en août 1227 dans l'actuel Xian de Qingshui (Chine), est le fondateur de l'Empire mongol, le plus vaste empire continu de tous les temps, estimé lors de son extension maximale à 33,2 millions de km2 en 1268 sous Kubilai Khan.
Gengis Khan, cyrillique : Чингис Хаан, Tchinguis Khaan, MNS : Chingis Khaan, littéralement : « souverain universel »), d'abord nommé Temüjin, né vers 1155/1162 pendant le Khamag Mongol, dans ce qui correspond à l'actuelle province de Khentii en Mongolie, mort en août 1227 dans l'actuel Xian de Qingshui (Chine), est le fondateur de l'Empire mongol, le plus vaste empire continu de tous les temps, estimé lors de son extension maximale à 33,2 millions de km2 en 1268 sous Kubilai Khan.
Issu d'un chef de clan de la tribu des Bordjiguines, il utilise son génie politique et militaire pour rassembler plusieurs tribus nomades de l'Asie de l'Est et de l'Asie centrale sous l'identité commune de « mongoles » ; il en devient le khan (dirigeant), puis le Tchingis Khagan (empereur ou chef suprême), avant même de se lancer à la conquête de la Chine. À la fin de son règne, il contrôle une grande partie de l'Asie, avec, outre la Mongolie, la Chine du nord et la Sogdiane.
Après sa mort, l'empire est considérablement agrandi par ses successeurs qui le dirigent encore pendant plus de 150 ans. Son petit-fils, Kubilaï Khan, est le premier empereur de la dynastie Yuan en Chine.
Pour les Mongols, qui le considèrent comme le père de leur nation, Gengis Khan est une figure légendaire entourée d'un grand respect. Mais, dans nombre de régions d'Asie ravagées par ses guerres ou celles de ses successeurs, il est considéré comme un conquérant impitoyable et sanguinaire.
Il a établi des lois en faveur des femmes, pour éviter les conflits entre tribus. Ainsi, l'interdiction d'enlever des femmes, de les vendre à des époux et l'interdiction de l'adultère sont les principes de son empire.
NDLR : La suite sur Wikipédia
Source Wikipédia: Gengis Khan
George Washington 1732 - 1799
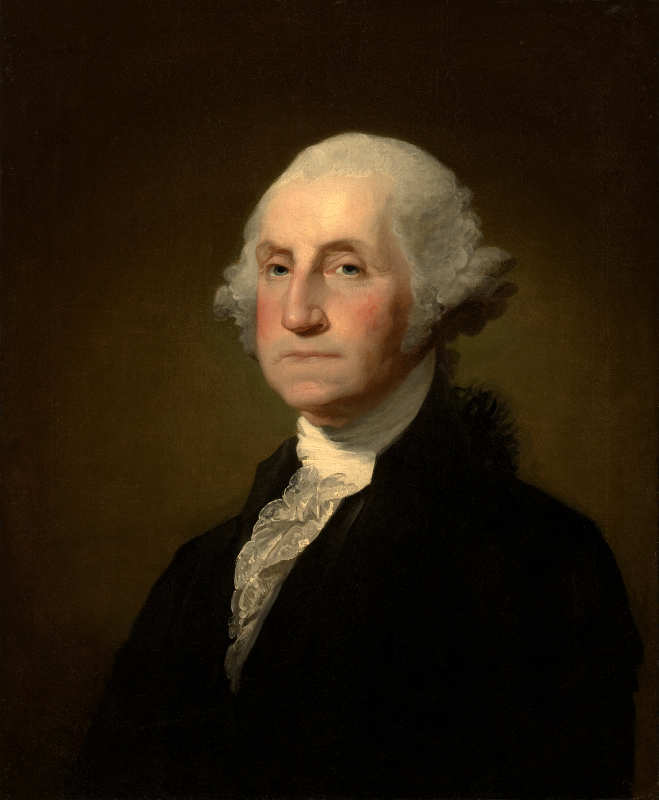 George Washington, né le 22 février 1732 à Pope's Creek (colonie de Virginie) et mort le 14 décembre 1799 à Mount Vernon (État de Virginie), est un homme d'État américain, chef d’État-major de l’Armée continentale pendant la guerre d’indépendance entre 1775 et 1783 et premier président des États-Unis, en fonction de 1789 à 1797.
George Washington, né le 22 février 1732 à Pope's Creek (colonie de Virginie) et mort le 14 décembre 1799 à Mount Vernon (État de Virginie), est un homme d'État américain, chef d’État-major de l’Armée continentale pendant la guerre d’indépendance entre 1775 et 1783 et premier président des États-Unis, en fonction de 1789 à 1797.
Washington est l'un des planteurs les plus riches de la région avec son domaine de Mount Vernon, bien qu'il ait fini sa vie à court d'argent liquide, devant même emprunter pour se rendre à la cérémonie d'inauguration de son investiture en tant que président. Grâce à sa participation à la guerre de Sept Ans qui se déroule entre 1756 et 1763, il devient rapidement célèbre des deux côtés de l'Atlantique et s'intéresse aux questions politiques.
Son engagement dans la révolution américaine ainsi que sa réputation le portent au poste de commandant des troupes américaines, qu'il organise et mène à la victoire finale, avec l'aide des Français, sur la métropole britannique.
Après le conflit, il participe à la rédaction de la Constitution des États-Unis et fait l’unanimité lors de la première élection présidentielle. Pendant ses deux mandats, George Washington montre ses qualités d'administrateur habile, malgré les difficultés internes et les conflits en Europe.
Il a laissé son empreinte sur les institutions du pays et sur l’histoire des États-Unis.
Considéré comme l'un des Pères fondateurs des États-Unis par les Américains, George Washington a fait l'objet de nombreux hommages depuis la fin du XVIIIe siècle : son nom a été donné à la capitale des États-Unis, à un État du nord-ouest de l'Union, ainsi qu'à de nombreux sites et monuments. Son effigie figure depuis 1932 sur la pièce de 25 cents (quarter) ainsi que sur le billet d'un dollar.
NDLR : La suite sur Wikipédia
Source Wikipédia: George_Washington
Giordano Bruno 1548 - 1600
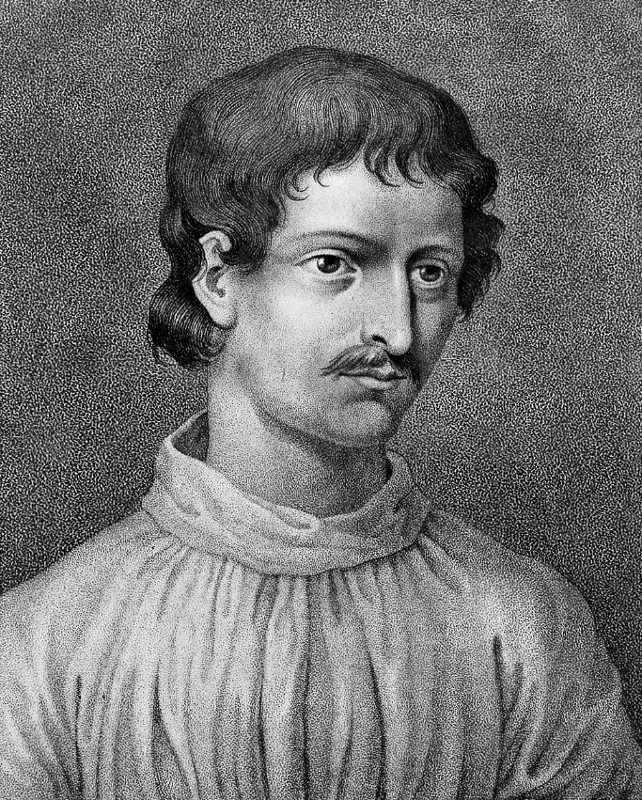 Filippo Bruno, dit Giordano Bruno, né en janvier 1548 à Nola en Italie et mort le 17 février 1600 à Rome, est un frère dominicain et philosophe napolitain.
Filippo Bruno, dit Giordano Bruno, né en janvier 1548 à Nola en Italie et mort le 17 février 1600 à Rome, est un frère dominicain et philosophe napolitain.
Sur la base des travaux de Nicolas Copernic et Nicolas de Cues, il développe la théorie de l'héliocentrisme et montre, de manière philosophique, la pertinence d'un univers infini, qui n'a ni centre ni circonférence, peuplé d'une quantité innombrable d'astres et de mondes identiques au nôtre.
Accusé formellement d'athéisme et d'hérésie (particulièrement pour sa théorie de la réincarnation des âmes) par l'Inquisition, d'après ses écrits jugés blasphématoires (où il proclame en outre que Jésus-Christ n'est pas Dieu mais un simple « mage habile », que le Saint-Esprit est l'âme de ce monde, que Satan sera finalement sauvé) et poursuivi pour son intérêt pour la magie, il est condamné à être brûlé vif au terme de huit années de procès ponctuées de nombreuses propositions de rétractation qu'il paraissait d'abord accepter puis qu'il rejetait.
Une statue de bronze à son effigie trône depuis le XIXe siècle sur les lieux de son supplice, au Campo de' Fiori à Rome.
Il est compté au nombre des martyrs de la liberté de penser.
NDLR : La suite sur Wikipédia…(La suite est longue et intéressante)
Source Wikipédia: Giordano Bruno
Hendrik Antoon Lorentz 1853 - 1928
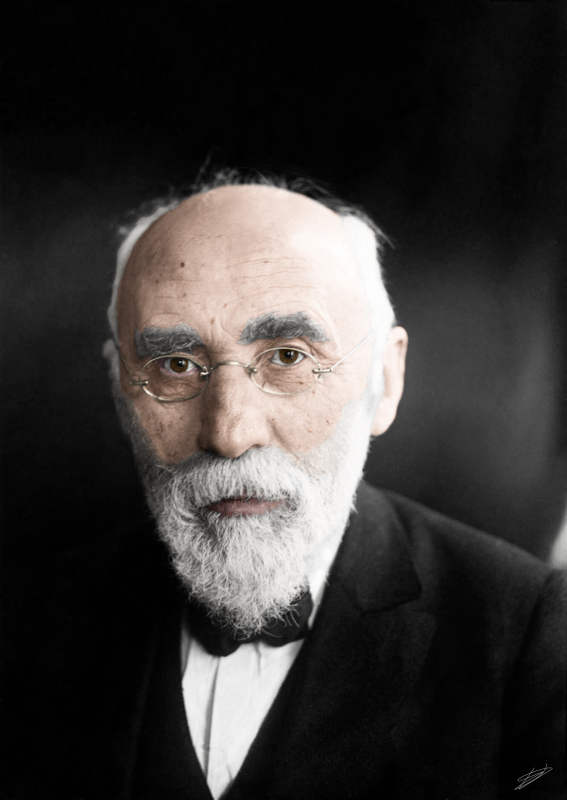 Hendrik Antoon Lorentz, né le 18 juillet 1853 à Arnhem (Pays-Bas) et mort le 4 février 1928 à Haarlem (Pays-Bas) est un physicien néerlandais qui s'est illustré par ses travaux théoriques sur la nature de la lumière et la constitution de la matière.
Hendrik Antoon Lorentz, né le 18 juillet 1853 à Arnhem (Pays-Bas) et mort le 4 février 1928 à Haarlem (Pays-Bas) est un physicien néerlandais qui s'est illustré par ses travaux théoriques sur la nature de la lumière et la constitution de la matière.
Il est co-lauréat avec Pieter Zeeman du prix Nobel de physique de 1902.
La majorité de ses travaux portèrent sur l'électromagnétisme.
Il a laissé son nom aux transformations de Lorentz qui sont à la base de la théorie de la relativité restreinte.
Elles ont été présentées par Lorentz dans le but d'expliquer les résultats de l'expérience de Michelson-Morley par une contraction réelle des longueurs dans le sens du mouvement, ce qui n'est d'ailleurs pas compatible avec l'interprétation moderne de la théorie de la relativité restreinte qui affirme seulement que la mesure d'une distance ou d'une durée dépend du référentiel dans lequel se fait cette mesure et n'a donc pas de caractère absolu.
La théorie de Lorentz implique également l'existence d'un référentiel absolu, le seul où les lois de l'électromagnétisme seraient applicables et d'un milieu, l'éther, qui servirait de support à la propagation des ondes électromagnétiques et qui serait fixe dans ce référentiel absolu.
Lorentz partagea, en 1902, le prix Nobel de physique avec Pieter Zeeman « en reconnaissance des extraordinaires services qu'ils ont rendus par leurs recherches sur l'influence du magnétisme sur les phénomènes radiatifs ».
Il a reçu en 1908 la médaille Rumford. Il est lauréat de la médaille Franklin en 1917 pour ses travaux sur la nature de la lumière et la constitution de la matière. Il a également reçu la médaille Copley en 1918.
En son honneur, l'Académie royale des arts et des sciences néerlandaise, KNAW, a fondé en 1926 la médaille Lorentz.
Les travaux de la commission qu'il dirigea lors de l'étude préliminaire des travaux du Zuiderzee amenèrent à modifier le tracé de l'Afsluitdijk pour diminuer l'impact de cette digue sur les hauteurs d'eau induites par les marées et les tempêtes.
Source Wikipédia: Hendrik Lorentz
Jean d'Ormesson 1925 - 2017
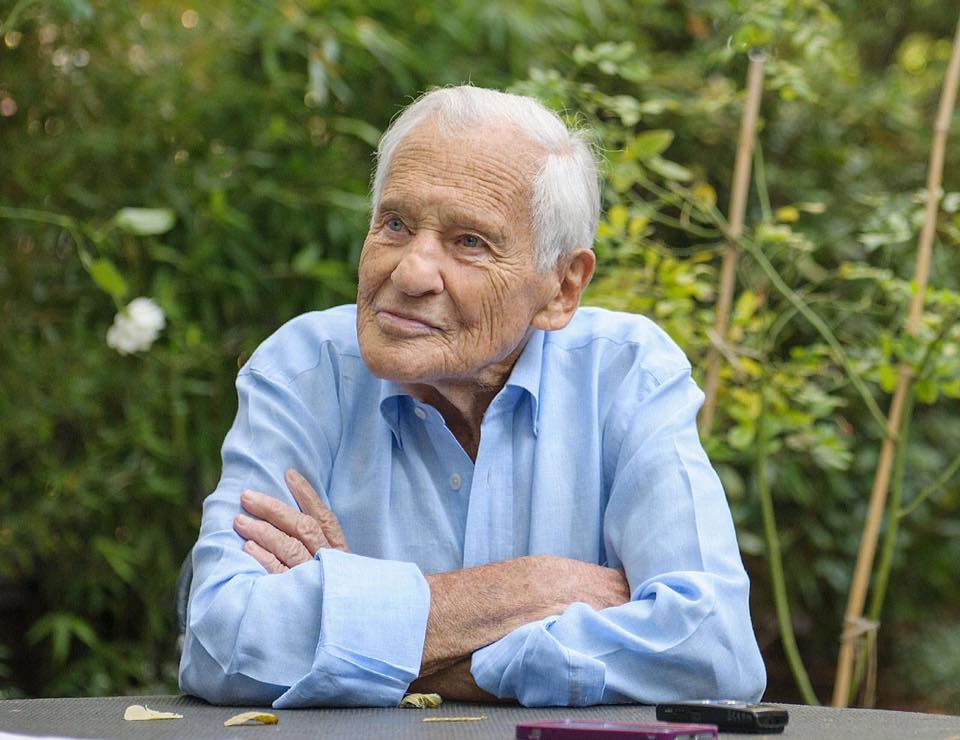 Jean d'Ormesson, parfois surnommé Jean d'O, né le 16 juin 1925 à Paris et mort le 5 décembre 2017 à Neuilly-sur-Seine, est un écrivain, journaliste et philosophe français.
Jean d'Ormesson, parfois surnommé Jean d'O, né le 16 juin 1925 à Paris et mort le 5 décembre 2017 à Neuilly-sur-Seine, est un écrivain, journaliste et philosophe français.
Membre de la famille Lefèvre d'Ormesson, une des familles subsistantes de la noblesse française, propriétaire du château d'Ormesson dans le Val-de-Marne, il descend par sa mère de la famille Lepeletier de Saint-Fargeau, propriétaire du château de Saint-Fargeau dans l'Yonne. Il se voit dispenser un enseignement privilégié et est notamment élève de l'École normale supérieure.
Il est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages, allant de grandes fresques historiques imaginaires (La Gloire de l'Empire, 1971) aux essais philosophiques dans lesquels il partage ses réflexions sur la vie, la mort ou l'existence de Dieu (Je dirai malgré tout que cette vie fut belle, 2016). Il est élu à l'Académie française en 1973. De 1974 à 1977, il est également le directeur général du Figaro.
Considéré pendant plus de quarante ans comme l'ambassadeur médiatique de l'Académie française, il est très présent dans des émissions télévisées littéraires ou plus généralistes, où il est régulièrement invité pour son érudition et son art de la conversation.
NDLR : La très longue suite sur Wikipédia…
Source Wikipédia: Jean d'Ormesson
UNE PERLE DE JEAN D'ORMESSON :
Que vous soyez fier comme un coq
Fort comme un bœuf
Têtu comme un âne
Malin comme un singe
Ou simplement un chaud lapin
Vous êtes tous, un jour ou l'autre
Devenu chèvre pour une caille aux yeux de biche
Vous arrivez à votre premier rendez-vous
Fier comme un paon
Et frais comme un gardon
Et là ... Pas un chat !
Vous faites le pied de grue
Vous demandant si cette bécasse vous a réellement posé un lapin
Il y a anguille sous roche
Et pourtant le bouc émissaire qui vous a obtenu ce rancard
La tête de linotte avec qui vous êtes copain comme cochon
Vous l'a certifié
Cette poule a du chien
Une vraie panthère !
C'est sûr, vous serez un crapaud mort d'amour
Mais tout de même, elle vous traite comme un chien
Vous êtes prêt à gueuler comme un putois
Quand finalement la fine mouche arrive
Bon, vous vous dites que dix minutes de retard
Il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard
Sauf que la fameuse souris
Malgré son cou de cygne et sa crinière de lion
Est en fait aussi plate qu'une limande
Myope comme une taupe
Elle souffle comme un phoque
Et rit comme une baleine
Une vraie peau de vache, quoi !
Et vous, vous êtes fait comme un rat
Vous roulez des yeux de merlan frit
Vous êtes rouge comme une écrevisse
Mais vous restez muet comme une carpe
Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez
Mais vous sautez du coq à l'âne
Et finissez par noyer le poisson
Vous avez le cafard
L'envie vous prend de pleurer comme un veau
(ou de verser des larmes de crocodile, c'est selon)
Vous finissez par prendre le taureau par les cornes
Et vous inventer une fièvre de cheval
Qui vous permet de filer comme un lièvre
C'est pas que vous êtes une poule mouillée
Vous ne voulez pas être le dindon de la farce
Vous avez beau être doux comme un agneau
Sous vos airs d'ours mal léché
Faut pas vous prendre pour un pigeon
Car vous pourriez devenir le loup dans la bergerie
Et puis, ç'aurait servi à quoi
De se regarder comme des chiens de faïence
Après tout, revenons à nos moutons
Vous avez maintenant une faim de loup
L'envie de dormir comme un loir
Et surtout vous avez d'autres chats à fouetter.
Billet d'humour de Jean D'ORMESSON !!! Et hommage à la langue française
Webmaster : Jr Pierlot
 Abraham Lincoln 1, né le 12 février 1809 dans le comté de Hardin (Kentucky) et mort assassiné le 15 avril 1865 à Washington, D.C., est un homme d'État américain. Il est le seizième président des États-Unis. Il est élu à deux reprises président des États-Unis, en novembre 1860 et en novembre 1864. Il est le premier président républicain de l’histoire du pays. Il a dirigé les États-Unis lors de la pire crise constitutionnelle, militaire et morale de leur histoire, la guerre de Sécession, et réussit à préserver l’Union. C’est au cours de celle-ci qu’il fait ratifier le XIIIe amendement de la Constitution des États-Unis, qui abolit l’esclavage. Il sort victorieux de la guerre. Assassiné cinq jours plus tard, à la suite d'un complot organisé par des confédérés, il ne termine pas son second mandat.
Abraham Lincoln 1, né le 12 février 1809 dans le comté de Hardin (Kentucky) et mort assassiné le 15 avril 1865 à Washington, D.C., est un homme d'État américain. Il est le seizième président des États-Unis. Il est élu à deux reprises président des États-Unis, en novembre 1860 et en novembre 1864. Il est le premier président républicain de l’histoire du pays. Il a dirigé les États-Unis lors de la pire crise constitutionnelle, militaire et morale de leur histoire, la guerre de Sécession, et réussit à préserver l’Union. C’est au cours de celle-ci qu’il fait ratifier le XIIIe amendement de la Constitution des États-Unis, qui abolit l’esclavage. Il sort victorieux de la guerre. Assassiné cinq jours plus tard, à la suite d'un complot organisé par des confédérés, il ne termine pas son second mandat.
.jpg) Ahmed Chah Massoud (2 septembre 1953 - 9 septembre 2001) (en persan : احمد شاه مسعود), fréquemment appelé le commandant Massoud, était le commandant du Front uni islamique et national pour le salut de l'Afghanistan, du Jamiat-e Islami et le chef de l'Armée islamique, une armée ayant combattu contre l'occupation soviétique puis le régime des talibans de 1996 à 2001.
Sa réputation de chef militaire, et notamment son surnom de « Lion du Pandjchir », vient du fait qu'il a réussi à repousser sept attaques d'envergure des troupes soviétiques contre la vallée du Pandjchir, au nord-est de Kaboul. Attribué à Al-Qaïda, son assassinat par attentat-suicide survient deux jours avant les évènements du 11 septembre 20011.
Ahmed Chah Massoud (2 septembre 1953 - 9 septembre 2001) (en persan : احمد شاه مسعود), fréquemment appelé le commandant Massoud, était le commandant du Front uni islamique et national pour le salut de l'Afghanistan, du Jamiat-e Islami et le chef de l'Armée islamique, une armée ayant combattu contre l'occupation soviétique puis le régime des talibans de 1996 à 2001.
Sa réputation de chef militaire, et notamment son surnom de « Lion du Pandjchir », vient du fait qu'il a réussi à repousser sept attaques d'envergure des troupes soviétiques contre la vallée du Pandjchir, au nord-est de Kaboul. Attribué à Al-Qaïda, son assassinat par attentat-suicide survient deux jours avant les évènements du 11 septembre 20011.
.jpg) Alan Mathison Turing, né le 23 juin 1912 à Londres et mort le 7 juin 1954 à Wilmslow, est un mathématicien et cryptologue britannique, auteur de travaux qui fondent scientifiquement l'informatique.
Pour résoudre le problème fondamental de la décidabilité en arithmétique, il présente en 1936 une expérience de pensée que l'on nommera ensuite machine de Turing et des concepts de programme et de programmation, qui prendront tout leur sens avec la diffusion des ordinateurs, dans la seconde moitié du XXe siècle. Son modèle a contribué à établir la thèse de Church, qui définit le concept mathématique intuitif de fonction calculable.
Durant la Seconde Guerre mondiale, il joue un rôle majeur dans la cryptanalyse de la machine Enigma utilisée par les armées allemandes. Ce travail secret ne sera connu du public que dans les années 1970. Après la guerre, il travaille sur un des tout premiers ordinateurs, puis contribue au débat sur la possibilité de l'intelligence artificielle, en proposant le test de Turing. Vers la fin de sa vie, il s'intéresse à des modèles de morphogenèse du vivant conduisant aux « structures de Turing ».
Poursuivi en justice en 1952 pour homosexualité, il choisit, pour éviter la prison, la castration chimique par prise d'œstrogènes. Il est retrouvé mort par empoisonnement au cyanure le 8 juin 1954 dans la chambre de sa maison à Wilmslow. La reine Élisabeth II le reconnaît comme héros de guerre et le gracie à titre posthume en 2013.
Alan Mathison Turing, né le 23 juin 1912 à Londres et mort le 7 juin 1954 à Wilmslow, est un mathématicien et cryptologue britannique, auteur de travaux qui fondent scientifiquement l'informatique.
Pour résoudre le problème fondamental de la décidabilité en arithmétique, il présente en 1936 une expérience de pensée que l'on nommera ensuite machine de Turing et des concepts de programme et de programmation, qui prendront tout leur sens avec la diffusion des ordinateurs, dans la seconde moitié du XXe siècle. Son modèle a contribué à établir la thèse de Church, qui définit le concept mathématique intuitif de fonction calculable.
Durant la Seconde Guerre mondiale, il joue un rôle majeur dans la cryptanalyse de la machine Enigma utilisée par les armées allemandes. Ce travail secret ne sera connu du public que dans les années 1970. Après la guerre, il travaille sur un des tout premiers ordinateurs, puis contribue au débat sur la possibilité de l'intelligence artificielle, en proposant le test de Turing. Vers la fin de sa vie, il s'intéresse à des modèles de morphogenèse du vivant conduisant aux « structures de Turing ».
Poursuivi en justice en 1952 pour homosexualité, il choisit, pour éviter la prison, la castration chimique par prise d'œstrogènes. Il est retrouvé mort par empoisonnement au cyanure le 8 juin 1954 dans la chambre de sa maison à Wilmslow. La reine Élisabeth II le reconnaît comme héros de guerre et le gracie à titre posthume en 2013.
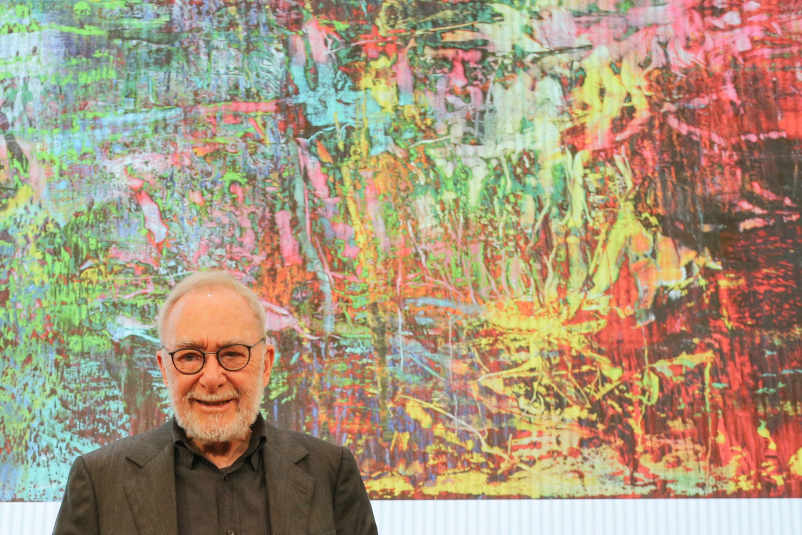 Gerhard Richter, né à Dresde le 9 février 1932, est un artiste peintre allemand dont l'œuvre est reconnue, depuis les années 1980, « comme une expérience artistique inédite et remarquable ».
Gerhard Richter, né à Dresde le 9 février 1932, est un artiste peintre allemand dont l'œuvre est reconnue, depuis les années 1980, « comme une expérience artistique inédite et remarquable ».  John von Neumann (János Lajos Neumann, né le 28 décembre 1903 à Budapest et mort le 8 février 1957 à Washington, est un mathématicien et physicien américano-hongrois.
John von Neumann (János Lajos Neumann, né le 28 décembre 1903 à Budapest et mort le 8 février 1957 à Washington, est un mathématicien et physicien américano-hongrois.  Robert James Fischer, dit Bobby Fischer, né le 9 mars 1943 à Chicago aux États-Unis et mort le 17 janvier 2008 à Reykjavik en Islande, est un joueur d'échecs américain, naturalisé islandais en 2005.
Robert James Fischer, dit Bobby Fischer, né le 9 mars 1943 à Chicago aux États-Unis et mort le 17 janvier 2008 à Reykjavik en Islande, est un joueur d'échecs américain, naturalisé islandais en 2005.  Ambiorix est un chef des Éburons du Ier siècle av. J.-C., peuple belge du nord de la Gaule (Gaule belgique dans la terminologie antique).
Ambiorix est un chef des Éburons du Ier siècle av. J.-C., peuple belge du nord de la Gaule (Gaule belgique dans la terminologie antique).  Giulia Tofana, également orthographié Toffana ou Tophana (Palerme), morte exécutée à Rome en juillet 1659, est une empoisonneuse italienne célèbre pour avoir fourni du poison aux femmes qui voulaient se débarrasser de leurs maris encombrants ou mariées de force.
Giulia Tofana, également orthographié Toffana ou Tophana (Palerme), morte exécutée à Rome en juillet 1659, est une empoisonneuse italienne célèbre pour avoir fourni du poison aux femmes qui voulaient se débarrasser de leurs maris encombrants ou mariées de force. 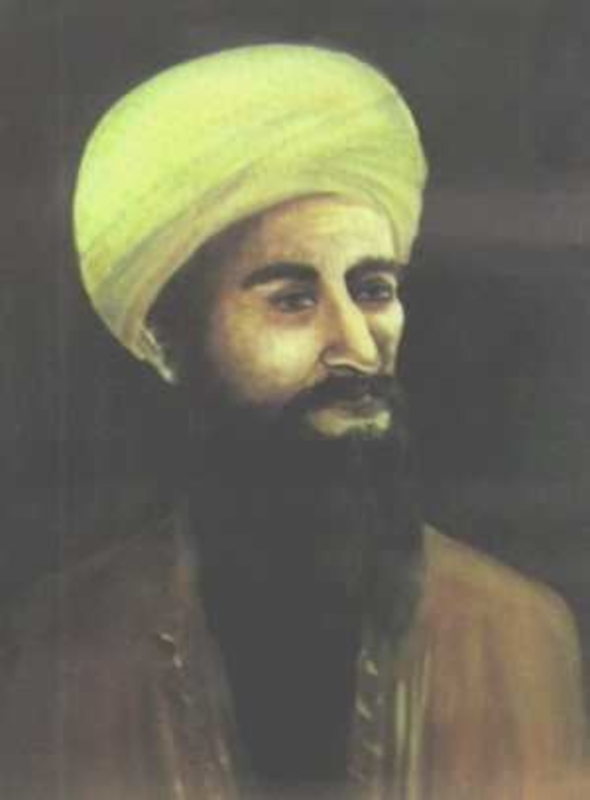 Abd al-Rahman al-Soufi, également connu sous les noms d'Abd ar-Rahman as-Soufi, Abd al-Rahman Abu al-Husein, et Azophi en Occident, né le 7 décembre 903 à Ray (Téhéran) et mort le 25 mai 986 à Chiraz, est un astronome et horloger persan.
Abd al-Rahman al-Soufi, également connu sous les noms d'Abd ar-Rahman as-Soufi, Abd al-Rahman Abu al-Husein, et Azophi en Occident, né le 7 décembre 903 à Ray (Téhéran) et mort le 25 mai 986 à Chiraz, est un astronome et horloger persan. Alexandre Dumas (dit aussi Alexandre Dumas père) est un écrivain français né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts (Aisne) et mort le 5 décembre 1870 au hameau de Puys, ancienne commune de Neuville-lès-Dieppe, aujourd'hui intégrée à Dieppe (Seine-Maritime).
Alexandre Dumas (dit aussi Alexandre Dumas père) est un écrivain français né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts (Aisne) et mort le 5 décembre 1870 au hameau de Puys, ancienne commune de Neuville-lès-Dieppe, aujourd'hui intégrée à Dieppe (Seine-Maritime). Moins 3virgule18 millions d'annees.jpg) Lucy, parfois écrit Dinknesh, est le surnom donné au fossile de l'espèce éteinte Australopithecus afarensis découvert en 1974 sur le site de Hadar, en Éthiopie, par une équipe de recherche internationale.
Lucy, parfois écrit Dinknesh, est le surnom donné au fossile de l'espèce éteinte Australopithecus afarensis découvert en 1974 sur le site de Hadar, en Éthiopie, par une équipe de recherche internationale.  Robert Hutchings Goddard (5 octobre 1882 – 10 août 1945) est un ingénieur et physicien américain.
Robert Hutchings Goddard (5 octobre 1882 – 10 août 1945) est un ingénieur et physicien américain.  Richard Phillips (born May 16, 1955) is an American merchant mariner and author who served as captain of the MV Maersk Alabama during its hijacking by Somali pirates in April 2009.
Richard Phillips (born May 16, 1955) is an American merchant mariner and author who served as captain of the MV Maersk Alabama during its hijacking by Somali pirates in April 2009.  Benito Mussolini, né le 29 juillet 1883 à Predappio et mort le 28 avril 1945 à Giulino di Mezzegra, est un journaliste, idéologue et homme d'État italien.
Benito Mussolini, né le 29 juillet 1883 à Predappio et mort le 28 avril 1945 à Giulino di Mezzegra, est un journaliste, idéologue et homme d'État italien.  Charlemagne, du latin Carolus Magnus, ou Charles Ier dit « le Grand », né à une date inconnue (vraisemblablement durant l'année 742, voire 747 ou 748, peut-être le 2 avril), mort le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle, est un roi des Francs et empereur.
Charlemagne, du latin Carolus Magnus, ou Charles Ier dit « le Grand », né à une date inconnue (vraisemblablement durant l'année 742, voire 747 ou 748, peut-être le 2 avril), mort le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle, est un roi des Francs et empereur.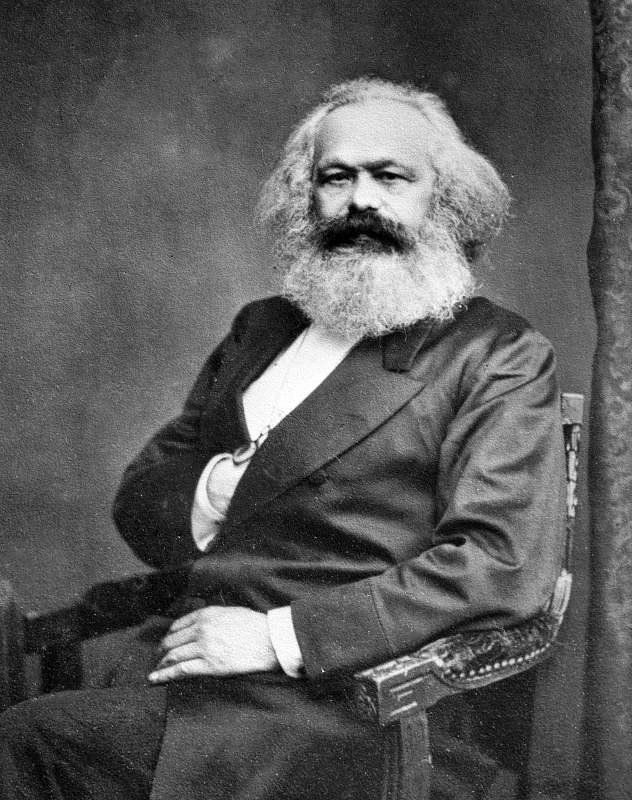 Karl Marx, né le 5 mai 1818 à Trèves dans le grand-duché du Bas-Rhin et mort le 14 mars 1883 à Londres, est un philosophe, historien, sociologue, économiste, journaliste, théoricien de la révolution, socialiste et communiste allemand.
Karl Marx, né le 5 mai 1818 à Trèves dans le grand-duché du Bas-Rhin et mort le 14 mars 1883 à Londres, est un philosophe, historien, sociologue, économiste, journaliste, théoricien de la révolution, socialiste et communiste allemand. 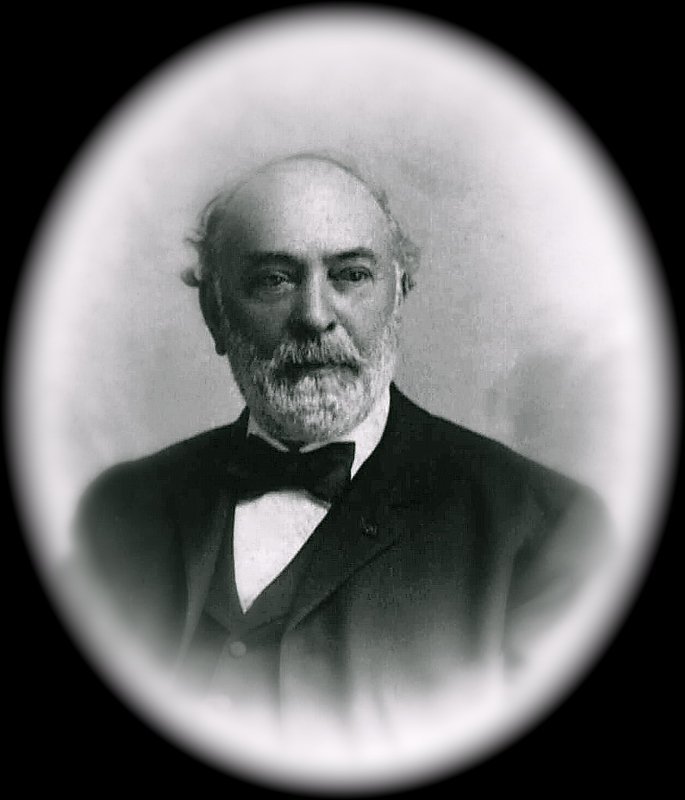 Louis Cailletet (né à Châtillon-sur-Seine le 21 septembre 1832, mort à Paris le 5 janvier 1913) est un chimiste et physicien français. Il a été le premier à liquéfier le dioxygène le 2 décembre 1877.
Louis Cailletet (né à Châtillon-sur-Seine le 21 septembre 1832, mort à Paris le 5 janvier 1913) est un chimiste et physicien français. Il a été le premier à liquéfier le dioxygène le 2 décembre 1877.  Martin Luther, né le 10 novembre 1483 à Eisleben, en Saxe-Anhalt et mort le 18 février 1546 dans la même ville, est un frère augustin théologien, professeur d'université, initiateur du protestantisme et réformateur de l'Église dont les idées exercèrent une grande influence sur la Réforme protestante, qui changea le cours de la civilisation occidentale.
Martin Luther, né le 10 novembre 1483 à Eisleben, en Saxe-Anhalt et mort le 18 février 1546 dans la même ville, est un frère augustin théologien, professeur d'université, initiateur du protestantisme et réformateur de l'Église dont les idées exercèrent une grande influence sur la Réforme protestante, qui changea le cours de la civilisation occidentale.  Mohandas Karamchand Gandhi, né à Porbandar (Gujarat) le 2 octobre 1869 et mort assassiné à Delhi le 30 janvier 1948, est un dirigeant politique, important guide spirituel de l'Inde et du mouvement pour l'indépendance de ce pays.
Mohandas Karamchand Gandhi, né à Porbandar (Gujarat) le 2 octobre 1869 et mort assassiné à Delhi le 30 janvier 1948, est un dirigeant politique, important guide spirituel de l'Inde et du mouvement pour l'indépendance de ce pays.  Edward Charles Pickering (19 juillet 1846 à Boston - 3 février 1919 (à 72 ans) à Cambridge, Massachusetts, États-Unis) est un astronome et physicien américain, frère d'un autre astronome William Henry Pickering.
Edward Charles Pickering (19 juillet 1846 à Boston - 3 février 1919 (à 72 ans) à Cambridge, Massachusetts, États-Unis) est un astronome et physicien américain, frère d'un autre astronome William Henry Pickering.  Pieter Zeeman, né le 25 mai 1865 à Zonnemaire (Zélande, Pays-Bas) et mort le 9 octobre 1943 à Amsterdam, est un physicien néerlandais.
Pieter Zeeman, né le 25 mai 1865 à Zonnemaire (Zélande, Pays-Bas) et mort le 9 octobre 1943 à Amsterdam, est un physicien néerlandais.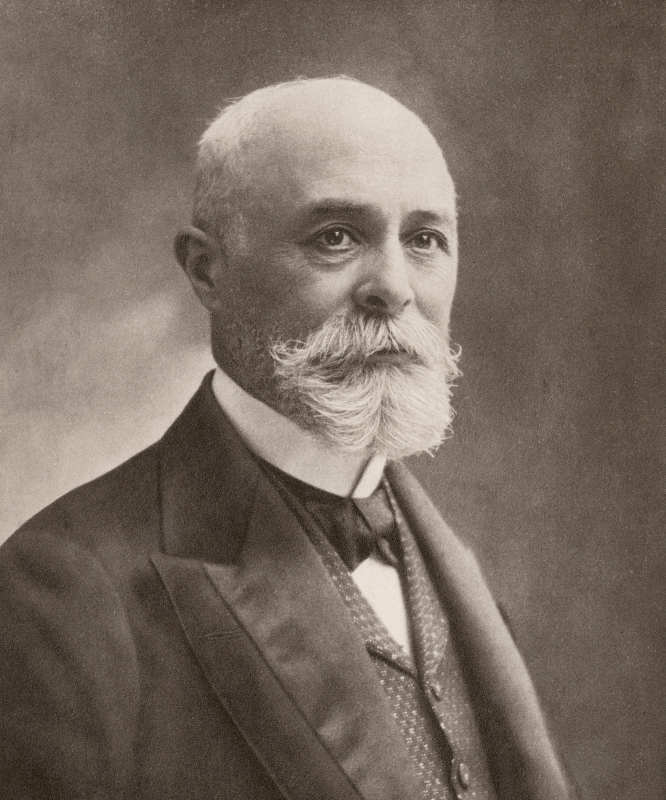 Antoine Henri Becquerel, né le 15 décembre 1852 à Paris et mort le 25 août 1908 au Croisic, est un physicien français. Il est lauréat de la moitié du prix Nobel de physique de 1903 (partagé avec Marie Curie et son mari Pierre Curie).
Antoine Henri Becquerel, né le 15 décembre 1852 à Paris et mort le 25 août 1908 au Croisic, est un physicien français. Il est lauréat de la moitié du prix Nobel de physique de 1903 (partagé avec Marie Curie et son mari Pierre Curie). 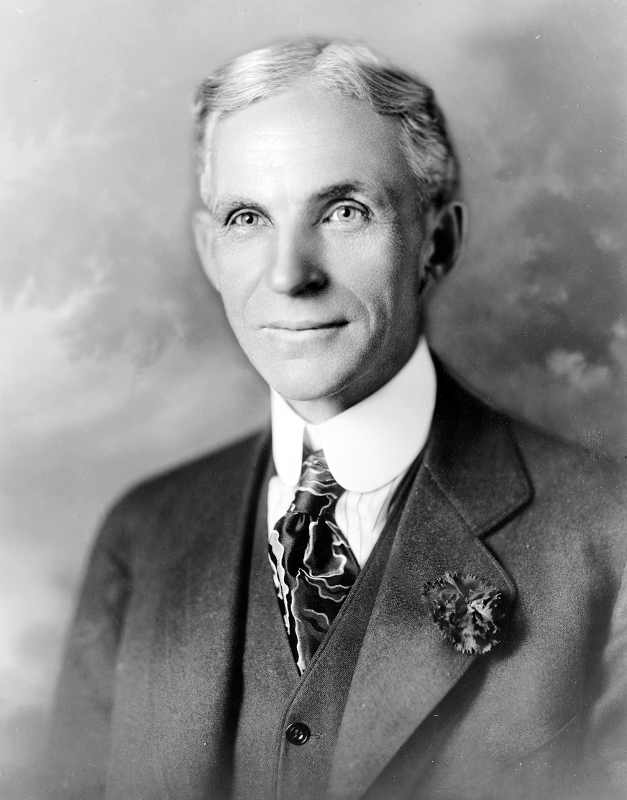 Henry Ford, né le 30 juillet 1863 à Dearborn (Michigan, États-Unis) et mort le 7 avril 1947 dans la même ville, est un industriel américain de la première moitié du XXe siècle et le fondateur du constructeur automobile Ford.
Henry Ford, né le 30 juillet 1863 à Dearborn (Michigan, États-Unis) et mort le 7 avril 1947 dans la même ville, est un industriel américain de la première moitié du XXe siècle et le fondateur du constructeur automobile Ford. 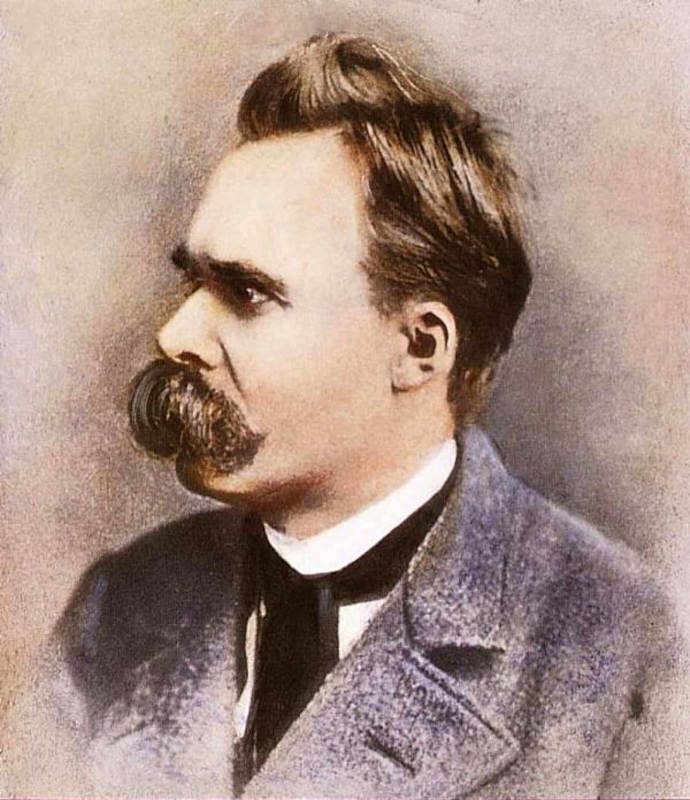 Friedrich Nietzsche est un philologue, philosophe, poète et pianiste allemand, né le 15 octobre 1844 à Röcken, en province de Saxe, et mort le 25 août 1900 à Weimar, en Saxe-Weimar-Eisenach.
Friedrich Nietzsche est un philologue, philosophe, poète et pianiste allemand, né le 15 octobre 1844 à Röcken, en province de Saxe, et mort le 25 août 1900 à Weimar, en Saxe-Weimar-Eisenach.  Hippolyte Morestin est un médecin et chirurgien français né le 1er septembre 1869 à Basse-Pointe (Martinique) et mort le 12 février 1919 à Paris.
Hippolyte Morestin est un médecin et chirurgien français né le 1er septembre 1869 à Basse-Pointe (Martinique) et mort le 12 février 1919 à Paris.  Garry (ou Garri ou Gary) Kimovitch Kasparov, né le 13 avril 1963 à Bakou (RSS d'Azerbaïdjan, URSS), est un joueur d'échecs soviétique puis russe d'origine arménienne.
Garry (ou Garri ou Gary) Kimovitch Kasparov, né le 13 avril 1963 à Bakou (RSS d'Azerbaïdjan, URSS), est un joueur d'échecs soviétique puis russe d'origine arménienne.  Georg Friedrich Bernhard Riemann, né le 17 septembre 1826 à Breselenz, Royaume de Hanovre, mort le 20 juillet 1866 à Selasca, hameau de la commune de Verbania, Italie, est un mathématicien allemand.
Georg Friedrich Bernhard Riemann, né le 17 septembre 1826 à Breselenz, Royaume de Hanovre, mort le 20 juillet 1866 à Selasca, hameau de la commune de Verbania, Italie, est un mathématicien allemand. 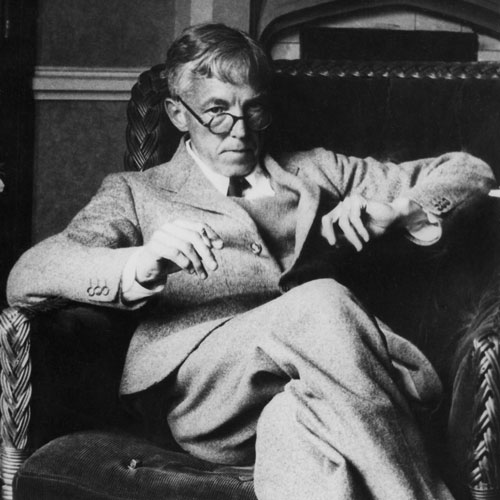 Godfrey Harold Hardy est un mathématicien britannique, né le 7 février 1877 à Cranleigh (en) (comté de Surrey) et mort le 1er décembre 1947 à Cambridge.
Godfrey Harold Hardy est un mathématicien britannique, né le 7 février 1877 à Cranleigh (en) (comté de Surrey) et mort le 1er décembre 1947 à Cambridge. 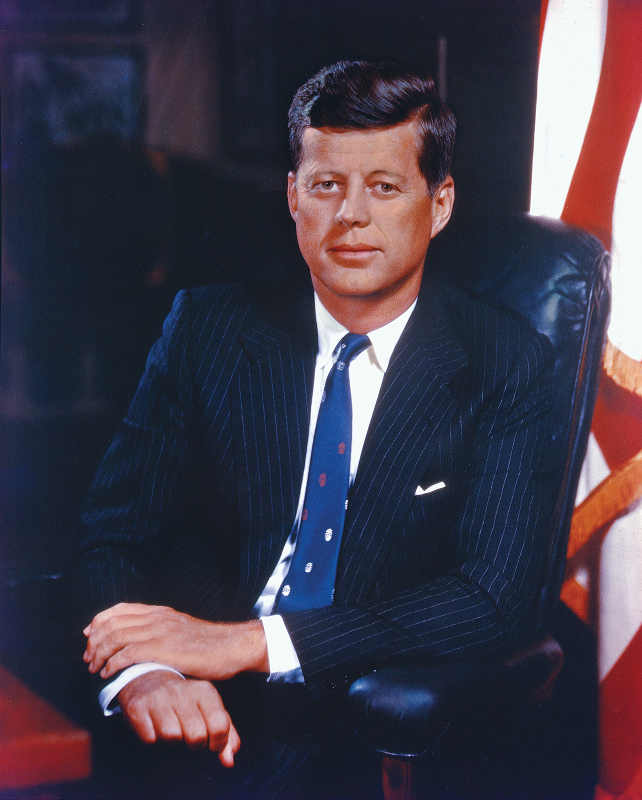 John Fitzgerald Kennedy, dit Jack Kennedy, communément appelé John Kennedy et par ses initiales JFK, né le 29 mai 1917 à Brookline (Massachusetts) et mort assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas (Texas), est un homme d'État américain, 35e président des États-Unis. Entré en fonction le 20 janvier 1961, il est, à 43 ans, le plus jeune président élu des États-Unis, et également le plus jeune président à mourir, moins de trois ans après son entrée à la Maison-Blanche, à l'âge de 46 ans.
John Fitzgerald Kennedy, dit Jack Kennedy, communément appelé John Kennedy et par ses initiales JFK, né le 29 mai 1917 à Brookline (Massachusetts) et mort assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas (Texas), est un homme d'État américain, 35e président des États-Unis. Entré en fonction le 20 janvier 1961, il est, à 43 ans, le plus jeune président élu des États-Unis, et également le plus jeune président à mourir, moins de trois ans après son entrée à la Maison-Blanche, à l'âge de 46 ans.  Les frères Orville Wright (19 août 1871 - 30 janvier 1948 soit 76 ans) et Wilbur Wright (16 avril 1867 - 30 mai 1912 soit 45 ans) sont deux célèbres pionniers américains de l'aviation, à la fois chercheurs, ingénieurs, concepteurs, constructeurs et pilotes.
Les frères Orville Wright (19 août 1871 - 30 janvier 1948 soit 76 ans) et Wilbur Wright (16 avril 1867 - 30 mai 1912 soit 45 ans) sont deux célèbres pionniers américains de l'aviation, à la fois chercheurs, ingénieurs, concepteurs, constructeurs et pilotes.  Les frères Orville Wright (19 août 1871 - 30 janvier 1948 soit 76 ans) et Wilbur Wright (16 avril 1867 - 30 mai 1912 soit 45 ans) sont deux célèbres pionniers américains de l'aviation, à la fois chercheurs, ingénieurs, concepteurs, constructeurs et pilotes.
Les frères Orville Wright (19 août 1871 - 30 janvier 1948 soit 76 ans) et Wilbur Wright (16 avril 1867 - 30 mai 1912 soit 45 ans) sont deux célèbres pionniers américains de l'aviation, à la fois chercheurs, ingénieurs, concepteurs, constructeurs et pilotes.  Aaron Klug (11 août 1926 à Zelvas (Lituanie) et mort le 20 novembre 2018 à Cambridge (Royaume-Uni)1) est un physicien biologique et chimiste britannique d'origine juive lituanienne.
Aaron Klug (11 août 1926 à Zelvas (Lituanie) et mort le 20 novembre 2018 à Cambridge (Royaume-Uni)1) est un physicien biologique et chimiste britannique d'origine juive lituanienne. Charles de Gaulle, communément appelé le général de Gaulle ou parfois simplement le Général, né le 22 novembre 1890 à Lille et mort le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises, est un militaire, résistant, homme d'État et écrivain français.
Charles de Gaulle, communément appelé le général de Gaulle ou parfois simplement le Général, né le 22 novembre 1890 à Lille et mort le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises, est un militaire, résistant, homme d'État et écrivain français. .jpg) Adolf Hitler est un idéologue et homme d'État allemand, né le 20 avril 1889 à Braunau am Inn en Autriche-Hongrie (aujourd'hui en Autriche et toujours ville-frontière avec l’Allemagne) et mort par suicide le 30 avril 1945 à Berlin. Fondateur et figure centrale du nazisme, il prend le pouvoir en Allemagne en 1933 et instaure une dictature totalitaire, impérialiste, antisémite, raciste et xénophobe désignée sous le nom de Troisième Reich.
Membre du Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP, le parti nazi), créé en 1920, il s'impose à la tête du mouvement en 1921 et tente en 1923 un coup d'État qui échoue. Il met à profit sa courte peine de prison pour rédiger le livre Mein Kampf dans lequel il expose ses conceptions racistes et ultranationalistes.
Dans les années 1920, dans un climat de violence politique, il occupe une place croissante dans la vie publique allemande jusqu'à devenir chancelier le 30 janvier 1933, pendant la Grande Dépression. Son régime met très rapidement en place les premiers camps de concentration destinés à la répression des opposants politiques (notamment socialistes, communistes et syndicalistes). En août 1934, après une violente opération d’élimination physique d’opposants et rivaux — connue sous le nom de nuit des Longs Couteaux — et la mort du vieux maréchal Hindenburg, président du Reich, il se fait plébisciter chef de l'État. Il porte dès lors le double titre de « Führer » (en français : « guide ») et « chancelier du Reich », sabordant ainsi la république de Weimar et mettant fin à la première démocratie parlementaire en Allemagne. La politique qu'il conduit est pangermaniste, antisémite, revanchiste et belliqueuse. Son régime adopte en 1935 une législation anti-juive et les nazis prennent le contrôle de la société allemande (travailleurs, jeunesse, médias et cinéma, industrie, sciences, etc.).
Adolf Hitler est un idéologue et homme d'État allemand, né le 20 avril 1889 à Braunau am Inn en Autriche-Hongrie (aujourd'hui en Autriche et toujours ville-frontière avec l’Allemagne) et mort par suicide le 30 avril 1945 à Berlin. Fondateur et figure centrale du nazisme, il prend le pouvoir en Allemagne en 1933 et instaure une dictature totalitaire, impérialiste, antisémite, raciste et xénophobe désignée sous le nom de Troisième Reich.
Membre du Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP, le parti nazi), créé en 1920, il s'impose à la tête du mouvement en 1921 et tente en 1923 un coup d'État qui échoue. Il met à profit sa courte peine de prison pour rédiger le livre Mein Kampf dans lequel il expose ses conceptions racistes et ultranationalistes.
Dans les années 1920, dans un climat de violence politique, il occupe une place croissante dans la vie publique allemande jusqu'à devenir chancelier le 30 janvier 1933, pendant la Grande Dépression. Son régime met très rapidement en place les premiers camps de concentration destinés à la répression des opposants politiques (notamment socialistes, communistes et syndicalistes). En août 1934, après une violente opération d’élimination physique d’opposants et rivaux — connue sous le nom de nuit des Longs Couteaux — et la mort du vieux maréchal Hindenburg, président du Reich, il se fait plébisciter chef de l'État. Il porte dès lors le double titre de « Führer » (en français : « guide ») et « chancelier du Reich », sabordant ainsi la république de Weimar et mettant fin à la première démocratie parlementaire en Allemagne. La politique qu'il conduit est pangermaniste, antisémite, revanchiste et belliqueuse. Son régime adopte en 1935 une législation anti-juive et les nazis prennent le contrôle de la société allemande (travailleurs, jeunesse, médias et cinéma, industrie, sciences, etc.).
 Albert Abraham Michelson, né le 19 décembre 1852 à Strelno en Prusse dans la province de Posnanie et mort le 9 mai 1931 à Pasadena, en Californie, est un physicien américain. Il a reçu le prix Nobel de physique de 1907 « pour ses instruments optiques de précision et les études spectroscopiques et métrologiques qu'il a menés grâce à ces appareils », devenant ainsi le premier récipiendaire américain du prix de physique. Il reçut par ailleurs la médaille Copley la même année.
Albert Abraham Michelson, né le 19 décembre 1852 à Strelno en Prusse dans la province de Posnanie et mort le 9 mai 1931 à Pasadena, en Californie, est un physicien américain. Il a reçu le prix Nobel de physique de 1907 « pour ses instruments optiques de précision et les études spectroscopiques et métrologiques qu'il a menés grâce à ces appareils », devenant ainsi le premier récipiendaire américain du prix de physique. Il reçut par ailleurs la médaille Copley la même année.
 Alexander Fleming est un médecin, biologiste et pharmacologue britannique, né le 6 août 1881 à Darvel, Ayrshire en Écosse et mort le 11 mars 1955 à Londres. Il a publié de nombreux articles concernant la bactériologie, l'immunologie et la chimiothérapie.
Ses découvertes les plus connues sont celle de l'antibiotique appelé pénicilline qu'il a isolée à partir du champignon Penicillium notatum en 1928, découverte pour laquelle il a partagé le prix Nobel de physiologie ou médecine avec Howard Walter Florey et Ernst Boris Chain en 1945, et celle de l'enzyme lysozyme en 1922.
En fait, il n'a fait qu une redécouverte puisque, dès la fin du XIXe siècle dans sa thèse de pharmacie, Ernest Duchesne, élève officier pharmacien de l'école de santé militaire de Lyon, avait fortement évoqué le rôle antibiotique des pénicillium.
Alexander Fleming est un médecin, biologiste et pharmacologue britannique, né le 6 août 1881 à Darvel, Ayrshire en Écosse et mort le 11 mars 1955 à Londres. Il a publié de nombreux articles concernant la bactériologie, l'immunologie et la chimiothérapie.
Ses découvertes les plus connues sont celle de l'antibiotique appelé pénicilline qu'il a isolée à partir du champignon Penicillium notatum en 1928, découverte pour laquelle il a partagé le prix Nobel de physiologie ou médecine avec Howard Walter Florey et Ernst Boris Chain en 1945, et celle de l'enzyme lysozyme en 1922.
En fait, il n'a fait qu une redécouverte puisque, dès la fin du XIXe siècle dans sa thèse de pharmacie, Ernest Duchesne, élève officier pharmacien de l'école de santé militaire de Lyon, avait fortement évoqué le rôle antibiotique des pénicillium.
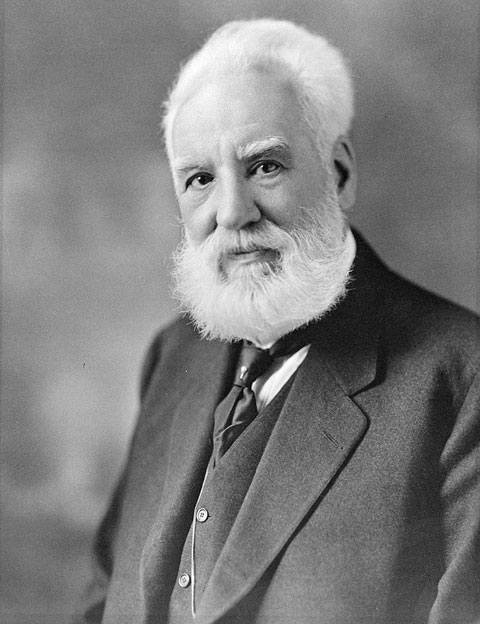 Alexander Graham Bell, né le 3 mars 1847 à Édimbourg en Écosse et mort le 2 août 1922 à Beinn Bhreagh au Canada, est un scientifique, un ingénieur et un inventeur scotto-canadien, naturalisé américain en 1882, qui est surtout connu pour l'invention du téléphone, pour laquelle l'antériorité d'Antonio Meucci a depuis été officiellement reconnue le 11 juin 2002 par la Chambre des représentants des États-Unis. Il a été lauréat de la médaille Hughes en 1913.
La mère et la femme (Mabel Gardiner Hubbard) d'Alexander Bell étaient sourdes, ce qui a encouragé Bell à consacrer sa vie à apprendre à parler aux sourds. Il était en effet professeur de diction à l'université de Boston et un spécialiste de l'élocution, profession connue aujourd'hui sous les noms de phonologue ou phoniatre. Le père, le grand-père et le frère de Bell se sont joints à son travail sur l'élocution et la parole. Ses recherches sur l'audition et la parole l'ont conduit à construire des appareils auditifs, dont le couronnement fut le premier brevet pour un téléphone en 1876. Toutefois, Bell considéra par la suite son invention la plus connue comme une intrusion dans son travail de scientifique et refusa même d'avoir un téléphone dans son laboratoire.
D'autres inventions marquèrent la vie d'Alexander Graham Bell : les travaux exploratoires en télécommunications optiques, l'hydroptère en aéronautique. En 1888, il devint l'un des membres fondateurs de la National Geographic Society.
Alexander Graham Bell, né le 3 mars 1847 à Édimbourg en Écosse et mort le 2 août 1922 à Beinn Bhreagh au Canada, est un scientifique, un ingénieur et un inventeur scotto-canadien, naturalisé américain en 1882, qui est surtout connu pour l'invention du téléphone, pour laquelle l'antériorité d'Antonio Meucci a depuis été officiellement reconnue le 11 juin 2002 par la Chambre des représentants des États-Unis. Il a été lauréat de la médaille Hughes en 1913.
La mère et la femme (Mabel Gardiner Hubbard) d'Alexander Bell étaient sourdes, ce qui a encouragé Bell à consacrer sa vie à apprendre à parler aux sourds. Il était en effet professeur de diction à l'université de Boston et un spécialiste de l'élocution, profession connue aujourd'hui sous les noms de phonologue ou phoniatre. Le père, le grand-père et le frère de Bell se sont joints à son travail sur l'élocution et la parole. Ses recherches sur l'audition et la parole l'ont conduit à construire des appareils auditifs, dont le couronnement fut le premier brevet pour un téléphone en 1876. Toutefois, Bell considéra par la suite son invention la plus connue comme une intrusion dans son travail de scientifique et refusa même d'avoir un téléphone dans son laboratoire.
D'autres inventions marquèrent la vie d'Alexander Graham Bell : les travaux exploratoires en télécommunications optiques, l'hydroptère en aéronautique. En 1888, il devint l'un des membres fondateurs de la National Geographic Society.
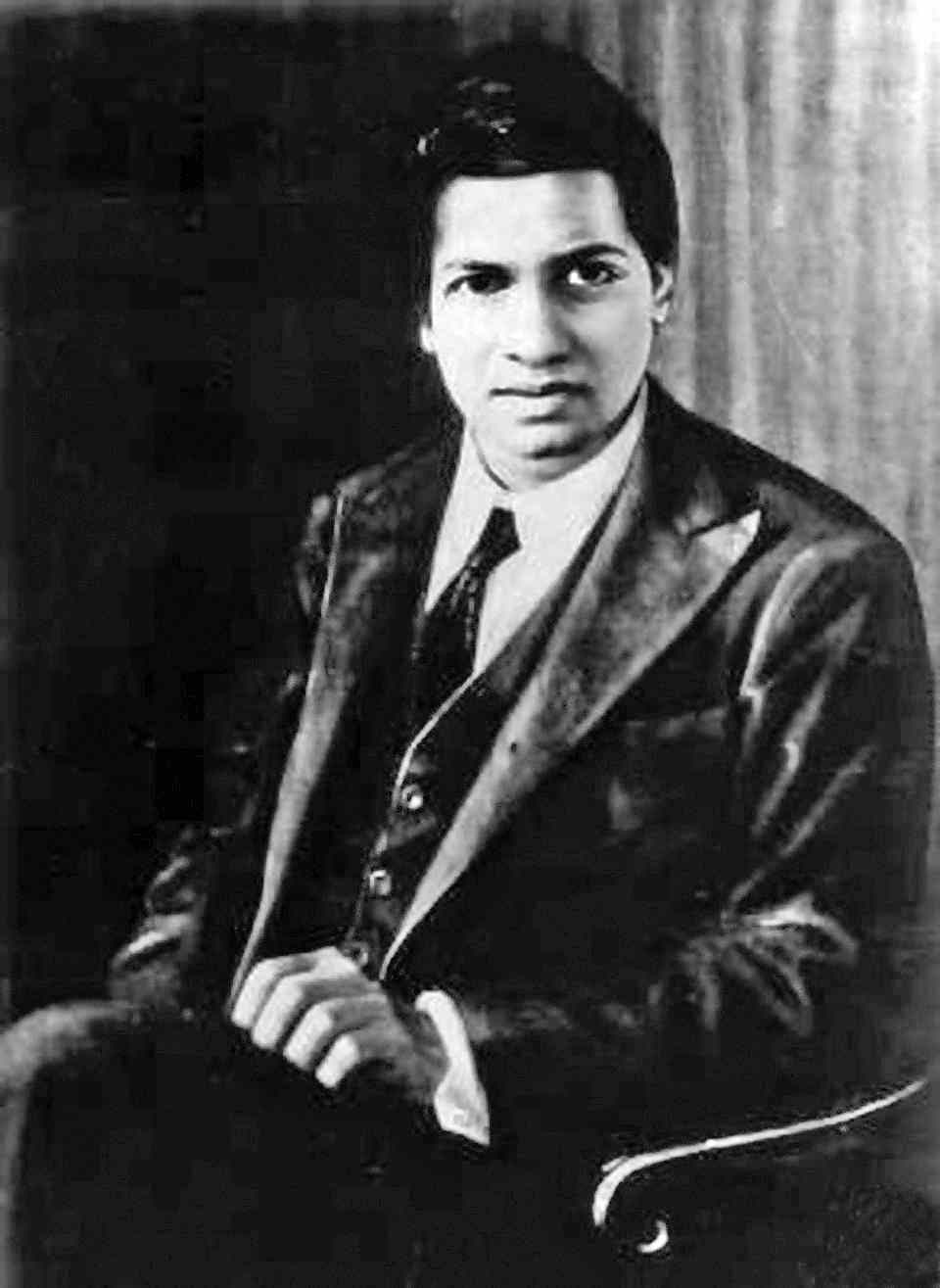 Srinivasa Ramanujan, né le 22 décembre 1887 à Erode et mort le 26 avril 1920 à Kumbakonam, est un mathématicien indien.
Issu d'une famille modeste de brahmanes orthodoxes, il est autodidacte, faisant toujours preuve d'une pensée indépendante et originale. Il apprend seul les mathématiques à partir de deux livres qu'il s'est procurés avant l'âge de seize ans, ouvrages qui lui permettent d'établir une grande quantité de résultats sur la théorie des nombres, sur les fractions continues et sur les séries divergentes, tandis qu'il se crée son propre système de notations. Jugeant son entourage académique dépassé, il publie plusieurs articles dans des journaux mathématiques indiens et tente d'intéresser les mathématiciens européens à son travail par des lettres qu'il leur envoie.
Une de ces lettres, envoyée en janvier 1913 à Godfrey Harold Hardy, contient une longue liste de formules et de théorèmes sans démonstration. Hardy considère tout d'abord cet envoi inhabituel comme une supercherie, puis en discute longuement avec John Littlewood pour aboutir à la conviction que son auteur est certainement un « génie », un qualificatif souvent repris de nos jours. Hardy répond en invitant Ramanujan à venir en Angleterre ; une collaboration fructueuse, en compagnie de Littlewood, en résulte.
Affecté toute sa vie par des problèmes de santé, Ramanujan voit son état empirer lors de son séjour en Angleterre ; il retourne en Inde en 1919 où il meurt peu de temps après à Kumbakonam à l'âge de trente-deux ans. Il laisse derrière lui des cahiers entiers de résultats non démontrés (appelés les cahiers de Ramanujan) qui, en ce début de XXIe siècle, continuent à être étudiés.
Ramanujan a travaillé principalement sur les fonctions elliptiques et sur la théorie analytique des nombres ; il est devenu célèbre pour ses résultats calculatoires impliquant des constantes telles que π et e, les nombres premiers ou encore la fonction partition d'un entier, qu'il a étudiée avec Hardy. Grand créateur de formules mathématiques, il en a inventé plusieurs milliers qui se sont pratiquement toutes révélées exactes, mais dont certaines ne purent être démontrées qu'après 1980 ; à propos de certaines d'entre elles, Hardy, stupéfié par leur originalité, a déclaré qu’« un seul coup d'œil suffisait à se rendre compte qu'elles ne pouvaient être pensées que par un mathématicien de tout premier rang. Elles devaient être vraies, car si elles avaient été fausses, personne n'aurait eu assez d'imagination pour les inventer ».
Srinivasa Ramanujan, né le 22 décembre 1887 à Erode et mort le 26 avril 1920 à Kumbakonam, est un mathématicien indien.
Issu d'une famille modeste de brahmanes orthodoxes, il est autodidacte, faisant toujours preuve d'une pensée indépendante et originale. Il apprend seul les mathématiques à partir de deux livres qu'il s'est procurés avant l'âge de seize ans, ouvrages qui lui permettent d'établir une grande quantité de résultats sur la théorie des nombres, sur les fractions continues et sur les séries divergentes, tandis qu'il se crée son propre système de notations. Jugeant son entourage académique dépassé, il publie plusieurs articles dans des journaux mathématiques indiens et tente d'intéresser les mathématiciens européens à son travail par des lettres qu'il leur envoie.
Une de ces lettres, envoyée en janvier 1913 à Godfrey Harold Hardy, contient une longue liste de formules et de théorèmes sans démonstration. Hardy considère tout d'abord cet envoi inhabituel comme une supercherie, puis en discute longuement avec John Littlewood pour aboutir à la conviction que son auteur est certainement un « génie », un qualificatif souvent repris de nos jours. Hardy répond en invitant Ramanujan à venir en Angleterre ; une collaboration fructueuse, en compagnie de Littlewood, en résulte.
Affecté toute sa vie par des problèmes de santé, Ramanujan voit son état empirer lors de son séjour en Angleterre ; il retourne en Inde en 1919 où il meurt peu de temps après à Kumbakonam à l'âge de trente-deux ans. Il laisse derrière lui des cahiers entiers de résultats non démontrés (appelés les cahiers de Ramanujan) qui, en ce début de XXIe siècle, continuent à être étudiés.
Ramanujan a travaillé principalement sur les fonctions elliptiques et sur la théorie analytique des nombres ; il est devenu célèbre pour ses résultats calculatoires impliquant des constantes telles que π et e, les nombres premiers ou encore la fonction partition d'un entier, qu'il a étudiée avec Hardy. Grand créateur de formules mathématiques, il en a inventé plusieurs milliers qui se sont pratiquement toutes révélées exactes, mais dont certaines ne purent être démontrées qu'après 1980 ; à propos de certaines d'entre elles, Hardy, stupéfié par leur originalité, a déclaré qu’« un seul coup d'œil suffisait à se rendre compte qu'elles ne pouvaient être pensées que par un mathématicien de tout premier rang. Elles devaient être vraies, car si elles avaient été fausses, personne n'aurait eu assez d'imagination pour les inventer ».
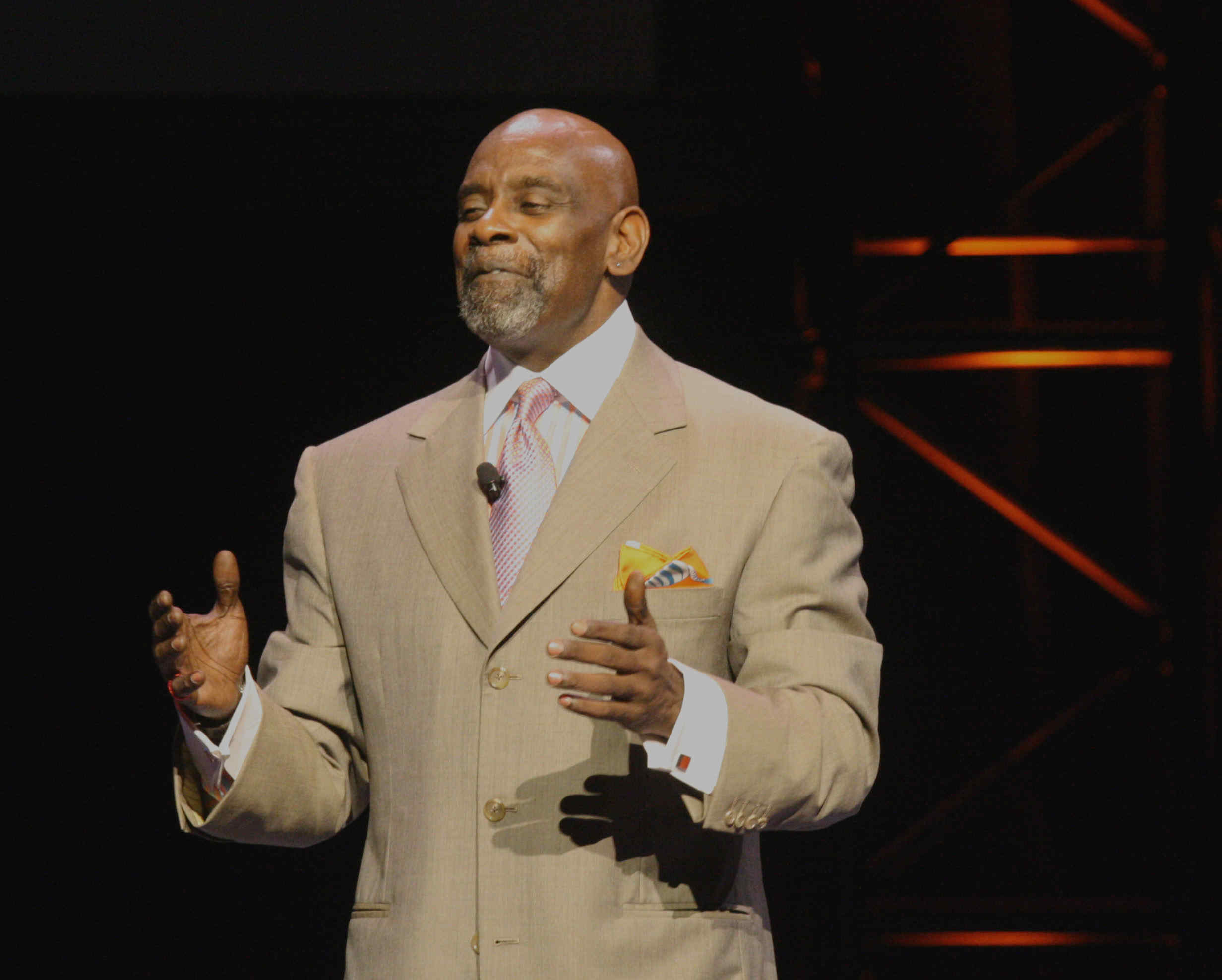 Christopher Paul Gardner (né le 9 février 1954 à Milwaukee, Wisconsin) est un entrepreneur, financier et philanthrope américain.
Aujourd'hui multi-millionnaire, Christopher Gardner a vécu, au début des années 1980, comme sans-abri avec son fils, Christopher, Jr., qu'il a élevé durant plus d'un an. En 2006, il est chef de la direction de sa propre entreprise, Gardner Rich & Co (en), basée à Chicago, en Illinois, où il réside quand il ne vit pas à New York. Par la puissance de son mental, il a su transgresser sa condition sociale et est devenu un homme hors du commun qui illustre parfaitement le rêve américain des années 1960 et 70. Gardner crédite sa ténacité et son succès à sa spiritualité qui lui a été transmise par sa mère, Bettye Jean Triplett, née Gardner et à la hauteur des attentes placées en lui par ses enfants, Chris Jr. (né en 1981) et sa fille, Jacintha (né en 1985).
Christopher Paul Gardner (né le 9 février 1954 à Milwaukee, Wisconsin) est un entrepreneur, financier et philanthrope américain.
Aujourd'hui multi-millionnaire, Christopher Gardner a vécu, au début des années 1980, comme sans-abri avec son fils, Christopher, Jr., qu'il a élevé durant plus d'un an. En 2006, il est chef de la direction de sa propre entreprise, Gardner Rich & Co (en), basée à Chicago, en Illinois, où il réside quand il ne vit pas à New York. Par la puissance de son mental, il a su transgresser sa condition sociale et est devenu un homme hors du commun qui illustre parfaitement le rêve américain des années 1960 et 70. Gardner crédite sa ténacité et son succès à sa spiritualité qui lui a été transmise par sa mère, Bettye Jean Triplett, née Gardner et à la hauteur des attentes placées en lui par ses enfants, Chris Jr. (né en 1981) et sa fille, Jacintha (né en 1985).
 John Forbes Nash, Jr., né le 13 juin 1928 à Bluefield (Virginie-Occidentale) et mort le 23 mai 2015 à Monroe Township (New Jersey), est un mathématicien et économiste américain. Il a travaillé sur la théorie des jeux, la géométrie différentielle et les équations aux dérivées partielles.
Il est le seul mathématicien et économiste à être lauréat à la fois du prix dit Nobel d'économie en 1994 et du prix Abel pour les mathématiques en 2015.
À l'aube d'une carrière mathématique prometteuse, John Nash a commencé à souffrir de schizophrénie. Il a appris à vivre avec cette maladie seulement vingt-cinq ans plus tard. Sa vie est racontée de façon romancée dans le film Un homme d'exception.
John Forbes Nash, Jr., né le 13 juin 1928 à Bluefield (Virginie-Occidentale) et mort le 23 mai 2015 à Monroe Township (New Jersey), est un mathématicien et économiste américain. Il a travaillé sur la théorie des jeux, la géométrie différentielle et les équations aux dérivées partielles.
Il est le seul mathématicien et économiste à être lauréat à la fois du prix dit Nobel d'économie en 1994 et du prix Abel pour les mathématiques en 2015.
À l'aube d'une carrière mathématique prometteuse, John Nash a commencé à souffrir de schizophrénie. Il a appris à vivre avec cette maladie seulement vingt-cinq ans plus tard. Sa vie est racontée de façon romancée dans le film Un homme d'exception.
 Don Shirley est un pianiste et compositeur américain d'origine jamaïcaine, né le 29 janvier 1927 à Pensacola en Floride, et mort le 6 avril 2013 à Manhattan. Donald Walbridge Shirley est né en Floride, de Stella Gertrude (née Young ; 1903-1936) et Edwin S. Shirley (1885-1982), immigrants de Jamaïque aux États-Unis. Kingston, en Jamaïque, est parfois mentionné comme son lieu de naissance, à cause des promoteurs qui l'ont faussement présenté natif de Jamaïque. Son père est prêtre épiscopalien. Sa mère, enseignante, meurt quand Donald a neuf ans. Celui-ci a trois frères et une sœur : le Dr Calvin Shirley (1921-2012), le Dr Edwin Shirley, Jr. (1922-2006), Stella Lucille Shirley (1924-1926) et Maurice Shirley (né en 1936). Il a aussi une demi-sœur nommée Edwina Nalchawee (née vers 1955).
Don Shirley est un pianiste et compositeur américain d'origine jamaïcaine, né le 29 janvier 1927 à Pensacola en Floride, et mort le 6 avril 2013 à Manhattan. Donald Walbridge Shirley est né en Floride, de Stella Gertrude (née Young ; 1903-1936) et Edwin S. Shirley (1885-1982), immigrants de Jamaïque aux États-Unis. Kingston, en Jamaïque, est parfois mentionné comme son lieu de naissance, à cause des promoteurs qui l'ont faussement présenté natif de Jamaïque. Son père est prêtre épiscopalien. Sa mère, enseignante, meurt quand Donald a neuf ans. Celui-ci a trois frères et une sœur : le Dr Calvin Shirley (1921-2012), le Dr Edwin Shirley, Jr. (1922-2006), Stella Lucille Shirley (1924-1926) et Maurice Shirley (né en 1936). Il a aussi une demi-sœur nommée Edwina Nalchawee (née vers 1955).
 Katherine Coleman Goble Johnson, née le 26 août 1918 à White Sulphur Springs (Virginie-Occidentale) et morte le 24 février 2020 à Newport News (Virginie), est une physicienne, mathématicienne et ingénieure spatiale américaine.
Elle contribue aux programmes aéronautiques et spatiaux du National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) puis de la National Aeronautics and Space Administration (NASA).
Réputée pour la fiabilité de ses calculs en navigation astronomique, elle conduit des travaux techniques à la NASA qui s'étalent sur des décennies. Durant cette période, elle calcule et vérifie les trajectoires, les fenêtres de lancement et les plans d'urgence de nombreux vols du programme Mercury, dont les premières missions de John Glenn et Alan Shepard, et des procédures de rendez-vous spatial pour Apollo 11 en 1969 jusqu'au programme de la navette spatiale américaine. Ses calculs furent essentiels à la conduite effective de ces missions. Elle travaille enfin sur une mission pour Mars.
En 2015, elle reçoit la médaille présidentielle de la Liberté et, en 2019, le Congrès des États-Unis lui décerne la médaille d'or du Congrès.
Katherine Coleman Goble Johnson, née le 26 août 1918 à White Sulphur Springs (Virginie-Occidentale) et morte le 24 février 2020 à Newport News (Virginie), est une physicienne, mathématicienne et ingénieure spatiale américaine.
Elle contribue aux programmes aéronautiques et spatiaux du National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) puis de la National Aeronautics and Space Administration (NASA).
Réputée pour la fiabilité de ses calculs en navigation astronomique, elle conduit des travaux techniques à la NASA qui s'étalent sur des décennies. Durant cette période, elle calcule et vérifie les trajectoires, les fenêtres de lancement et les plans d'urgence de nombreux vols du programme Mercury, dont les premières missions de John Glenn et Alan Shepard, et des procédures de rendez-vous spatial pour Apollo 11 en 1969 jusqu'au programme de la navette spatiale américaine. Ses calculs furent essentiels à la conduite effective de ces missions. Elle travaille enfin sur une mission pour Mars.
En 2015, elle reçoit la médaille présidentielle de la Liberté et, en 2019, le Congrès des États-Unis lui décerne la médaille d'or du Congrès.
 Dorothy Vaughan née Dorothy Jean Johnson (20 septembre 1910 - 10 novembre 2008) est une mathématicienne et informaticienne américaine qui a travaillé pour le National Advisory Committee for Aeronautics (NACA), puis à la National Aeronautics and Space Administration (NASA) qui a contribué aux premières décennies du programme spatial américain et qui fut la première directrice de division afro-américaine du NACA puis de la NASA.
Dorothy Vaughan née Dorothy Jean Johnson (20 septembre 1910 - 10 novembre 2008) est une mathématicienne et informaticienne américaine qui a travaillé pour le National Advisory Committee for Aeronautics (NACA), puis à la National Aeronautics and Space Administration (NASA) qui a contribué aux premières décennies du programme spatial américain et qui fut la première directrice de division afro-américaine du NACA puis de la NASA.
.jpg) Mary Jackson née Mary Winston, née le 9 avril 1921 à Hampton dans l'état de Virginie, morte le 11 février 2005 à Hampton, est une mathématicienne et ingénieure en aérospatiale américaine.
Elle travaille au National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) qui devient la NASA en 1958.
Le 25 juin 2020, l'administrateur de la NASA honore sa mémoire en baptisant de son nom les bâtiments du siège de la NASA, à Washington.
Mary Jackson née Mary Winston, née le 9 avril 1921 à Hampton dans l'état de Virginie, morte le 11 février 2005 à Hampton, est une mathématicienne et ingénieure en aérospatiale américaine.
Elle travaille au National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) qui devient la NASA en 1958.
Le 25 juin 2020, l'administrateur de la NASA honore sa mémoire en baptisant de son nom les bâtiments du siège de la NASA, à Washington.
 Rosa Louise McCauley Parks, dite Rosa Parks [ɹoʊzə pɑɹks], née le 4 février 1913 à Tuskegee en Alabama et morte le 24 octobre 2005 à Détroit dans le Michigan, est une femme afro-américaine, figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, surnommée « mère du mouvement des droits civiques » par le Congrès américain.
Elle est devenue célèbre le 1er décembre 1955, à Montgomery (Alabama) en refusant de céder sa place à un passager blanc dans l'autobus conduit par James F. Blake. Arrêtée par la police, elle se voit infliger une amende de quinze dollars. Le 5 décembre 1955, elle fait appel de ce jugement. Un jeune pasteur noir de vingt-six ans, Martin Luther King, avec le concours de Ralph Abernathy, pasteur de la First Baptist Church in America, lance alors une campagne de protestation et de boycott contre la compagnie de bus qui dure 380 jours. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis casse les lois ségrégationnistes dans les bus, les déclarant anticonstitutionnelles.
Rosa Louise McCauley Parks, dite Rosa Parks [ɹoʊzə pɑɹks], née le 4 février 1913 à Tuskegee en Alabama et morte le 24 octobre 2005 à Détroit dans le Michigan, est une femme afro-américaine, figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, surnommée « mère du mouvement des droits civiques » par le Congrès américain.
Elle est devenue célèbre le 1er décembre 1955, à Montgomery (Alabama) en refusant de céder sa place à un passager blanc dans l'autobus conduit par James F. Blake. Arrêtée par la police, elle se voit infliger une amende de quinze dollars. Le 5 décembre 1955, elle fait appel de ce jugement. Un jeune pasteur noir de vingt-six ans, Martin Luther King, avec le concours de Ralph Abernathy, pasteur de la First Baptist Church in America, lance alors une campagne de protestation et de boycott contre la compagnie de bus qui dure 380 jours. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis casse les lois ségrégationnistes dans les bus, les déclarant anticonstitutionnelles.
 Le jeune Saroo, à l'âge de cinq ans, est accidentellement séparé de sa famille. À la recherche de sa famille, il aventure les dures épreuves en traversant l'Inde. Il est ensuite adopté par un couple australien habitant Hobart, en Tasmanie. Désirant retrouver sa famille biologique, il recherche son village natal au moyen des images de Google Earth, ce qui lui permet de le localiser en 2011 et de rencontrer sa mère l'année suivante, après 25 ans de séparation.
Le jeune Saroo, à l'âge de cinq ans, est accidentellement séparé de sa famille. À la recherche de sa famille, il aventure les dures épreuves en traversant l'Inde. Il est ensuite adopté par un couple australien habitant Hobart, en Tasmanie. Désirant retrouver sa famille biologique, il recherche son village natal au moyen des images de Google Earth, ce qui lui permet de le localiser en 2011 et de rencontrer sa mère l'année suivante, après 25 ans de séparation.
 Loving v. Virginia
Loving v. Virginia Sir Winston Churchill , né le 30 novembre 1874 à Woodstock et mort le 24 janvier 1965 à Londres, est un homme d'État britannique. Sa ténacité face au nazisme, son action décisive en tant que Premier ministre du Royaume-Uni durant la Seconde Guerre mondiale, joints à ses talents d'orateur et à ses bons mots, ont fait de lui un des hommes politiques les plus reconnus du XXe siècle. Ne disposant pas d'une fortune personnelle, il tire l'essentiel de ses revenus de sa plume. Ses dons d'écriture seront couronnés à la fin de sa vie par le prix Nobel de littérature. Il est également un peintre estimé.
Winston Churchill appartient à la famille aristocratique Spencer, dont il est la plus brillante figure depuis son ancêtre John Churchill, 1er duc de Marlborough (1650-1722), auquel il a consacré une biographie. Fils d'un homme politique conservateur atypique n'ayant pas connu le succès escompté et mort relativement jeune, il ambitionne très vite de réussir dans ce domaine. De fait, s'il débute dans la carrière militaire et combat en Inde, au Soudan et lors de la seconde guerre des Boers, il y cherche surtout l'occasion de briller et de se faire connaître. Cette recherche de gloire lui vaut parfois un certain nombre d'inimitiés parmi ses pairs. Assez rapidement, en partie pour des questions financières — l'armée paie moins que le journalisme et il a besoin d'argent —, il sert en tant que correspondant de guerre, écrivant des livres sur les campagnes auxquelles il participe. Bien plus tard, il sert brièvement sur le front de l'Ouest pendant la Première Guerre mondiale, comme commandant du 6e bataillon des Royal Scots Fusiliers.
Sir Winston Churchill , né le 30 novembre 1874 à Woodstock et mort le 24 janvier 1965 à Londres, est un homme d'État britannique. Sa ténacité face au nazisme, son action décisive en tant que Premier ministre du Royaume-Uni durant la Seconde Guerre mondiale, joints à ses talents d'orateur et à ses bons mots, ont fait de lui un des hommes politiques les plus reconnus du XXe siècle. Ne disposant pas d'une fortune personnelle, il tire l'essentiel de ses revenus de sa plume. Ses dons d'écriture seront couronnés à la fin de sa vie par le prix Nobel de littérature. Il est également un peintre estimé.
Winston Churchill appartient à la famille aristocratique Spencer, dont il est la plus brillante figure depuis son ancêtre John Churchill, 1er duc de Marlborough (1650-1722), auquel il a consacré une biographie. Fils d'un homme politique conservateur atypique n'ayant pas connu le succès escompté et mort relativement jeune, il ambitionne très vite de réussir dans ce domaine. De fait, s'il débute dans la carrière militaire et combat en Inde, au Soudan et lors de la seconde guerre des Boers, il y cherche surtout l'occasion de briller et de se faire connaître. Cette recherche de gloire lui vaut parfois un certain nombre d'inimitiés parmi ses pairs. Assez rapidement, en partie pour des questions financières — l'armée paie moins que le journalisme et il a besoin d'argent —, il sert en tant que correspondant de guerre, écrivant des livres sur les campagnes auxquelles il participe. Bien plus tard, il sert brièvement sur le front de l'Ouest pendant la Première Guerre mondiale, comme commandant du 6e bataillon des Royal Scots Fusiliers.

 Neil Alden Armstrong, né le 5 août 1930 à Wapakoneta dans l'Ohio aux États-Unis et mort le 25 août 2012 à Cincinnati dans le même État, est un astronaute américain, pilote d'essai, aviateur de l'United States Navy et professeur. Il est le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune le 21 juillet 1969 UTC, durant la mission Apollo 11, prononçant alors une phrase restée célèbre : « That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind » (en français : « C'est un petit pas pour [un] homme, [mais] un bond de géant pour l'humanité »).
Neil Alden Armstrong, né le 5 août 1930 à Wapakoneta dans l'Ohio aux États-Unis et mort le 25 août 2012 à Cincinnati dans le même État, est un astronaute américain, pilote d'essai, aviateur de l'United States Navy et professeur. Il est le premier homme à avoir posé le pied sur la Lune le 21 juillet 1969 UTC, durant la mission Apollo 11, prononçant alors une phrase restée célèbre : « That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind » (en français : « C'est un petit pas pour [un] homme, [mais] un bond de géant pour l'humanité »). 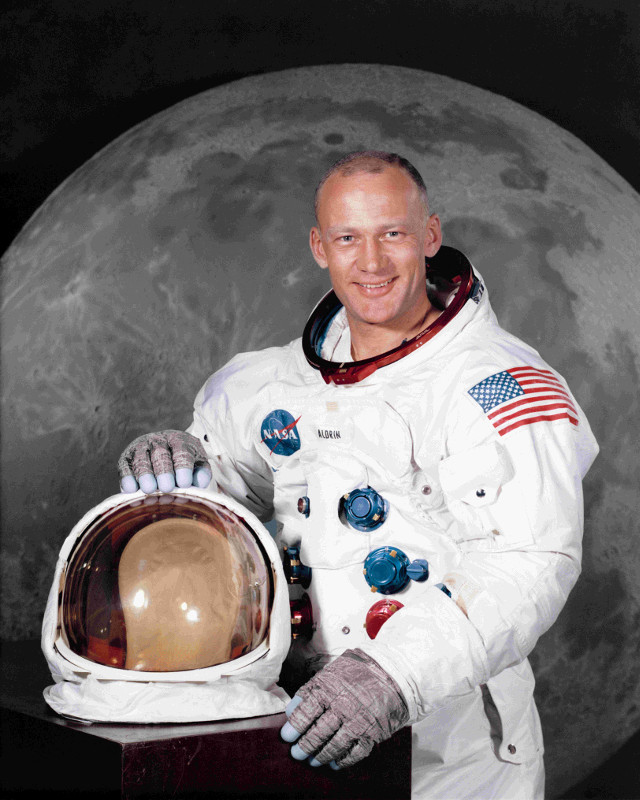 Buzz Aldrin, né Edwin Eugene Aldrin Jr., le 20 janvier 1930 à Glen Ridge dans le New Jersey aux États-Unis, est un militaire, pilote d'essai, astronaute et ingénieur américain. Il effectue trois sorties dans l'espace en tant que pilote de la mission Gemini 12 de 1966 et, en tant que pilote du module lunaire Apollo de la mission Apollo 11 de 1969, il est, avec le commandant de la mission Neil Armstrong, l'un des deux premiers humains à marcher sur la Lune.
Buzz Aldrin, né Edwin Eugene Aldrin Jr., le 20 janvier 1930 à Glen Ridge dans le New Jersey aux États-Unis, est un militaire, pilote d'essai, astronaute et ingénieur américain. Il effectue trois sorties dans l'espace en tant que pilote de la mission Gemini 12 de 1966 et, en tant que pilote du module lunaire Apollo de la mission Apollo 11 de 1969, il est, avec le commandant de la mission Neil Armstrong, l'un des deux premiers humains à marcher sur la Lune..jpg) Michael Collins, né le 31 octobre 1930 à Rome en Italie, est un militaire, pilote d'essai, astronaute, haut fonctionnaire, cadre et homme d'affaires américain.
Michael Collins, né le 31 octobre 1930 à Rome en Italie, est un militaire, pilote d'essai, astronaute, haut fonctionnaire, cadre et homme d'affaires américain. Chelsea Elizabeth Manning, née Bradley Edward Manning le 17 décembre 1987 à Crescent (Oklahoma), est une ancienne analyste militaire de l'Armée des États-Unis de nationalité américano-britannique qui a été condamnée et incarcérée pour trahison.
Chelsea Elizabeth Manning, née Bradley Edward Manning le 17 décembre 1987 à Crescent (Oklahoma), est une ancienne analyste militaire de l'Armée des États-Unis de nationalité américano-britannique qui a été condamnée et incarcérée pour trahison. .jpg) Solomon Northup, né en juillet 1808, à Minerva, comté d'Essex dans l'État de New York et mort à une date inconnue après 1857, est un Noir afro-américain, né libre, fils d'un esclave affranchi. Il était agriculteur et violoniste, et possédait une propriété à Hebron, dans l’État de New York.
Solomon Northup, né en juillet 1808, à Minerva, comté d'Essex dans l'État de New York et mort à une date inconnue après 1857, est un Noir afro-américain, né libre, fils d'un esclave affranchi. Il était agriculteur et violoniste, et possédait une propriété à Hebron, dans l’État de New York. James Arthur Lovell, Jr., dit « Jim » Lovell, né le 25 mars 1928 à Cleveland, Ohio, est un astronaute américain de la NASA, principalement connu pour avoir été le commandant de la mission Apollo 13.
James Arthur Lovell, Jr., dit « Jim » Lovell, né le 25 mars 1928 à Cleveland, Ohio, est un astronaute américain de la NASA, principalement connu pour avoir été le commandant de la mission Apollo 13.  Fred Wallace Haise Junior dit Fred Haise est un astronaute américain né le 14 novembre 1933 à Biloxi, Mississippi.
Fred Wallace Haise Junior dit Fred Haise est un astronaute américain né le 14 novembre 1933 à Biloxi, Mississippi.  John Leonard "Jack" Swigert, Jr., né le 30 août 1931 à Denver dans le Colorado et mort le 27 décembre 1982 à Washington, D.C., est un pilote d'essais et astronaute américain de la National Aeronautics and Space Administration (NASA).
John Leonard "Jack" Swigert, Jr., né le 30 août 1931 à Denver dans le Colorado et mort le 27 décembre 1982 à Washington, D.C., est un pilote d'essais et astronaute américain de la National Aeronautics and Space Administration (NASA). 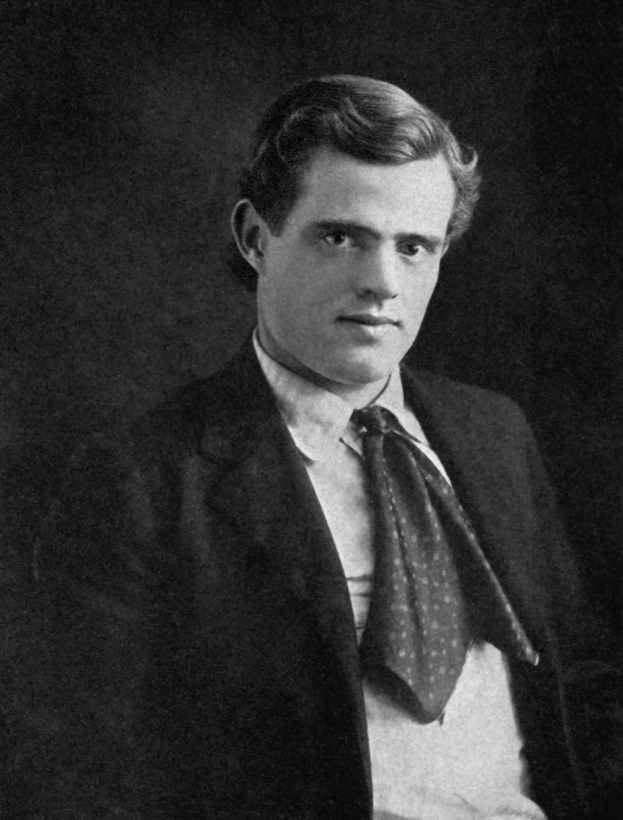 Jack London, né John Griffith Chaney le 12 janvier 1876 à San Francisco et mort le 22 novembre 1916 à Glen Ellen, Californie, est un écrivain américain dont les thèmes de prédilection sont l'aventure et la nature sauvage.
Jack London, né John Griffith Chaney le 12 janvier 1876 à San Francisco et mort le 22 novembre 1916 à Glen Ellen, Californie, est un écrivain américain dont les thèmes de prédilection sont l'aventure et la nature sauvage.  Laurence Kim Peek, né le 11 novembre 1951 à Salt Lake City et mort dans cette même ville le 19 décembre 2009, est un Américain atteint du syndrome du savant. Tout en étant doué d'une mémoire eidétique, il souffrait de difficultés dans la vie en société, possibles résultats d'anomalies congénitales du cerveau. Il a inspiré le personnage principal du film Rain Man.
Laurence Kim Peek, né le 11 novembre 1951 à Salt Lake City et mort dans cette même ville le 19 décembre 2009, est un Américain atteint du syndrome du savant. Tout en étant doué d'une mémoire eidétique, il souffrait de difficultés dans la vie en société, possibles résultats d'anomalies congénitales du cerveau. Il a inspiré le personnage principal du film Rain Man.  Alexeï Arkhipovitch Leonov (en russe : Алексе́й Архи́пович Лео́нов), né le 30 mai 1934 à Listvianka (oblast de Kemerovo) et mort le 11 octobre 2019 à Moscou, est un cosmonaute soviétique.
Pilote de chasse de formation, il est sélectionné en 1961, au tout début de l'ère spatiale, pour faire partie du premier groupe de cosmonautes. Il est le premier homme à avoir réalisé une sortie extravéhiculaire dans l'espace dans le cadre de la mission Voskhod 2, le 18 mars 1965. Leonov est un des cosmonautes entrainé pour participer aux premières missions vers la Lune mais le programme lunaire habité soviétique est arrêté en 1974 à la suite des échecs répétés du lanceur géant N1. Pour son deuxième séjour dans l'espace qui a lieu en 1975, il est commandant du Soyouz 19 et participe à la mission Apollo-Soyouz qui constitue le premier vol spatial conjoint entre les États-Unis et l'Union soviétique. Cet événement symbolique marque un réchauffement des relations entre les deux pays qui s'affrontaient jusque là durant la guerre froide. De 1976 jusqu'à sa retraite en 1991 il est responsable de l'entrainement des cosmonautes soviétiques.
Alexeï Leonov naît le 30 mai 1934 dans le village de Listvianka situé dans le district de Tisoulski (oblast de Kemerovo) en région économique de Sibérie occidentale. Il est un des neuf enfants survivants du mineur et électricien Arkhip et de sa femme Ievdokia. Avant même de savoir lire et écrire, il se prend de passion pour le dessin. En 1937, en pleine purges staliniennes, son père est emprisonné pour activités anticommunistes, de fausses accusations selon Alexeï. Sa famille doit quitter le village après avoir été dépouillé de tous ses biens par les autres villageois y compris les vêtements qu'ils portent. Les années de guerre sont comme dans toute l'Union soviétique marquées par les privations. C'est un enfant espiègle. Il continue de dessiner et ses œuvres sont considérées comme suffisamment bonnes pour décorer l’hôpital local. Les autorités soviétiques ayant décidé de repeupler de russes les anciens territoires allemands du bord de la mer Baltique qui ont été annexés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la famille de Leonov doit déménager à Kaliningrad en 1948. Leonov découvre la mer qui devient un des sujets favoris de ses peintures par la suite. La région, bien qu’abandonnée par ses anciens occupants allemands, est imprégnée de leur culture. Ce contexte jouera peut-être un rôle dans la formation de la personnalité de Leonov qui deviendra un des cosmonautes les plus diplomates capable de charmer aussi bien les dirigeants du monde capitaliste que les responsables soviétiques. Leonov, devenu adulte, envisage de suivre une carrière artistique. Mais son frère ayant choisi de devenir mécanicien sur avion, il décide de suivre une formation de pilote dans l'armée de l'air. Entre également en ligne de compte, le fait que, contrairement à l'école des Beaux Arts, l'école militaire lui fournit le logement. Il commence à suivre des cours théoriques de pilotage en juillet 1953, réalise son premier vol en janvier 1955 et effectue son premier vol en solo quatre mois plus tard. Il n'a pas renoncé à sa passion pour la peinture et suit en parallèle des cours de dessin le soir. Il rencontre à cette époque Svletana Pavlova, une future enseignante, avec laquelle il se mariera en 1959. Il décroche en 1957 un diplôme de pilote à l'académie militaire de Tchouhouïv (Ukraine).
Alexeï Arkhipovitch Leonov (en russe : Алексе́й Архи́пович Лео́нов), né le 30 mai 1934 à Listvianka (oblast de Kemerovo) et mort le 11 octobre 2019 à Moscou, est un cosmonaute soviétique.
Pilote de chasse de formation, il est sélectionné en 1961, au tout début de l'ère spatiale, pour faire partie du premier groupe de cosmonautes. Il est le premier homme à avoir réalisé une sortie extravéhiculaire dans l'espace dans le cadre de la mission Voskhod 2, le 18 mars 1965. Leonov est un des cosmonautes entrainé pour participer aux premières missions vers la Lune mais le programme lunaire habité soviétique est arrêté en 1974 à la suite des échecs répétés du lanceur géant N1. Pour son deuxième séjour dans l'espace qui a lieu en 1975, il est commandant du Soyouz 19 et participe à la mission Apollo-Soyouz qui constitue le premier vol spatial conjoint entre les États-Unis et l'Union soviétique. Cet événement symbolique marque un réchauffement des relations entre les deux pays qui s'affrontaient jusque là durant la guerre froide. De 1976 jusqu'à sa retraite en 1991 il est responsable de l'entrainement des cosmonautes soviétiques.
Alexeï Leonov naît le 30 mai 1934 dans le village de Listvianka situé dans le district de Tisoulski (oblast de Kemerovo) en région économique de Sibérie occidentale. Il est un des neuf enfants survivants du mineur et électricien Arkhip et de sa femme Ievdokia. Avant même de savoir lire et écrire, il se prend de passion pour le dessin. En 1937, en pleine purges staliniennes, son père est emprisonné pour activités anticommunistes, de fausses accusations selon Alexeï. Sa famille doit quitter le village après avoir été dépouillé de tous ses biens par les autres villageois y compris les vêtements qu'ils portent. Les années de guerre sont comme dans toute l'Union soviétique marquées par les privations. C'est un enfant espiègle. Il continue de dessiner et ses œuvres sont considérées comme suffisamment bonnes pour décorer l’hôpital local. Les autorités soviétiques ayant décidé de repeupler de russes les anciens territoires allemands du bord de la mer Baltique qui ont été annexés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la famille de Leonov doit déménager à Kaliningrad en 1948. Leonov découvre la mer qui devient un des sujets favoris de ses peintures par la suite. La région, bien qu’abandonnée par ses anciens occupants allemands, est imprégnée de leur culture. Ce contexte jouera peut-être un rôle dans la formation de la personnalité de Leonov qui deviendra un des cosmonautes les plus diplomates capable de charmer aussi bien les dirigeants du monde capitaliste que les responsables soviétiques. Leonov, devenu adulte, envisage de suivre une carrière artistique. Mais son frère ayant choisi de devenir mécanicien sur avion, il décide de suivre une formation de pilote dans l'armée de l'air. Entre également en ligne de compte, le fait que, contrairement à l'école des Beaux Arts, l'école militaire lui fournit le logement. Il commence à suivre des cours théoriques de pilotage en juillet 1953, réalise son premier vol en janvier 1955 et effectue son premier vol en solo quatre mois plus tard. Il n'a pas renoncé à sa passion pour la peinture et suit en parallèle des cours de dessin le soir. Il rencontre à cette époque Svletana Pavlova, une future enseignante, avec laquelle il se mariera en 1959. Il décroche en 1957 un diplôme de pilote à l'académie militaire de Tchouhouïv (Ukraine).
 Eugène Sänger (né le 22 septembre 1905 à Preßnitz en ex-Autriche-Hongrie et mort le 10 février 1964 à Berlin) était un ingénieur aéronautique autrichien et fut un des pionniers de l'astronautique, surtout connu pour ses recherches sur le corps portant et le statoréacteur.
Eugène Sänger (né le 22 septembre 1905 à Preßnitz en ex-Autriche-Hongrie et mort le 10 février 1964 à Berlin) était un ingénieur aéronautique autrichien et fut un des pionniers de l'astronautique, surtout connu pour ses recherches sur le corps portant et le statoréacteur.  Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski, est un écrivain russe, né à Moscou le 30 octobre 1821 (11 novembre 1821 dans le calendrier grégorien) et mort à Saint-Pétersbourg le 28 janvier 1881 (9 février 1881 dans le calendrier grégorien).
Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski, est un écrivain russe, né à Moscou le 30 octobre 1821 (11 novembre 1821 dans le calendrier grégorien) et mort à Saint-Pétersbourg le 28 janvier 1881 (9 février 1881 dans le calendrier grégorien). 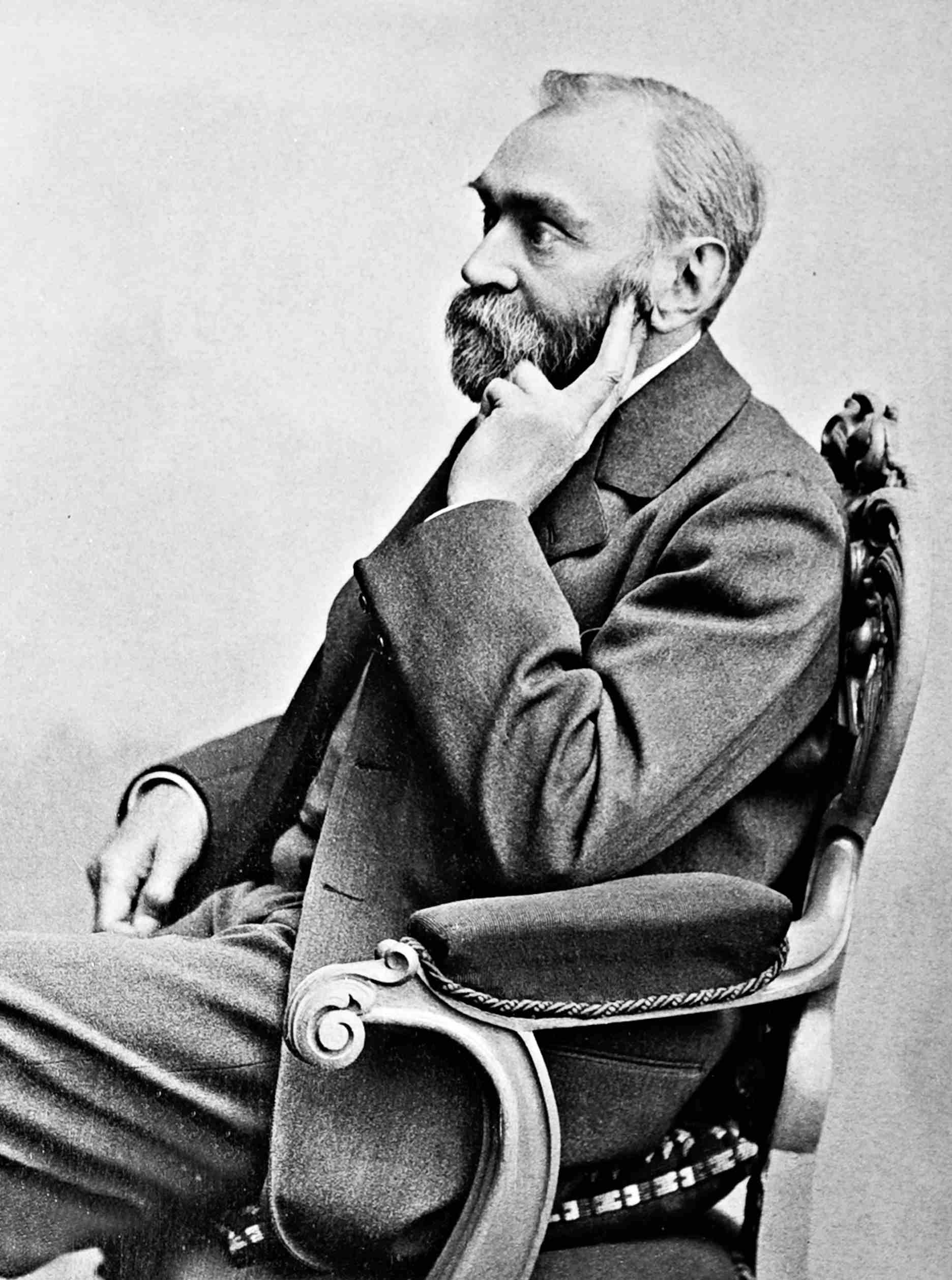 Alfred Bernhard Nobel , né le 21 octobre 1833 à Stockholm en Suède et mort le 10 décembre 1896 à Sanremo en Italie, est un chimiste, industriel et fabricant d'armes suédois. Dépositaire de plus de 350 brevets scientifiques de son vivant, dont celui de la dynamite, invention qui a fait sa renommée. Il fonde l'entreprise KemaNobel en 1871, et rachète l'entreprise d'armement Bofors en 1894.
Alfred Bernhard Nobel , né le 21 octobre 1833 à Stockholm en Suède et mort le 10 décembre 1896 à Sanremo en Italie, est un chimiste, industriel et fabricant d'armes suédois. Dépositaire de plus de 350 brevets scientifiques de son vivant, dont celui de la dynamite, invention qui a fait sa renommée. Il fonde l'entreprise KemaNobel en 1871, et rachète l'entreprise d'armement Bofors en 1894.  Enrico Fermi (29 septembre 1901 à Rome - 28 novembre 1954 à Chicago) est un physicien italien naturalisé américain. Ses recherches serviront de socle à l'exploitation de l'énergie nucléaire. Il a été excellent, ce qui est rare, à la fois en physique expérimentale et en physique théorique.
Enrico Fermi (29 septembre 1901 à Rome - 28 novembre 1954 à Chicago) est un physicien italien naturalisé américain. Ses recherches serviront de socle à l'exploitation de l'énergie nucléaire. Il a été excellent, ce qui est rare, à la fois en physique expérimentale et en physique théorique.  1642- 1727.jpg) Isaac Newton (25 décembre 1642 J – 20 mars 1727 J, ou 4 janvier 1643 G – 31 mars 1727 G) est un mathématicien, physicien, philosophe, alchimiste, astronome et théologien anglais, puis britannique. Figure emblématique des sciences, il est surtout reconnu pour avoir fondé la mécanique classique, pour sa théorie de la gravitation universelle et la création, en concurrence avec Gottfried Wilhelm Leibniz, du calcul infinitésimal. En optique, il a développé une théorie de la couleur basée sur l'observation selon laquelle un prisme décompose la lumière blanche en un spectre visible. Il a aussi inventé le télescope à réflexion composé d'un miroir primaire concave appelé télescope de Newton.
Isaac Newton (25 décembre 1642 J – 20 mars 1727 J, ou 4 janvier 1643 G – 31 mars 1727 G) est un mathématicien, physicien, philosophe, alchimiste, astronome et théologien anglais, puis britannique. Figure emblématique des sciences, il est surtout reconnu pour avoir fondé la mécanique classique, pour sa théorie de la gravitation universelle et la création, en concurrence avec Gottfried Wilhelm Leibniz, du calcul infinitésimal. En optique, il a développé une théorie de la couleur basée sur l'observation selon laquelle un prisme décompose la lumière blanche en un spectre visible. Il a aussi inventé le télescope à réflexion composé d'un miroir primaire concave appelé télescope de Newton.  Bertha Benz, née Ringer le 3 mai 1849 à Pforzheim et morte le 5 mai 1944 à Ladenburg, est une inventrice allemande, pionnière de l'automobile. Elle est la femme et l'associée de l'inventeur automobile Carl Benz. En 1888, elle devient la première en Allemagne à conduire une automobile sur une longue distance. Ce faisant, elle attire sur Benz Patent Motorwagen une attention considérable et amène à la société ses premières ventes. Elle est également l'inventrice des plaquettes de frein.
Bertha Benz, née Ringer le 3 mai 1849 à Pforzheim et morte le 5 mai 1944 à Ladenburg, est une inventrice allemande, pionnière de l'automobile. Elle est la femme et l'associée de l'inventeur automobile Carl Benz. En 1888, elle devient la première en Allemagne à conduire une automobile sur une longue distance. Ce faisant, elle attire sur Benz Patent Motorwagen une attention considérable et amène à la société ses premières ventes. Elle est également l'inventrice des plaquettes de frein. 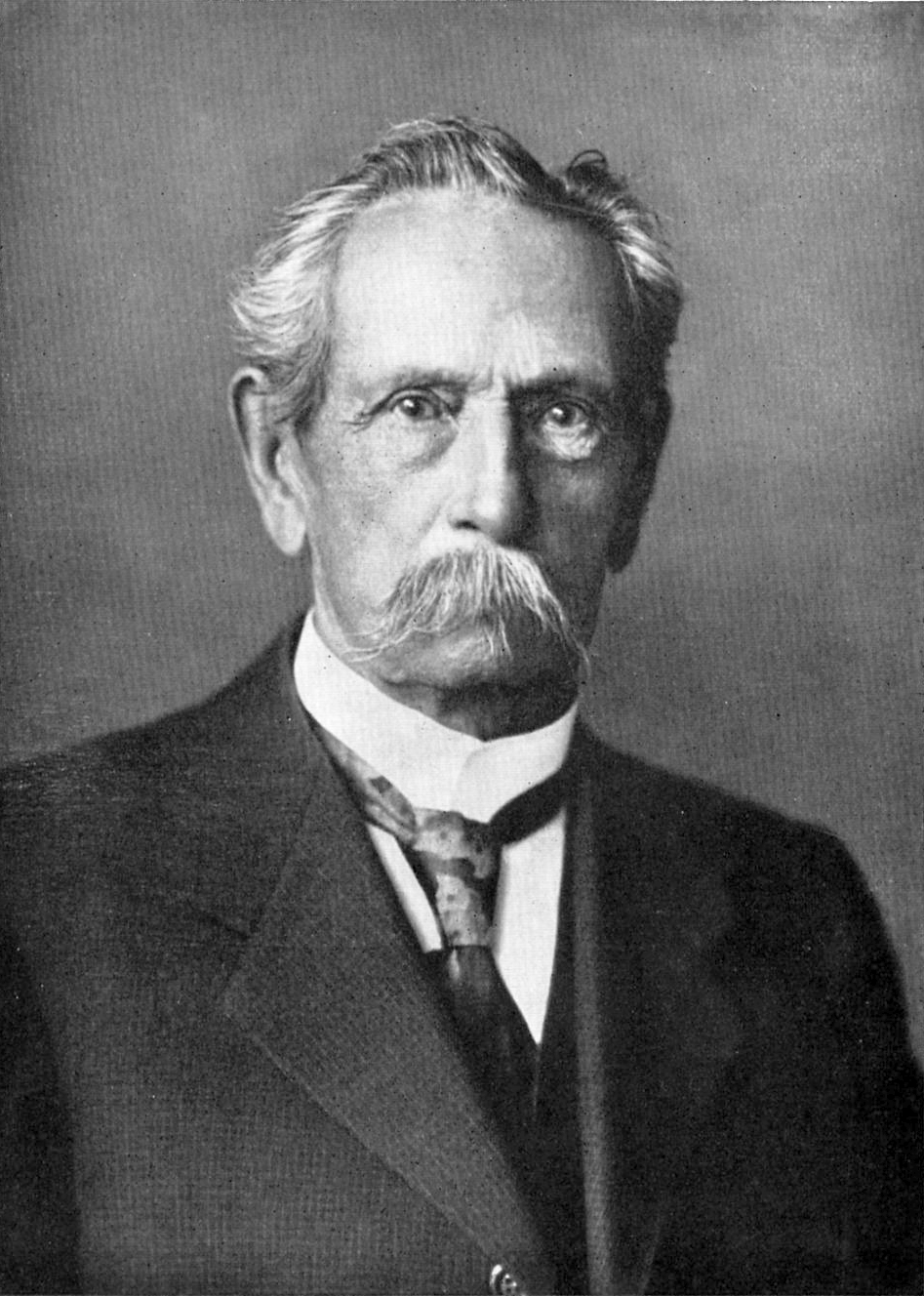 Carl Benz (Karl Friedrich Michael Benz), né le 25 novembre 1844 à Mühlburg, quartier de Karlsruhe et mort le 4 avril 1929 à Ladenburg, est un inventeur allemand, pionnier de l'automobile, et fondateur de Benz & Cie qui devint Mercedes-Benz en 1926, après la fusion avec Daimler-Motoren-Gesellschaft.
Carl Benz (Karl Friedrich Michael Benz), né le 25 novembre 1844 à Mühlburg, quartier de Karlsruhe et mort le 4 avril 1929 à Ladenburg, est un inventeur allemand, pionnier de l'automobile, et fondateur de Benz & Cie qui devint Mercedes-Benz en 1926, après la fusion avec Daimler-Motoren-Gesellschaft. 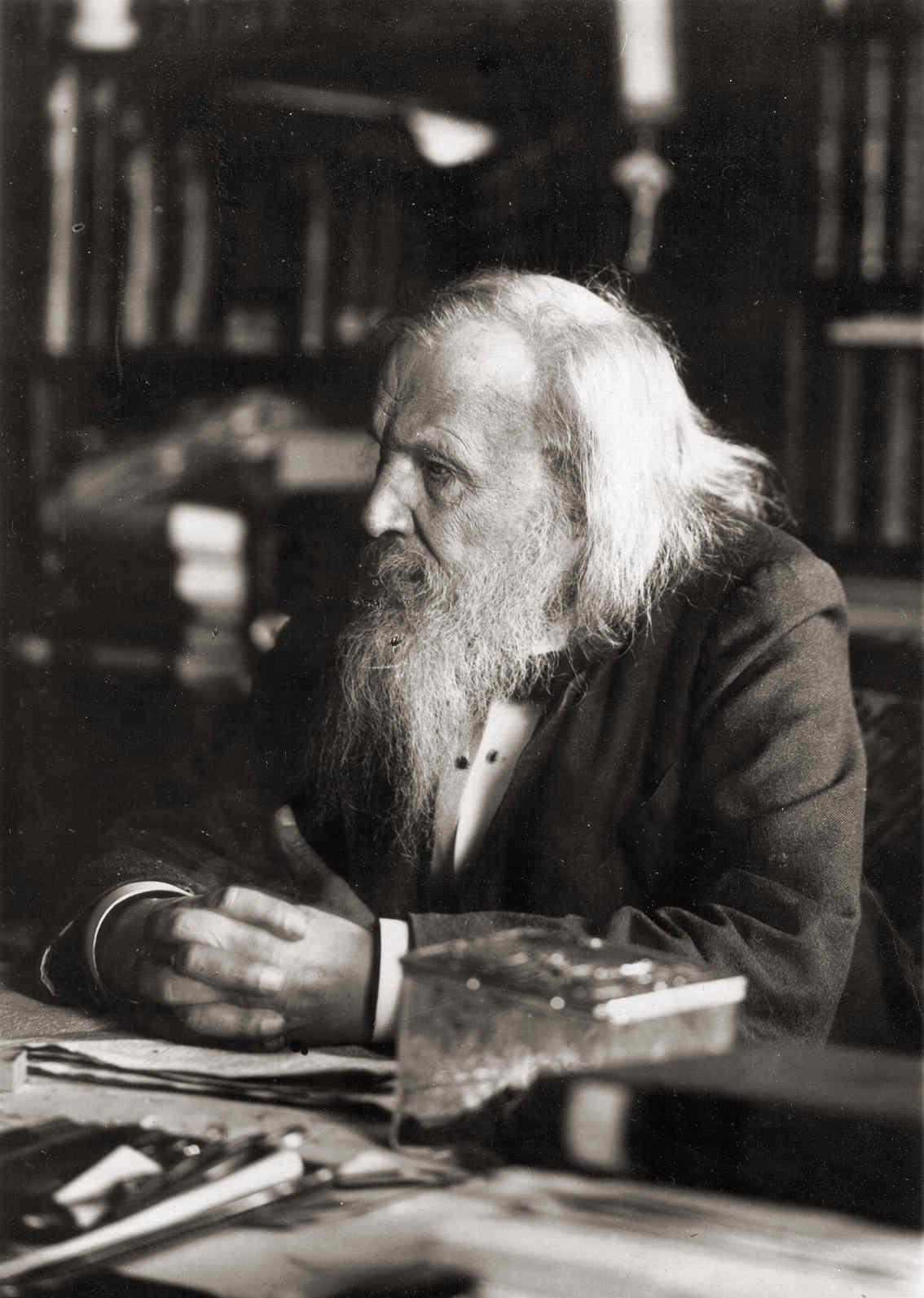 Dmitri Ivanovitch Mendeleïev (parfois écrit Dimitri, en russe d'époque Дмитрій Ивановичъ Менделѣевъ ; en russe moderne Дмитрий Иванович Менделеев, né le 27 janvier 1834 (8 février 1834 dans le calendrier grégorien) à Tobolsk et mort le 20 janvier 1907 (2 février 1907 dans le calendrier grégorien) à Saint-Pétersbourg, est un chimiste russe.
Dmitri Ivanovitch Mendeleïev (parfois écrit Dimitri, en russe d'époque Дмитрій Ивановичъ Менделѣевъ ; en russe moderne Дмитрий Иванович Менделеев, né le 27 janvier 1834 (8 février 1834 dans le calendrier grégorien) à Tobolsk et mort le 20 janvier 1907 (2 février 1907 dans le calendrier grégorien) à Saint-Pétersbourg, est un chimiste russe.  Max Planck, né Max Karl Ernst Ludwig Planck le 23 avril 1858 à Kiel, dans le duché de Schleswig et mort le 4 octobre 1947 à Göttingen, en Allemagne (pendant l'occupation alliée), est un physicien allemand.
Max Planck, né Max Karl Ernst Ludwig Planck le 23 avril 1858 à Kiel, dans le duché de Schleswig et mort le 4 octobre 1947 à Göttingen, en Allemagne (pendant l'occupation alliée), est un physicien allemand.  Ivan Petrovitch Pavlov (en russe : Иван Петрович Павлов), né le 14 septembre 1849 (26 septembre 1849 dans le calendrier grégorien) à Riazan, dans l'Empire russe, et mort le 27 février 1936 à Léningrad, en URSS, est un médecin et un physiologiste russe, lauréat du prix Nobel de physiologie ou médecine de 1904, et de la médaille Copley en 1915.
Ivan Petrovitch Pavlov (en russe : Иван Петрович Павлов), né le 14 septembre 1849 (26 septembre 1849 dans le calendrier grégorien) à Riazan, dans l'Empire russe, et mort le 27 février 1936 à Léningrad, en URSS, est un médecin et un physiologiste russe, lauréat du prix Nobel de physiologie ou médecine de 1904, et de la médaille Copley en 1915.  Stephen William Hawking), né le 8 janvier 1942 à Oxford et mort le 14 mars 2018 à Cambridge, est un physicien théoricien et cosmologiste britannique. Ses livres et ses apparitions publiques ont fait de ce théoricien de renommée mondiale une célébrité.
Stephen William Hawking), né le 8 janvier 1942 à Oxford et mort le 14 mars 2018 à Cambridge, est un physicien théoricien et cosmologiste britannique. Ses livres et ses apparitions publiques ont fait de ce théoricien de renommée mondiale une célébrité.  Antoni van Leeuwenhoek, né le 24 octobre 1632 à Delft et mort le 26 août 1723 dans la même ville, est un commerçant et savant néerlandais, connu pour ses améliorations du microscope et comme l'un des précurseurs de la biologie cellulaire et de la microbiologie.
Antoni van Leeuwenhoek, né le 24 octobre 1632 à Delft et mort le 26 août 1723 dans la même ville, est un commerçant et savant néerlandais, connu pour ses améliorations du microscope et comme l'un des précurseurs de la biologie cellulaire et de la microbiologie. Alexandre Stepanovitch Popov (en russe : Александр Степанович Попов ; 16 mars 1859 - 13 janvier 1906), est un physicien et ingénieur russe, précurseur de la radio.
Alexandre Stepanovitch Popov (en russe : Александр Степанович Попов ; 16 mars 1859 - 13 janvier 1906), est un physicien et ingénieur russe, précurseur de la radio. 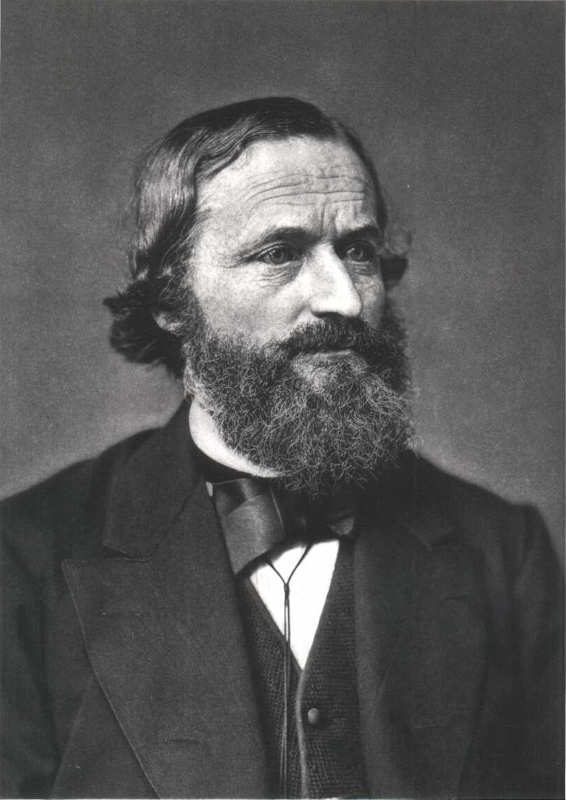 Gustav Robert Kirchhoff (né le 12 mars 1824 à Königsberg, en province de Prusse-Orientale et décédé à Berlin le 17 octobre 1887) est l’un des plus grands physiciens du XIXe siècle, avec des contributions essentielles à l’électrodynamique, la physique du rayonnement et la théorie mathématique de l'élasticité.
Gustav Robert Kirchhoff (né le 12 mars 1824 à Königsberg, en province de Prusse-Orientale et décédé à Berlin le 17 octobre 1887) est l’un des plus grands physiciens du XIXe siècle, avec des contributions essentielles à l’électrodynamique, la physique du rayonnement et la théorie mathématique de l'élasticité.  Leonid Andrussow (28 novembre 1896 à Riga dans le gouvernement de Livonie de l'Empire russe (actuelle Lettonie) - 15 décembre 1988 près de Paris) était un ingénieur chimiste allemand. Il a mis au point le procédé Andrussow qui permet de synthétiser l'acide cyanhydrique (HCN) à partir de méthane et d'ammoniaque.
Leonid Andrussow (28 novembre 1896 à Riga dans le gouvernement de Livonie de l'Empire russe (actuelle Lettonie) - 15 décembre 1988 près de Paris) était un ingénieur chimiste allemand. Il a mis au point le procédé Andrussow qui permet de synthétiser l'acide cyanhydrique (HCN) à partir de méthane et d'ammoniaque.  Carl Bosch, né le 27 août 1874 à Cologne, Empire allemand et mort le 26 avril 1940 à Heidelberg, Allemagne, est un ingénieur et chimiste allemand. Il est surtout connu pour avoir supervisé la première industrialisation du procédé Haber et dirigé IG Farben.
Carl Bosch, né le 27 août 1874 à Cologne, Empire allemand et mort le 26 avril 1940 à Heidelberg, Allemagne, est un ingénieur et chimiste allemand. Il est surtout connu pour avoir supervisé la première industrialisation du procédé Haber et dirigé IG Farben.  Johann Carl Friedrich Gauß , traditionnellement transcrit Gauss en français ; Carolus Fridericus Gauss en latin), né le 30 avril 1777 à Brunswick et mort le 23 février 1855 à Göttingen, est un mathématicien, astronome et physicien allemand. Il a apporté de très importantes contributions à ces trois domaines. Surnommé « le prince des mathématiciens », il est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps.
Johann Carl Friedrich Gauß , traditionnellement transcrit Gauss en français ; Carolus Fridericus Gauss en latin), né le 30 avril 1777 à Brunswick et mort le 23 février 1855 à Göttingen, est un mathématicien, astronome et physicien allemand. Il a apporté de très importantes contributions à ces trois domaines. Surnommé « le prince des mathématiciens », il est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps.  Djalāl ad-Dīn Muḥammad Balkhi (persan : جلالالدین محمد بلخی) ou Rûmî, né à Balkh (actuel Afghanistan) dans le Khorasan (grande région de culture perse), le 30 septembre 1207 et mort à Konya (dans l'actuelle Turquie) le 17 décembre 1273, est un poète mystique persan qui a profondément influencé le soufisme.
Djalāl ad-Dīn Muḥammad Balkhi (persan : جلالالدین محمد بلخی) ou Rûmî, né à Balkh (actuel Afghanistan) dans le Khorasan (grande région de culture perse), le 30 septembre 1207 et mort à Konya (dans l'actuelle Turquie) le 17 décembre 1273, est un poète mystique persan qui a profondément influencé le soufisme.  Nicolas de Myre ou Nicolas de Bari, communément connu sous le nom de « saint Nicolas », est né à Patare, en Lycie (actuelle Turquie), vers 270 et mort à Myre en 345. Évêque de Myre en Lycie, il a probablement participé au premier Concile de Nicée au cours duquel il a probablement combattu l'arianisme.
Son culte est attesté depuis le VIe siècle en Orient et s'est répandu en Occident depuis l'Italie à partir du XIe siècle. Canonisé, il a été proclamé protecteur de nombreuses nations et de nombreux corps de métiers ; il est un personnage populaire de l'hagiographie chrétienne et il est l'un des saints les plus vénérés de l'église orthodoxe.
Le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas, est fêté traditionnellement dans plusieurs pays européens du Nord et de l'Est de l'Europe (notamment la Belgique, le Luxembourg, le Nord-Est de la France (surtout en Lorraine et en Alsace), les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse) « où il distribue des cadeaux à tous les enfants sages ». Il est également fêté en Aquitaine, en Espagne et en Italie.
Nicolas de Myre ou Nicolas de Bari, communément connu sous le nom de « saint Nicolas », est né à Patare, en Lycie (actuelle Turquie), vers 270 et mort à Myre en 345. Évêque de Myre en Lycie, il a probablement participé au premier Concile de Nicée au cours duquel il a probablement combattu l'arianisme.
Son culte est attesté depuis le VIe siècle en Orient et s'est répandu en Occident depuis l'Italie à partir du XIe siècle. Canonisé, il a été proclamé protecteur de nombreuses nations et de nombreux corps de métiers ; il est un personnage populaire de l'hagiographie chrétienne et il est l'un des saints les plus vénérés de l'église orthodoxe.
Le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas, est fêté traditionnellement dans plusieurs pays européens du Nord et de l'Est de l'Europe (notamment la Belgique, le Luxembourg, le Nord-Est de la France (surtout en Lorraine et en Alsace), les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse) « où il distribue des cadeaux à tous les enfants sages ». Il est également fêté en Aquitaine, en Espagne et en Italie.
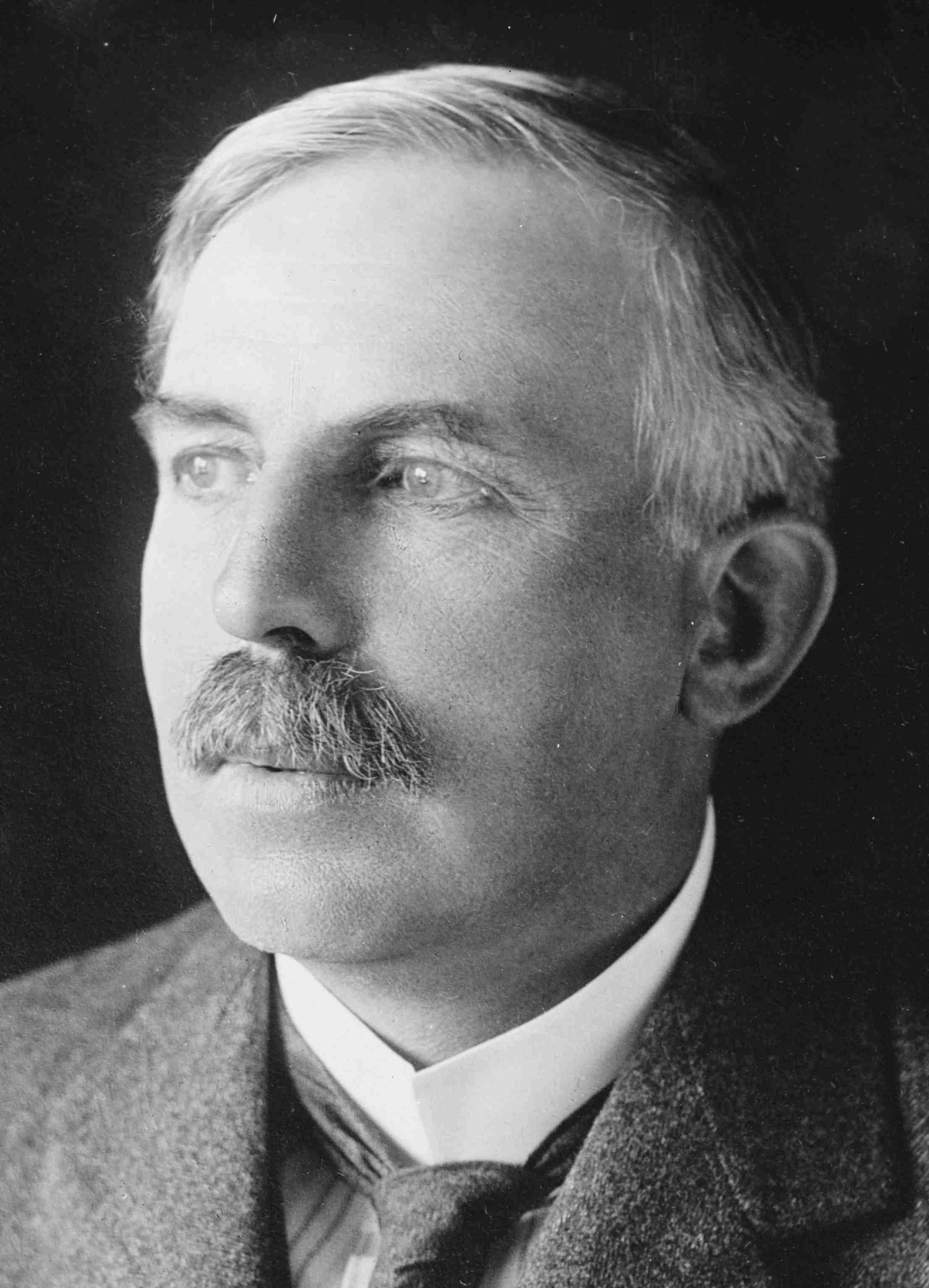 Ernest Rutherford (30 août 1871 à Brightwater, Nouvelle-Zélande - 19 octobre 1937 à Cambridge, Angleterre) est un physicien et chimiste néo-zélando-britannique, considéré comme le père de la physique nucléaire. Il découvrit les rayonnements alpha, les rayonnements bêta ; il découvrit aussi que la radioactivité s'accompagnait d'une désintégration des éléments chimiques, ce qui lui valut le prix Nobel de chimie en 19082. C'est encore lui qui mit en évidence l'existence d'un noyau atomique dans lequel étaient réunies toute la charge positive et presque toute la masse de l'atome.
Si, pendant la première partie de sa vie, il se consacra exclusivement à sa recherche, il passa la deuxième moitié de sa vie à enseigner et à diriger le laboratoire Cavendish à Cambridge, où fut découvert le neutron et où vinrent se former les physiciens Niels Bohr et Robert Oppenheimer. Son influence dans ce domaine de la physique qu'il a découvert fut donc particulièrement importante.
Il interpréta en 1911 la vision du modèle de Thomson ainsi que son expérience de la feuille d'or ce qui le conduisit à proposer son propre modèle.
Ernest Rutherford (30 août 1871 à Brightwater, Nouvelle-Zélande - 19 octobre 1937 à Cambridge, Angleterre) est un physicien et chimiste néo-zélando-britannique, considéré comme le père de la physique nucléaire. Il découvrit les rayonnements alpha, les rayonnements bêta ; il découvrit aussi que la radioactivité s'accompagnait d'une désintégration des éléments chimiques, ce qui lui valut le prix Nobel de chimie en 19082. C'est encore lui qui mit en évidence l'existence d'un noyau atomique dans lequel étaient réunies toute la charge positive et presque toute la masse de l'atome.
Si, pendant la première partie de sa vie, il se consacra exclusivement à sa recherche, il passa la deuxième moitié de sa vie à enseigner et à diriger le laboratoire Cavendish à Cambridge, où fut découvert le neutron et où vinrent se former les physiciens Niels Bohr et Robert Oppenheimer. Son influence dans ce domaine de la physique qu'il a découvert fut donc particulièrement importante.
Il interpréta en 1911 la vision du modèle de Thomson ainsi que son expérience de la feuille d'or ce qui le conduisit à proposer son propre modèle.  Felix Bloch (23 octobre 1905 – 10 septembre 1983) est un physicien suisse qui a surtout travaillé aux États-Unis. Edward Mills Purcell et lui sont colauréats du prix Nobel de physique de 1952 « pour leur développement de nouvelles méthodes de mesures magnétiques nucléaires fines et les découvertes qui en ont découlé », notamment la résonance magnétique nucléaire (RMN).
Felix Bloch (23 octobre 1905 – 10 septembre 1983) est un physicien suisse qui a surtout travaillé aux États-Unis. Edward Mills Purcell et lui sont colauréats du prix Nobel de physique de 1952 « pour leur développement de nouvelles méthodes de mesures magnétiques nucléaires fines et les découvertes qui en ont découlé », notamment la résonance magnétique nucléaire (RMN).  Karl Ferdinand Braun (né le 6 juin 1850 à Fulda, Allemagne et mort le 20 avril 1918 à New York) est un physicien allemand. Il fut, avec Guglielmo Marconi, colauréat du prix Nobel de physique de 1909 « en reconnaissance de leurs contributions au développement de la télégraphie sans fil ». Il soutient une thèse sous la direction de Hermann Ludwig von Helmholtz en 1872 à Berlin. Il vient une première fois à l'université de Strasbourg, pour deux ans en 1880 comme professeur invité (extraordinarius) ; il revient définitivement, en 1895, comme professeur (ordinarius) directeur de l'Institut de physique. Il se rend à New York en 1915 pour témoigner dans un procès en reconnaissance de brevet en radio-électricité. Il est arrêté et retenu pour sa nationalité allemande par les autorités américaines et meurt avant la fin de la guerre, en 1918.
Physicien intéressé surtout par la physique fondamentale, plusieurs de ses travaux furent à l'origine d'applications intéressantes.
Dès l'âge de 25 ans, en 1874, il établit que la galène (sulfure de plomb) ne respecte pas la loi d'Ohm : dans certaines conditions elle ne conduit pas l'électricité de la même manière suivant qu'on applique une tension dans un sens ou dans un autre.
Professeur à l'université de Strasbourg (il eut Jonathan Zenneck comme élève), il s'intéressa aux phénomènes électriques rapides et pour pouvoir les étudier, il développa en 1897 un tube cathodique particulier, dit « tube de Braun ». Son invention mena rapidement au développement de l'oscilloscope, qui plus tard allait permettre de réaliser les tubes cathodiques des téléviseurs, puis des premiers écrans d'ordinateurs. Braun exploita son invention dans la société « Professor Braun Telegrafen GmbH » qui deviendra plus tard « Telefunken AG ».
Il se lance en 1898 dans la transmission sans fil (TSF). À cette époque, les dispositifs radio de Guglielmo Marconi ont une portée limitée à 15 km, insuffisante pour des applications pratiques. Dans ces radios, sans amplificateur, l'antenne est une partie intégrante du circuit d'accord. Utilisant ses connaissances en physique, Braun sépare l'antenne du circuit d'accord en utilisant entre eux un couplage inductif. Il supprime ainsi l'étincelle des circuits limitant les pertes d'énergie et augmentant la sensibilité. Il brevette, en 1899, son système qui permet de couvrir à Cuxhaven une distance de 62 km.
En 1906, il utilisa sa connaissance des propriétés de conduction de la galène pour imaginer un redresseur, que l'on peut considérer comme l'ancêtre de la diode moderne, qui permit l'essor du poste à galène.
Le prix Nobel de physique de 1909 lui a été attribué, avec Guglielmo Marconi, pour ses travaux sur la télégraphie sans fil.
Karl Ferdinand Braun (né le 6 juin 1850 à Fulda, Allemagne et mort le 20 avril 1918 à New York) est un physicien allemand. Il fut, avec Guglielmo Marconi, colauréat du prix Nobel de physique de 1909 « en reconnaissance de leurs contributions au développement de la télégraphie sans fil ». Il soutient une thèse sous la direction de Hermann Ludwig von Helmholtz en 1872 à Berlin. Il vient une première fois à l'université de Strasbourg, pour deux ans en 1880 comme professeur invité (extraordinarius) ; il revient définitivement, en 1895, comme professeur (ordinarius) directeur de l'Institut de physique. Il se rend à New York en 1915 pour témoigner dans un procès en reconnaissance de brevet en radio-électricité. Il est arrêté et retenu pour sa nationalité allemande par les autorités américaines et meurt avant la fin de la guerre, en 1918.
Physicien intéressé surtout par la physique fondamentale, plusieurs de ses travaux furent à l'origine d'applications intéressantes.
Dès l'âge de 25 ans, en 1874, il établit que la galène (sulfure de plomb) ne respecte pas la loi d'Ohm : dans certaines conditions elle ne conduit pas l'électricité de la même manière suivant qu'on applique une tension dans un sens ou dans un autre.
Professeur à l'université de Strasbourg (il eut Jonathan Zenneck comme élève), il s'intéressa aux phénomènes électriques rapides et pour pouvoir les étudier, il développa en 1897 un tube cathodique particulier, dit « tube de Braun ». Son invention mena rapidement au développement de l'oscilloscope, qui plus tard allait permettre de réaliser les tubes cathodiques des téléviseurs, puis des premiers écrans d'ordinateurs. Braun exploita son invention dans la société « Professor Braun Telegrafen GmbH » qui deviendra plus tard « Telefunken AG ».
Il se lance en 1898 dans la transmission sans fil (TSF). À cette époque, les dispositifs radio de Guglielmo Marconi ont une portée limitée à 15 km, insuffisante pour des applications pratiques. Dans ces radios, sans amplificateur, l'antenne est une partie intégrante du circuit d'accord. Utilisant ses connaissances en physique, Braun sépare l'antenne du circuit d'accord en utilisant entre eux un couplage inductif. Il supprime ainsi l'étincelle des circuits limitant les pertes d'énergie et augmentant la sensibilité. Il brevette, en 1899, son système qui permet de couvrir à Cuxhaven une distance de 62 km.
En 1906, il utilisa sa connaissance des propriétés de conduction de la galène pour imaginer un redresseur, que l'on peut considérer comme l'ancêtre de la diode moderne, qui permit l'essor du poste à galène.
Le prix Nobel de physique de 1909 lui a été attribué, avec Guglielmo Marconi, pour ses travaux sur la télégraphie sans fil.
 Frederik « Frits » Zernike (16 juillet 1888 à Amsterdam – 10 mars 1966) était un physicien néerlandais. Il est lauréat du prix Nobel de physique de 1953 « pour la démonstration de la méthode de contraste de phase, particulièrement pour son invention du microscope à contraste de phase », un instrument qui permet d'étudier la structure interne des cellules sans coloration, pratique qui tue les cellules.
Frederik « Frits » Zernike (16 juillet 1888 à Amsterdam – 10 mars 1966) était un physicien néerlandais. Il est lauréat du prix Nobel de physique de 1953 « pour la démonstration de la méthode de contraste de phase, particulièrement pour son invention du microscope à contraste de phase », un instrument qui permet d'étudier la structure interne des cellules sans coloration, pratique qui tue les cellules. 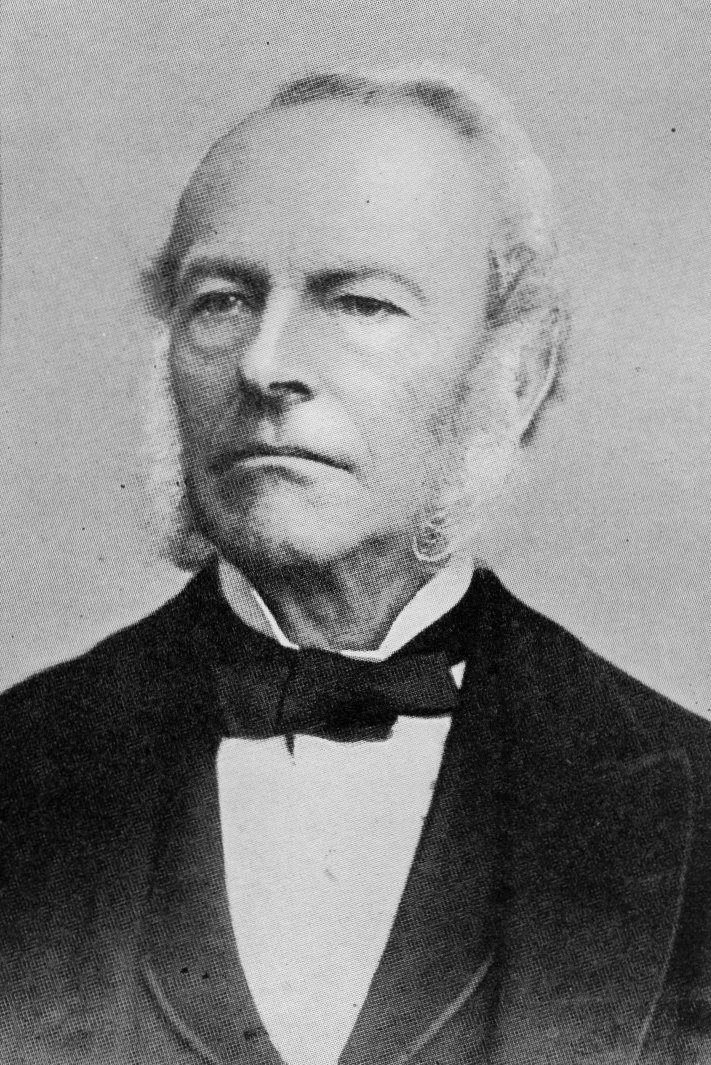 George Gabriel Stokes (13 août 1819 – 1er février 1903), 1er baronnet, est un mathématicien et physicien britannique né en Irlande.
George Gabriel Stokes (13 août 1819 – 1er février 1903), 1er baronnet, est un mathématicien et physicien britannique né en Irlande.  Guglielmo Marconi, né le 25 avril 1874 à Bologne et mort le 20 juillet 1937 à Rome, est un physicien, inventeur et homme d'affaires italien. Il est considéré comme l’un des inventeurs de la radio et de la télégraphie sans fil.
Guglielmo Marconi, né le 25 avril 1874 à Bologne et mort le 20 juillet 1937 à Rome, est un physicien, inventeur et homme d'affaires italien. Il est considéré comme l’un des inventeurs de la radio et de la télégraphie sans fil.  John William Strutt, troisième baron Rayleigh, plus connu sous son titre lord Rayleigh (12 novembre 1842 à Landford Grove, Essex, Angleterre - 30 juin 1919 à Witham, Essex, Angleterre) était un physicien anglais.
John William Strutt, troisième baron Rayleigh, plus connu sous son titre lord Rayleigh (12 novembre 1842 à Landford Grove, Essex, Angleterre - 30 juin 1919 à Witham, Essex, Angleterre) était un physicien anglais. Joseph John Thomson, né le 18 décembre 1856 et mort le 30 août 1940, est un physicien britannique.
Joseph John Thomson, né le 18 décembre 1856 et mort le 30 août 1940, est un physicien britannique.  Konrad Zuse (22 juin 1910 – 18 décembre 1995) est un ingénieur allemand qui fut l'un des pionniers du calcul programmable qui préfigure l'informatique. Considéré comme le créateur du premier ordinateur programmable en calcul binaire et à virgule flottante qui a vraiment fonctionné : le Z3 en 1941.
Konrad Zuse (22 juin 1910 – 18 décembre 1995) est un ingénieur allemand qui fut l'un des pionniers du calcul programmable qui préfigure l'informatique. Considéré comme le créateur du premier ordinateur programmable en calcul binaire et à virgule flottante qui a vraiment fonctionné : le Z3 en 1941.  Nelson Rolihlahla Mandela, dont le nom du clan tribal est « Madiba », né le 18 juillet 1918 à Mvezo (province du Cap) et mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg (Gauteng), est un homme d'État sud-africain ; il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale (apartheid) avant de devenir président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des premières élections nationales non ségrégationnistes de l'histoire du pays.
Nelson Rolihlahla Mandela, dont le nom du clan tribal est « Madiba », né le 18 juillet 1918 à Mvezo (province du Cap) et mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg (Gauteng), est un homme d'État sud-africain ; il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale (apartheid) avant de devenir président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des premières élections nationales non ségrégationnistes de l'histoire du pays. 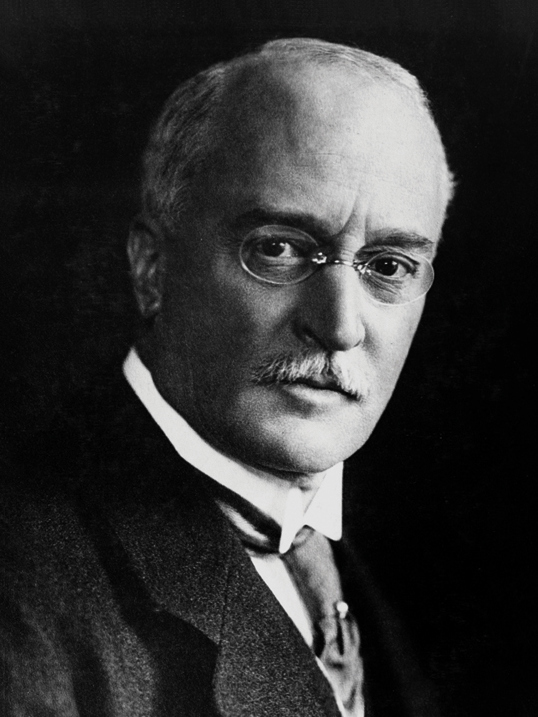 Rudolf Diesel (de son vrai nom Rodolphe Chrétien Charles Diesel, est un ingénieur allemand, né le 18 mars 1858 à Paris et disparu dans la nuit du 29 au 30 septembre 1913 lors d'une traversée de la mer du Nord.
Rudolf Diesel (de son vrai nom Rodolphe Chrétien Charles Diesel, est un ingénieur allemand, né le 18 mars 1858 à Paris et disparu dans la nuit du 29 au 30 septembre 1913 lors d'une traversée de la mer du Nord.  Victor Schœlcher est un journaliste et homme politique français, né à Paris le 22 juillet 1804 et mort à Houilles le 25 décembre 1893. Il est connu pour avoir agi en faveur de l'abolition définitive de l'esclavage en France, via le décret d'abolition, signé par le gouvernement provisoire de la deuxième République le 27 avril 1848. Il est également député de la Martinique puis de la Guadeloupe.
Victor Schœlcher est un journaliste et homme politique français, né à Paris le 22 juillet 1804 et mort à Houilles le 25 décembre 1893. Il est connu pour avoir agi en faveur de l'abolition définitive de l'esclavage en France, via le décret d'abolition, signé par le gouvernement provisoire de la deuxième République le 27 avril 1848. Il est également député de la Martinique puis de la Guadeloupe.  William Brouncker, né à Castle Lyons (Irlande) en 1620 et décédé à Westminster en 1684, était un linguiste et mathématicien anglais.
William Brouncker, né à Castle Lyons (Irlande) en 1620 et décédé à Westminster en 1684, était un linguiste et mathématicien anglais.  1824 - 1907.jpg) William Thomson, mieux connu sous le nom de Lord Kelvin (Belfast, 26 juin 1824 - Largs, 17 décembre 1907), 1er baron Kelvin, est un physicien britannique d'origine irlandaise reconnu pour ses travaux en thermodynamique.
William Thomson, mieux connu sous le nom de Lord Kelvin (Belfast, 26 juin 1824 - Largs, 17 décembre 1907), 1er baron Kelvin, est un physicien britannique d'origine irlandaise reconnu pour ses travaux en thermodynamique.  Jonas Ferdinand Gabriel Lippmann, né le 16 août 1845 à Bonnevoie (Luxembourg) et mort le 12 juillet 1921 à bord du paquebot France, est un physicien franco-luxembourgeois. Il est lauréat du prix Nobel de physique de 1908 « pour sa méthode de reproduction des couleurs en photographie, basée sur le phénomène d'interférence ».
Jonas Ferdinand Gabriel Lippmann, né le 16 août 1845 à Bonnevoie (Luxembourg) et mort le 12 juillet 1921 à bord du paquebot France, est un physicien franco-luxembourgeois. Il est lauréat du prix Nobel de physique de 1908 « pour sa méthode de reproduction des couleurs en photographie, basée sur le phénomène d'interférence ».  George Paget Thomson (3 mai 1892 – 10 septembre 1975), est un physicien britannique.
George Paget Thomson (3 mai 1892 – 10 septembre 1975), est un physicien britannique. 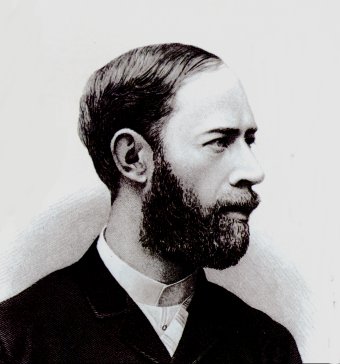 Heinrich Hertz, né le 22 février 1857 à Hambourg et mort le 1er janvier 1894 à Bonn, est un ingénieur et physicien allemand renommé pour avoir découvert les ondes hertziennes auxquelles il a donné son nom.
Heinrich Hertz, né le 22 février 1857 à Hambourg et mort le 1er janvier 1894 à Bonn, est un ingénieur et physicien allemand renommé pour avoir découvert les ondes hertziennes auxquelles il a donné son nom.  Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz est un scientifique (physiologiste et physicien) prussien, né le 31 août 1821 à Potsdam et mort à Berlin-Charlottenburg en 1894. Il a notamment apporté d'importantes contributions à l'étude de la perception des sons et des couleurs ainsi qu'à la thermodynamique.
Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz est un scientifique (physiologiste et physicien) prussien, né le 31 août 1821 à Potsdam et mort à Berlin-Charlottenburg en 1894. Il a notamment apporté d'importantes contributions à l'étude de la perception des sons et des couleurs ainsi qu'à la thermodynamique. 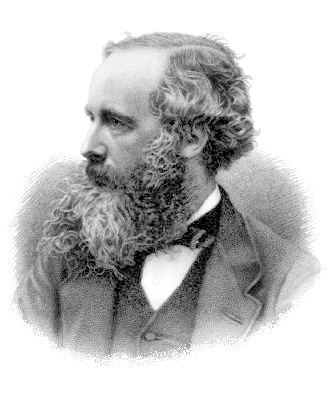 James Clerk Maxwell (13 juin 1831 à Édimbourg en Écosse - 5 novembre 1879 à Cambridge en Angleterre) est un physicien et mathématicien écossais.
James Clerk Maxwell (13 juin 1831 à Édimbourg en Écosse - 5 novembre 1879 à Cambridge en Angleterre) est un physicien et mathématicien écossais.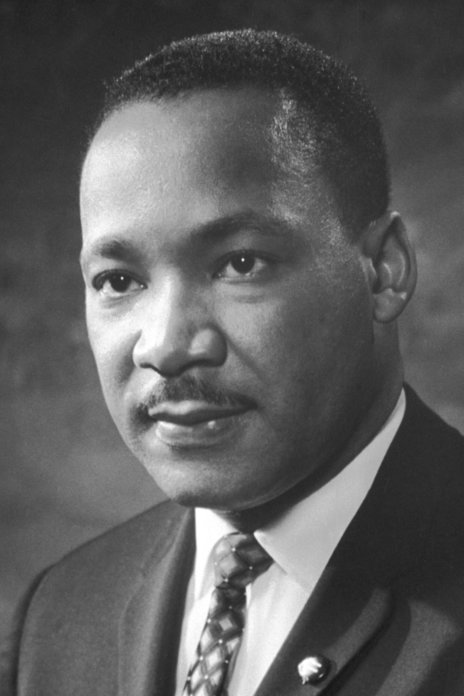 Martin Luther King Jr., plus couramment appelé Martin Luther King, né à Atlanta, en Géorgie, le 15 janvier 1929, et mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, dans le Tennessee, est un pasteur, baptiste et militant non-violent afro-américain pour le mouvement des droits civiques des noirs américains aux États-Unis, fervent militant pour la paix et contre la pauvreté.
Martin Luther King Jr., plus couramment appelé Martin Luther King, né à Atlanta, en Géorgie, le 15 janvier 1929, et mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, dans le Tennessee, est un pasteur, baptiste et militant non-violent afro-américain pour le mouvement des droits civiques des noirs américains aux États-Unis, fervent militant pour la paix et contre la pauvreté.  Max Born (11 décembre 1882 à Breslau, Empire allemand - 5 janvier 1970 à Göttingen, Allemagne de l'Ouest) est un physicien allemand.
Max Born (11 décembre 1882 à Breslau, Empire allemand - 5 janvier 1970 à Göttingen, Allemagne de l'Ouest) est un physicien allemand.  Philipp Eduard Anton von Lenard (7 juin 1862 à Presbourg - 20 mai 1947 à Messelhausen, Allemagne) est un physicien allemand d'origine austro-hongroise. Il a obtenu le prix Nobel de physique de 1905. Il a aussi été un des promoteurs de la Deutsche Physik (en) pendant le régime nazi, idéologie à laquelle il avait adhéré.
Philipp Eduard Anton von Lenard (7 juin 1862 à Presbourg - 20 mai 1947 à Messelhausen, Allemagne) est un physicien allemand d'origine austro-hongroise. Il a obtenu le prix Nobel de physique de 1905. Il a aussi été un des promoteurs de la Deutsche Physik (en) pendant le régime nazi, idéologie à laquelle il avait adhéré.  Polykarp Kusch (26 janvier 1911 - 20 mars 1993) est un physicien germano-américain.
Polykarp Kusch (26 janvier 1911 - 20 mars 1993) est un physicien germano-américain.  Pythagore est un réformateur religieux et philosophe présocratique qui serait né aux environs de 580 av. J.-C. à Samos, une île de la mer Égée au sud-est de la ville d'Athènes ; on établit sa mort vers 495 av. J.-C., à l'âge de 85 ans. Il aurait été également mathématicien et scientifique selon une tradition tardive.
Pythagore est un réformateur religieux et philosophe présocratique qui serait né aux environs de 580 av. J.-C. à Samos, une île de la mer Égée au sud-est de la ville d'Athènes ; on établit sa mort vers 495 av. J.-C., à l'âge de 85 ans. Il aurait été également mathématicien et scientifique selon une tradition tardive.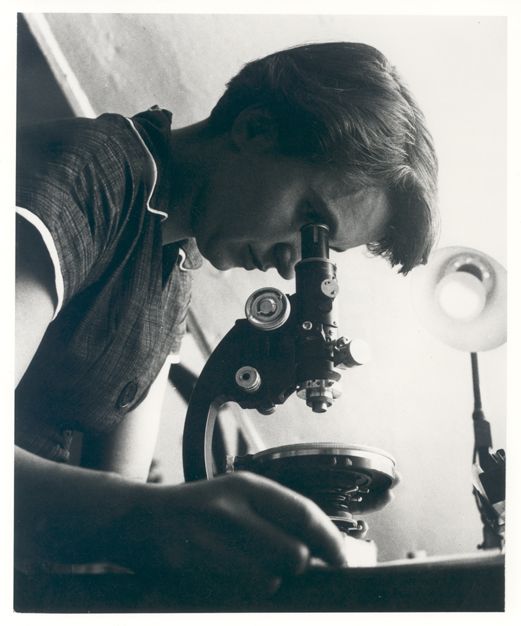 Rosalind Franklin est une physico-chimiste britannique, née le 25 juillet 1920 à Notting Hill et morte le 16 avril 1958 à Chelsea. Pionnière de la biologie moléculaire, elle formule la première dans un rapport non publié la structure hélicoïdale de l'acide désoxyribonucléique (ADN), découverte spoliée par Watson et Crick qui accèdent à son travail. Elle a également joué un rôle majeur dans la découverte du virus de la mosaïque du tabac.
Rosalind Franklin est une physico-chimiste britannique, née le 25 juillet 1920 à Notting Hill et morte le 16 avril 1958 à Chelsea. Pionnière de la biologie moléculaire, elle formule la première dans un rapport non publié la structure hélicoïdale de l'acide désoxyribonucléique (ADN), découverte spoliée par Watson et Crick qui accèdent à son travail. Elle a également joué un rôle majeur dans la découverte du virus de la mosaïque du tabac.  Sir Sean Connery est un acteur et producteur britannique, né le 25 août 1930 à Édimbourg en Écosse et mort le 31 octobre 2020 à Nassau aux Bahamas.
Révélé en devenant le premier acteur incarnant James Bond au cinéma, il tient ce rôle, qui lui confère une célébrité mondiale, dans six films d'EON Productions — James Bond 007 contre Dr No (1962), Bons baisers de Russie (1963), Goldfinger (1964), Opération Tonnerre (1965), On ne vit que deux fois (1967) et Les diamants sont éternels (1971) — et revient dans le non officiel Jamais plus jamais (1983). En parallèle de James Bond, ses autres films notables de l'époque sont Pas de printemps pour Marnie (1964), Le Crime de l'Orient-Express (1974), L'Homme qui voulut être roi (1975) et Un pont trop loin (1977).
Après plusieurs années incertaines, il se renouvelle avec des rôles de mentors à partir des années 1980 dans de grands succès commerciaux comme Le Nom de la rose (1986), Highlander (1986), Les Incorruptibles (1987) et Indiana Jones et la Dernière Croisade (1989). Sa notoriété consolidée, il remporte de nombreux prix, dont l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle et le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour Les Incorruptibles, le BAFTA du meilleur acteur pour son interprétation du moine Guillaume de Baskerville dans Le Nom de la rose et un Cecil B. DeMille Award en 1996 pour l'ensemble de sa carrière. Il prend sa retraite après son rôle dans La Ligue des gentlemen extraordinaires (2003).
Icône du cinéma britannique, Sean Connery a été anobli par la reine Élisabeth II en 2000, pour services rendus au cinéma britannique. Il est également membre de l'ordre de l'Empire britannique. Fier de ses origines écossaises, il affiche publiquement son soutien à l'indépendantisme écossais.
Sir Sean Connery est un acteur et producteur britannique, né le 25 août 1930 à Édimbourg en Écosse et mort le 31 octobre 2020 à Nassau aux Bahamas.
Révélé en devenant le premier acteur incarnant James Bond au cinéma, il tient ce rôle, qui lui confère une célébrité mondiale, dans six films d'EON Productions — James Bond 007 contre Dr No (1962), Bons baisers de Russie (1963), Goldfinger (1964), Opération Tonnerre (1965), On ne vit que deux fois (1967) et Les diamants sont éternels (1971) — et revient dans le non officiel Jamais plus jamais (1983). En parallèle de James Bond, ses autres films notables de l'époque sont Pas de printemps pour Marnie (1964), Le Crime de l'Orient-Express (1974), L'Homme qui voulut être roi (1975) et Un pont trop loin (1977).
Après plusieurs années incertaines, il se renouvelle avec des rôles de mentors à partir des années 1980 dans de grands succès commerciaux comme Le Nom de la rose (1986), Highlander (1986), Les Incorruptibles (1987) et Indiana Jones et la Dernière Croisade (1989). Sa notoriété consolidée, il remporte de nombreux prix, dont l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle et le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour Les Incorruptibles, le BAFTA du meilleur acteur pour son interprétation du moine Guillaume de Baskerville dans Le Nom de la rose et un Cecil B. DeMille Award en 1996 pour l'ensemble de sa carrière. Il prend sa retraite après son rôle dans La Ligue des gentlemen extraordinaires (2003).
Icône du cinéma britannique, Sean Connery a été anobli par la reine Élisabeth II en 2000, pour services rendus au cinéma britannique. Il est également membre de l'ordre de l'Empire britannique. Fier de ses origines écossaises, il affiche publiquement son soutien à l'indépendantisme écossais.
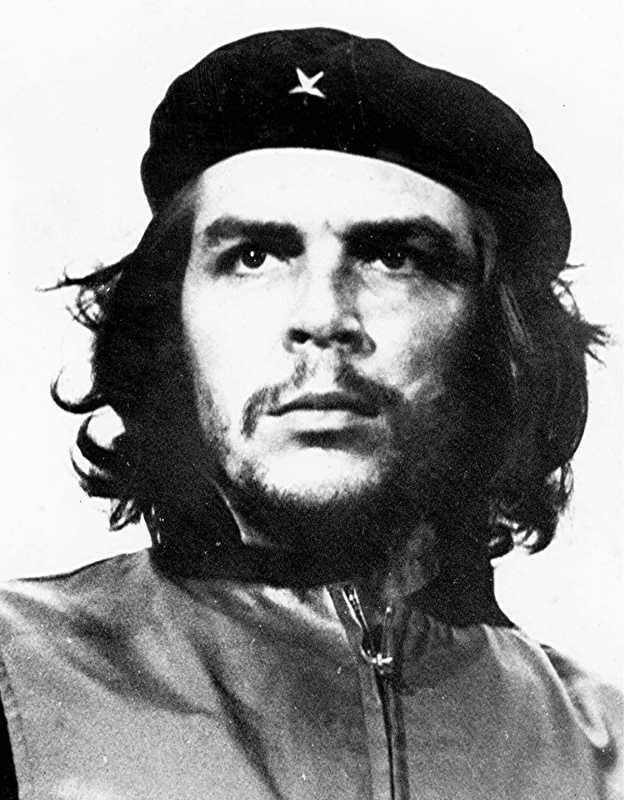 Ernesto Guevara, plus connu comme « Che Guevara » ou « le Che », né le 14 juin 1928 à Rosario en Argentine et mort exécuté le 9 octobre 1967 à La Higuera en Bolivie, à l'âge de 39 ans, est un révolutionnaire marxiste-léniniste et internationaliste argentin ainsi qu'un homme politique d'Amérique latine.
Ernesto Guevara, plus connu comme « Che Guevara » ou « le Che », né le 14 juin 1928 à Rosario en Argentine et mort exécuté le 9 octobre 1967 à La Higuera en Bolivie, à l'âge de 39 ans, est un révolutionnaire marxiste-léniniste et internationaliste argentin ainsi qu'un homme politique d'Amérique latine. Galilée (en italien : Galileo Galilei), né à Pise en 1564 et mort à Arcetri près de Florence le 8 janvier 1642 (77 ans), est un mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien du XVIIe siècle.
Parmi ses réalisations techniques, il a perfectionné et exploité la lunette astronomique, perfectionnement de la découverte hollandaise d'une lunette d'approche, pour procéder à des observations rapides et précoces qui ont bouleversé les fondements de l'astronomie.
Galilée (en italien : Galileo Galilei), né à Pise en 1564 et mort à Arcetri près de Florence le 8 janvier 1642 (77 ans), est un mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien du XVIIe siècle.
Parmi ses réalisations techniques, il a perfectionné et exploité la lunette astronomique, perfectionnement de la découverte hollandaise d'une lunette d'approche, pour procéder à des observations rapides et précoces qui ont bouleversé les fondements de l'astronomie. 1162 - 1227.jpg) Gengis Khan, cyrillique : Чингис Хаан, Tchinguis Khaan, MNS : Chingis Khaan, littéralement : « souverain universel »), d'abord nommé Temüjin, né vers 1155/1162 pendant le Khamag Mongol, dans ce qui correspond à l'actuelle province de Khentii en Mongolie, mort en août 1227 dans l'actuel Xian de Qingshui (Chine), est le fondateur de l'Empire mongol, le plus vaste empire continu de tous les temps, estimé lors de son extension maximale à 33,2 millions de km2 en 1268 sous Kubilai Khan.
Gengis Khan, cyrillique : Чингис Хаан, Tchinguis Khaan, MNS : Chingis Khaan, littéralement : « souverain universel »), d'abord nommé Temüjin, né vers 1155/1162 pendant le Khamag Mongol, dans ce qui correspond à l'actuelle province de Khentii en Mongolie, mort en août 1227 dans l'actuel Xian de Qingshui (Chine), est le fondateur de l'Empire mongol, le plus vaste empire continu de tous les temps, estimé lors de son extension maximale à 33,2 millions de km2 en 1268 sous Kubilai Khan. 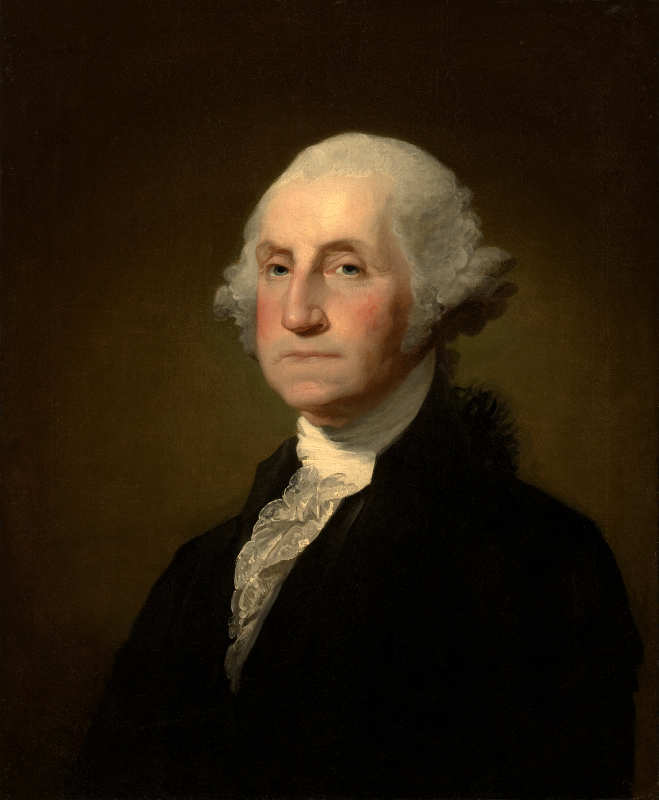 George Washington, né le 22 février 1732 à Pope's Creek (colonie de Virginie) et mort le 14 décembre 1799 à Mount Vernon (État de Virginie), est un homme d'État américain, chef d’État-major de l’Armée continentale pendant la guerre d’indépendance entre 1775 et 1783 et premier président des États-Unis, en fonction de 1789 à 1797.
George Washington, né le 22 février 1732 à Pope's Creek (colonie de Virginie) et mort le 14 décembre 1799 à Mount Vernon (État de Virginie), est un homme d'État américain, chef d’État-major de l’Armée continentale pendant la guerre d’indépendance entre 1775 et 1783 et premier président des États-Unis, en fonction de 1789 à 1797. 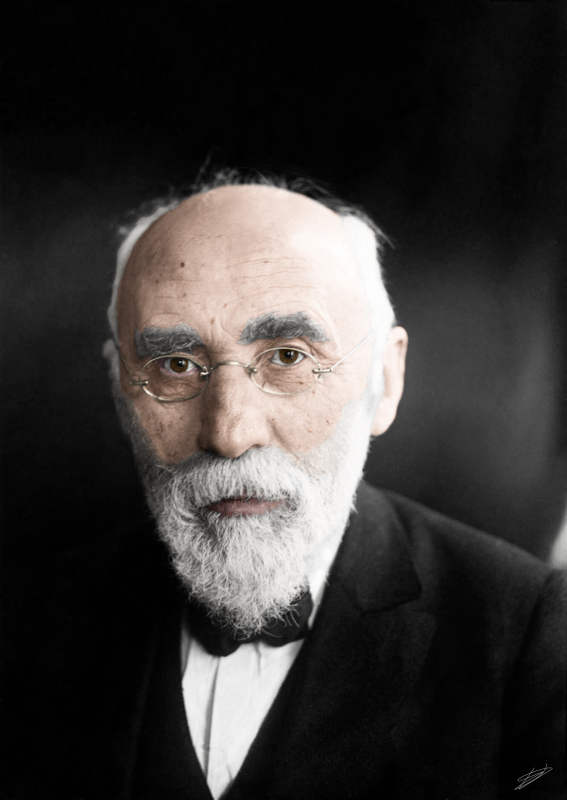 Hendrik Antoon Lorentz, né le 18 juillet 1853 à Arnhem (Pays-Bas) et mort le 4 février 1928 à Haarlem (Pays-Bas) est un physicien néerlandais qui s'est illustré par ses travaux théoriques sur la nature de la lumière et la constitution de la matière.
Hendrik Antoon Lorentz, né le 18 juillet 1853 à Arnhem (Pays-Bas) et mort le 4 février 1928 à Haarlem (Pays-Bas) est un physicien néerlandais qui s'est illustré par ses travaux théoriques sur la nature de la lumière et la constitution de la matière.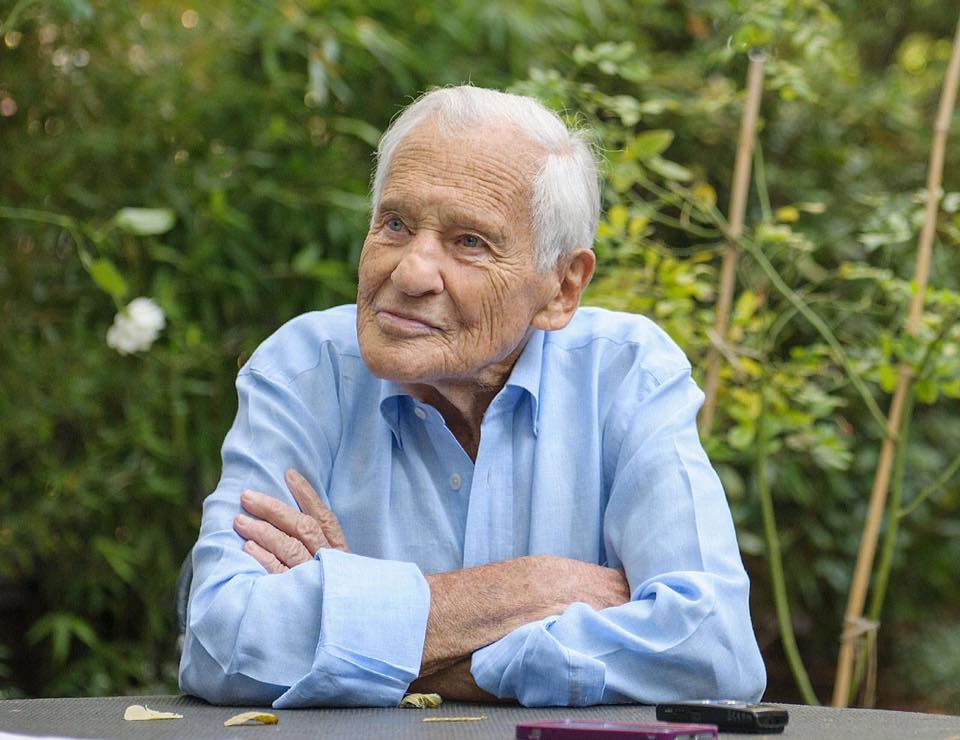 Jean d'Ormesson, parfois surnommé Jean d'O, né le 16 juin 1925 à Paris et mort le 5 décembre 2017 à Neuilly-sur-Seine, est un écrivain, journaliste et philosophe français.
Jean d'Ormesson, parfois surnommé Jean d'O, né le 16 juin 1925 à Paris et mort le 5 décembre 2017 à Neuilly-sur-Seine, est un écrivain, journaliste et philosophe français.